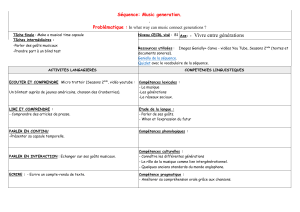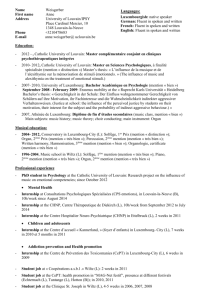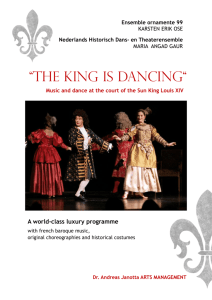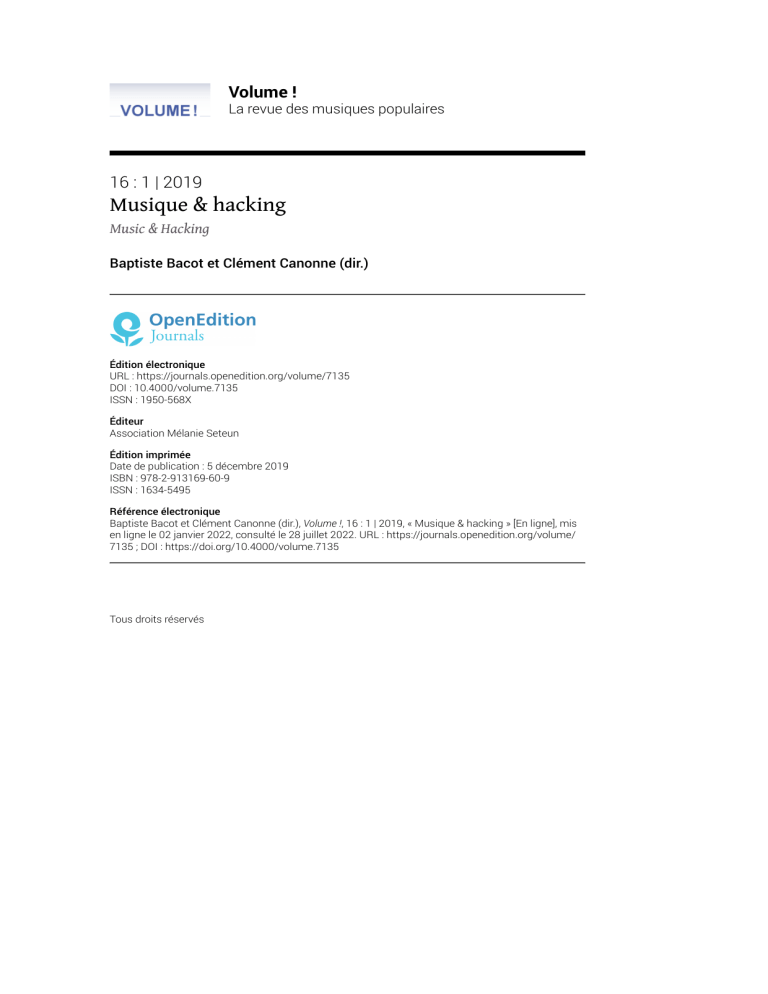
Volume ! La revue des musiques populaires 16 : 1 | 2019 Musique & hacking Music & Hacking Baptiste Bacot et Clément Canonne (dir.) Édition électronique URL : https://journals.openedition.org/volume/7135 DOI : 10.4000/volume.7135 ISSN : 1950-568X Éditeur Association Mélanie Seteun Édition imprimée Date de publication : 5 décembre 2019 ISBN : 978-2-913169-60-9 ISSN : 1634-5495 Référence électronique Baptiste Bacot et Clément Canonne (dir.), Volume !, 16 : 1 | 2019, « Musique & hacking » [En ligne], mis en ligne le 02 janvier 2022, consulté le 28 juillet 2022. URL : https://journals.openedition.org/volume/ 7135 ; DOI : https://doi.org/10.4000/volume.7135 Tous droits réservés INTRODUCTION DE LA PUBLICATION Ce numéro se propose d’examiner quelques-uns des points de contacts entre musique et hacking. Ce mouvement, d’abord étroitement lié à l’émergence des laboratoires de computer science dans les universités américaines, touche aujourd’hui de très nombreuses sphères de l’activité humaine, parfois sans rapport avec les technologies de l’information et de la communication. La musique offre ainsi un espace théorique et pratique permettant de questionner les attributs du hacking et d’en cerner les effets qui s’observent, entre autres, dans les conceptions esthétiques ou organologiques des musiciens, ainsi que dans leurs discours ou leurs modes d’appartenance à des communautés musicales. This issue examines some of the practices in which music and hacking meet. At first closely related to the development of American computer science research laboratories, hacking has since spread across various fields of human activity not necessarily related to information and communications technology. Hence, music provides both a theoretical and empirical space within which one can question hacking’s attributes, and delineate their aesthetic and organolologic effects, but also their integration into musicians’ discourses, or the way these musicans create musical communities and belong to them. Éditions Mélanie Seteun Musique et hacking Dossier coordonné par Baptiste Bacot et Clément Canonne Publié avec la concours de l'IRMECCEN, EA n°7546, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle Volume! La revue des musiques populaires est une publication semestrielle des éditions Mélanie Seteun, fondée en 2002 par Samuel Étienne, Gérôme Guibert et Marie-Pierre Bonniol. Comité de Rédaction Directeur de la publication Emmanuel Parent (université Rennes 2) Conseil de rédaction Louise Barrière, Alix Bénistant, Catherine Guesde, Gérôme Guibert, Claire Lesacher, Christophe Levaux, Matthieu Saladin, Jedediah Sklower et Michael Spanu Réalisation Secrétariat de rédaction Catherine Guesde et Cécile Verschaeve Mise en page Béatrice Ratréma Graphisme de couverture Matthieu Saladin Comité de lecture Arnaud Baubérot (université Paris-Est Créteil Val-deMarne) Andy Bennett (Griffith University) Christian Béthune (CIEREC, Saint-Étienne) Hugh Dauncey (Newcastle University) Simon Frith (university of Edinburgh) Hervé Glevarec (CNRS) Éric Gonzalez (université Rennes 2) Theodore Gracyk (Minnesota State University Moorhead) Joël Guibert (université de Nantes) Ian Inglis (Northumbria University) Olivier Julien (université Paris IV) Barbara Lebrun (university of Manchester) Béatrice Madiot (université Picardie II) Éric Maigret (université Paris III-Sorbonne Nouvelle) Christian Marcadet (université Paris I) Denis-Constant Martin (IEP Bordeaux) Gaëlle Pantin-Sohier (université d’Angers) Catherine Pessin (université de Grenoble) Christophe Pirenne (université catholique de Louvain) Dominique Sagot-Duvauroux (université d’Angers) Jean-Marie Seca (Versailles-Saint Quentin en Yvelines) Florence Tamagne (Université Lille III) Philippe Teillet (IEP Grenoble) Marc Touché (MNATP, CNRS) Sheila Whiteley (University of Salford) † Masahiro Yasuda (University of Leicester) Comité de parrainage Howard S. Becker (chercheur indépendant, États-Unis) Emmanuel Ethis (université d’Avignon) Jean-Louis Fabiani (EHESS) Philippe Gumplowicz (université Évry Val-d’Essonne/ EHESS) Antoine Hennion (École des Mines de Paris) Marc Jimenez (université Paris I Panthéon-Sorbonne) Serge Lacasse (université de Laval, Québec) David Looseley (university of Leeds) Numa Murard (université Paris VII) Bruno Péquignot (université Paris III-Sorbonne nouvelle) Philip Tagg (universities of Salford & Huddersfield) La revue Volume! est classée par l’AERES en 18 e section (« Arts »). Elle est indexée par l’International Index to Music Periodicals (IIMP), le Music Index et le Répertoire International de Littérature Musicale (RILM). Les articles sont disponibles sur : Cairn.info (www. cairn.info/revue-volume.htm), OpenEdition (https:// journals.openedition.org/volume/)et la plateforme RILM Abstracts with Full Text (http://rilm.org/ fulltext/). Membres de l’association Louise Barrière, Alix Benistant, Catherine Guesde, Gérôme Guibert, Claire Lesacher, Christophe Levaux, Emmanuel Parent, Béatrice Ratréma, Dario Rudy, Matthieu Saladin, Jedediah Sklower, Michael Spanu et Cécile Verschaeve. Identité et charte graphique Chloé Bernhardt & Justin Bihan www.cj2b.work Éditions Mélanie Seteun – association loi 1901 15 La Locquenais – 35 580 Guichen www.seteun.net / editions@seteun.net Dépôt légal : novembre 2019 ISBN : 978-2-913169-60-9 ISSN : 2117-4148 Abonnement : voir page 195 Distribution / diffusion : Les presses du réel http://www.lespressesdureel.com/editeur. php?id=192&menu=2 Sommaire Musique et hacking Dossier coordonné par Baptiste Bacot et Clément Canonne Articles 16 7 Baptiste Bacot et Clément Canonne, Musique et hacking : de l'éthique aux pratiques 17 Sarah Benhaïm, DIY et hacking dans la musique noise. Une expérimentation bricoleuse du dispositif de jeu 37 Eamon Bell, Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine: Unpacking the code and community behind an early software-based music visualizer 61 Clément Canonne, Élaborer son dispositif d’improvisation : hacking et lutherie dans les pratiques de l’improvisation libre 81 Marilou Polymeropoulou, Knowledge of limitations: hacking practices and creativity ideologies in chipmusic 1 101 David Christoffel, L’art du piratage à l’ère de la playlist 115 Nicolas Nova et François Ribac, Musi[ha]cking. Ce que la musique fait au hacking (et inversement) Tribune 127 Nicolas Collins, From Circuitry to Live Improvisation (and back): Hacking One’s Way Through Contemporary Electronic Music. An interview by Clément Cannone Notes de lecture 136 Ewa Mazierska, Les Gillon et Tony Rigg, Popular Music in the Post-Digital Age : Politics, Economy, Culture and Technology, New York, Bloomsbury, 2018. Par Loïc Riom 139 Nicolas Collins, Micro Analyses, édité et traduit de l’anglais par Lionel Bize, Laura Daengeli, Samia Guerid, Christian Indermuhle, Christine Ritter et Thibault Walter, Paris, Van Dieren, coll. « Rip on/off », 2015. Par Christophe Levaux Sommaire Introduction 3 142 Tetsuo Kogawa, Radio-art, UV Éditions, Paris, 2019. Par Gabriele Stera Hors dossier Article 145 Marion Henry, Cultures ouvrières et musiques populaires en Grande-Bretagne : le cas des brass bands miniers de 1945 au milieu des années 1970 Compte rendu 161 Colloque ACEMUP, 4e édition, 12 avril 2019. Par Eva Nicolas Tribune 165 À propos de l’ouvrage Made in France, Studies in Popular Music. Sous la direction de Gérôme Guibert et Catherine Rudent, Abingdon & New York, Routledge, 2018, coll. « Routledge Global Popular Music Series ». Par Denis-Constant Martin Notes de lecture 176 François Ribac (ed.), Simon Frith : Une sociologie des musiques populaires, Paris, Les presses du réel, 2018. Par Maxim Bonin 179 Dean Vuletic, Postwar Europe and the Eurovision Song Contest, New York, Bloomsbury, 2018 ; Karen Fricker et Milija Gluhovic (eds.), Performing the « New » Europe. Identities, Feelings and Politics in the Eurovision Song Contest, Basingstoke & New York, Palgrave Macmillan, 2013. Par Stéphane Resche 183 Sarah Baker, Catherine Strong, Lauren Istvandity et Zelmarie Cantillon (eds.), The routledge companion to popular music history and heritage, Abingdon & New York, Routledge, 2018. Par Eva Nicolas Sommaire 187 4 José Juan Olvera Gudiño, Economías del rap en el noreste de México. Emprendimientos y resistencias juveniles alrededor de la música popular, Mexico, CIESAS, 2018. Par Michael Spanu Biographies 190 Catalogue 194 Iconographie : Carte Blanche à Bonjour Monde Bonjour Monde est un groupe pour la recherche Pour les illustrations de ce numéro de Volume ! La de procédés alternatifs dans le champ de la création gra- revue des musiques populaires, le travail s’est fait en duo phique. Au travers de commandes, d’ateliers et de projets et en étapes avec, à chaque retour de balle, une altération auto-initiés, Bonjour Monde tente de questionner les outils, volontaire de l’information ; un “hijacking” du processus de logiciels et matériels, de les construire et les déconstruire création, l’emmenant progressivement vers des territoires pour les détourner de leur fonction initiale dans une infinie imprévus. recherche de bruit, d’erreur et d’heureux accidents. 16 Sommaire 1 5 Par Baptiste Bacot (EHESS/IRCAM) et Clément Canonne (IRCAM-CNRSSorbonne Université) 16 1 Par ses ramifications multiples, le hacking a donné naissance à d’innombrables pratiques. La figure du hacker, qui émerge à partir des années 1960 dans les laboratoires de computer science des universités américaines, signale le début d’un mouvement qui allait rapidement se propager de manière virale et protéiforme. Si le hacking est bien lié au développement de l’informatique et du réseau Internet, depuis les tentatives pionnières au sein du Tech Model Railroad Club (TMRC) du Massachussets Institute of Technology (MIT) pour améliorer l’efficacité et la rapidité des premiers ordinateurs de calcul (chapitre 1 de Levy, 1984) jusqu’à la création de Wikileaks en 2006, en passant par le mouvement open source (DiBona, Ockman & Stone, 1999), il est aujourd’hui assez courant d’étendre l’usage de ce concept pour décrire de nombreuses pratiques, y compris dans des champs indépendants des technologies de l’information et de la communication, 1 Voir la très active communauté des « Ikea Hackers » qui se consacre aux mille et une manières de détourner ou d’« améliorer » les meubles de la célèbre entreprise suédoise : http://www.ikeahackers.net (vu le 31 juillet 2019). Musique et hacking : de l’éthique aux pratiques Musique et hacking : de l’éthique aux pratiques Introduction Introduction du jardinage à la décoration intérieure 1, en passant par le sport, la cuisine ou la mécanique. Le hacking a donc à la fois une épaisseur historique dont on peut rendre compte à travers le processus d’appropriation des machines informatiques, qui débouche sur des usages insoupçonnés de la puissance de calcul (Thomas, 2002), en même temps qu’il a une influence inattendue sur les conceptions de la culture matérielle et de la structuration sociale (Lallement, 2015). Cet essor rapide du hacking a sans doute été facilité par sa représentation dans la culture populaire : il est au cœur de plusieurs longs-métrages à l’influence déterminante (citons par exemple Tron en 1982, WarGames en 1983, Hackers en 1995 ou The Matrix en 1999) et il devient un trope de la littérature d’espionnage (voir par exemple le roman de Stoll [1989]). Les médias s’emparent eux aussi volontiers des affaires liées au hacking, qui se multiplient au début de notre décennie. En 2011, Aaron Swartz, un développeur, entrepreneur numérique et « hacktiviste » né en 1986, est arrêté et poursuivi par la justice américaine pour avoir procédé au téléchargement massif d’articles scientifiques via le portail JSTOR, enfreignant ainsi le Computer Fraud and Abuse Act de 1984. Il se donne la mort en janvier 2013. Cette même année, le lanceur d’alerte Edward Snowden révèle que la National Security Agency (NSA) conduit au niveau mondial des programmes de surveillance grâce à la collecte de données personnelles, largement 7 Baptiste Bacot et Clément Canonne facilitée par la coopération d’agences de renseignement gouvernementales – un récit porté à l’écran par Oliver Stone en 2016. En mars 2018, Christopher Wylie, un ancien employé de Cambridge Analytica, révèle que l’entreprise a recueilli sans leur consentement les données de dizaines de millions d’utilisateurs du réseau social Facebook, et qu’elles ont servi à influencer plusieurs processus électoraux dans différents pays. Le monde universitaire ne fait pas exception : depuis une vingtaine d’années, les études sur les pratiques voisines du hacking se multiplient, et se concentrent notamment sur les nouvelles socialités qui en découlent (Berrebi-Hoffman, Bureau & Lallement, 2018), les nouveaux lieux dans lesquels elles se déploient, tels les Fab Labs (Bosqué, 2015) ou les hackerspaces (Davies, 2017), et sur les implications politiques qui sous-tendent ce mouvement (Turner, 2006 ; Söderberg, 2008). Le hacking, par la multiplicité et la diversité de ses manifestations, a un statut ambivalent, situé à l’intersection entre usages créatifs, politiques et sociaux de la technologie, qui peuvent être tantôt anxiogènes, tantôt émancipateurs. Ces attributs lui donnent une place de choix dans les productions culturelles, ainsi que dans les discours médiatiques et académiques. Musique et culture hacker 8 Les pratiques musicales n’ont pas échappé à la propagation fulgurante du hacking, qui les affecte selon des modalités variées, sans d’ailleurs toucher uniquement les répertoires associés à des moyens électroniques de production du son. Tout comme le TMRC du MIT est avant tout un club qui rassemble ses adhérents autour d’une passion partagée, la dimension communautaire et socialisante est également présente parmi les hackers-musiciens. Certains travaillent donc dans ces Fab Labs ou hackerspaces, espaces très souvent associatifs dans lesquels outillage et machinerie sont à disposition, telle l’imprimante tridimensionnelle, emblème de ces tiers lieux. Il faut signaler ici l’existence du Music Hackspace de Londres, un lieu spécifiquement dédié à l’expérimentation sonore et technologique 2 . En outre, on voit fleurir depuis quelques années, sur le modèle des hackathons – mot valise formé à partir des termes « hacking » et « marathon » –, des Music hack days, événements regroupant passionnés de musique et de bricolage pour travailler en immersion et de manière collaborative sur des projets logiciels, instrumentaux ou audiovisuels, comme celui qui s’est tenu à l’Ircam les 10 et 11 novembre 2017 3 . Les musiciens-bricoleurs qui sont dans l’incapacité de travailler dans des hackerspaces peuvent tirer parti des technologies de l’information et de la communication en réseau pour partager ou accéder à des catalogues descriptifs de « hacks » sonores et musicaux 4 , sur le modèle d’autres répertoires similaires – food hacks, gardening hacks, etc. – visant à optimiser la vie quotidienne, en s’appuyant très souvent sur le détournement de matériaux ou 2 http://musichackspace.org/ (vu le 31 juillet 2019). 3 http://hacking2017.ircam.fr/ (vu le 31 juillet 2019). 4 Voir par exemple https://hackaday.com/category/ musical-hacks/ (vu le 31 juillet 2019). 1 5 Pour une histoire « longue » de la question du piratage musical, voir Cummings (2013). Musique et hacking : de l’éthique aux pratiques Shruti de Mutable Instruments. L’exemple le plus significatif est sans doute celui de l’entreprise Arduino, qui commercialise du matériel et des logiciels « prêt-à-hacker » permettant de créer appareils et dispositifs numériques. Mais la posture hacker ne porte pas exclusivement sur la matérialité de la musique ; elle s’étend aussi à l’accès au savoir et aux œuvres, et s’accompagne d’une réflexion sur le droit d’auteur et les conditions de leur diffusion. Les pratiques de peer-to-peer inaugurées avec Napster 5 (par l’encodage et la dissémination qu’elles supposent) ou de contournement des robots-copyright des plateformes de diffusion en ligne signent ainsi le passage « d’une culture de la distribution marchande de biens matériels à une culture de l’échange de biens immatériels » (Allard, 2009) en même temps qu’elles autorisent une multitude d’appropriations créatives (remix, mash-up, détournements, etc.) à une échelle jusque-là inédite (Allard, 2016). Dans la même perspective, l’open source, le Copyleft ou les licences dites « libres » (Blondeau et Latrive, 2000) font sauter d’une ingénieuse manière le verrou de la propriété intellectuelle et débarrassent les œuvres de l’esprit de leurs entraves juridiques en les rendant reproductibles, modifiables et en autorisant leur transmission – autant de paramètres et de conditions qui peuvent varier selon le type de licence. L’idée sous-jacente aux licences de type « art libre » est que la libre circulation du savoir a plus de répercussions positives à grande échelle, tandis qu’une diffusion restreinte et soumise à conditions Introduction 16 d’objets. Comme dans les autres domaines, le hacking musical invite à l’activité collective : il se conjugue au pluriel et a d’autant plus de sens qu’il est partagé, que ce soit en ligne ou dans un lieu équipé où d’autres passionnés se retrouvent pour échanger leurs dernières trouvailles. C’est sans doute dans la matérialité de la musique que les effets du hacking s’observent le plus facilement. Entre recyclage, détournement, DIY et hybridation technologique (de l’acoustique, de l’analogique et du numérique, par exemple), il existe de nombreuses façons de faire du hacking instrumental. Le microphone, l’amplificateur et le haut-parleur sont des objets techniques simples, qui suffisent à doter presque n’importe quel objet de qualités sonores. Par la technique du circuit bending, de petits appareils électroniques peuvent rapidement devenir des instruments ; quelques outils pour percer et découper peuvent suffire à fabriquer la plus rudimentaire des flûtes ; le groupement d’objets sonores hétéroclites, avec un peu de travail, peut déboucher sur un dispositif instrumental ; l’environnement matériel en général peut même être instrumentalisé par certains musiciens. De même qu’il existe des répertoires de hacks, nombre de manuels (comme celui de Collins [2006]) peuvent guider les apprentis-hackers dans leurs démarches de détournement organologique, qui combinent d’ailleurs souvent de multiples techniques. Enfin, il nous semble particulièrement révélateur que l’industrie des technologies musicales se soit récemment approprié l’esprit du hacking en proposant à la vente des synthétiseurs en pièces détachées à monter soi-même, dans l’esprit DIY, comme le Synth Kit de Korg et Little Bits, le Werkstatt-01 de Moog ou le 9 Baptiste Bacot et Clément Canonne 10 sert uniquement les intérêts (financiers) d’un petit nombre. Ce sont donc là encore les dimensions collectives et collaboratives qui poussent certains musiciens-développeurs à publier en ligne leur code ou leurs productions musicales, afin que d’autres puissent se les approprier, les modifier et les remettre en circulation, et que d’autres encore s’en saisissent par la suite. Les attributs du hacking On l’a vu, les contextes où l’on rencontre le terme hacking sont si divers et les usages que l’on a pu en faire ont tellement évolué au fil du temps qu’il semble bien difficile d’en délimiter précisément les contours. Pourtant, cette tâche apparaît vite comme nécessaire si l’on veut pouvoir donner un contenu – même minimal – à l’idée de hacking et, partant, aux pratiques de hacking musical. Pour qu’il y ait hacking, il faut d’abord qu’il y ait une clôture matérielle ou symbolique, technique ou juridique, qui renferme quelque chose comme une « boîte noire ». Le hack suppose donc toujours un acte préalable d’ouverture, voire de transgression ou d’effraction : c’est son moment « négatif ». Mais ce geste d’ouverture s’accompagne parallèlement d’un mouvement d’appropriation – de la simple compréhension de l’agencement et du fonctionnement de la « boîte noire » en question jusqu’à son altération radicale, en passant par son optimisation, sa duplication et sa diffusion : c’est le moment « positif » du hack. Le propre du hack est donc d’abord à chercher dans cette dualité opératoire : casser pour réparer, crocheter pour diffuser, transgresser pour augmenter. Ensuite, les opérations constitutives du hack s’accompagnent typiquement d’une certaine posture axiologique (Himanen, 2001 ; Kirkpatrick, 2002), qui voit les hackers valoriser un certain nombre de principes : le libre accès (plutôt que la propriété), le partage (plutôt que la rétention), la fabrication (plutôt que la consommation), le recyclage (plutôt que la mise au rebut), la transformation (plutôt que la reproduction), ou le don réciproque (plutôt que l’échange marchand). À bien des égards, le hacking peut donc se lire comme une réaction à un certain mode de structuration des échanges, aux pratiques de contrôle qui en découlent, et au type de relation à l’environnement technique et matériel que cela induit. Enfin, on peut considérer le hacking comme étant configuré par les catégories conceptuelles de l’informatique – l’ordinateur comme objet technique à la fois ouvert et indéterminé ; le code comme support de l’information ; le réseau comme structure de communication, entre autres. De ce contact inaugural avec le monde de l’informatique découle une véritable ontologie du hacking, qui entend échapper à la fois à l’opposition entre le virtuel et l’actuel – le virtuel affleurant toujours à la surface de l’actuel (McKenzie Wark, 2006) – et à l’opposition entre matière et information – les objets matériels étant toujours susceptibles d’être ramenés à un code source. Ces deux derniers aspects peuvent fournir des critères de délimitation contextuelle importants des usages du concept de hacking : si le hacking présuppose une certaine ontologie – qui est celle des sociétés de l’information – et une certaine axiologie – largement 1 Musique et hacking : de l’éthique aux pratiques ces cas se distinguent d’un certain nombre de pratiques voisines. On rencontrera ainsi typiquement des formes de hacking musical au croisement des musiques expérimentales (qui partagent avec le hacking un goût certain pour l’exploration bricoleuse d’instruments ou de circuits électroniques, voir Gottschalk [2016]), des musiques underground (qui partagent avec le hacking une même éthique anarchisante et DIY [voir Jamet, 2015]) et des musiques électroniques (qui partagent avec le hacking un même rapport à la ductilité du code musical et à la modularité des outils de production [voir Bacot, 2017]) sans que celles-ci ne se ramènent de manière univoque à l’une ou l’autre de ces pratiques. Les pratiques musicales à la lumière du hacking Nous savons maintenant où chercher le hacking musical. Mais il reste néanmoins une question importante en suspens : peut-on parler de hacking musical là où les acteurs des pratiques ne s’identifient pas comme hackers, ou ne revendiquent pas l’appartenance à la culture hacker ? Et si oui, qu’a-t-on à gagner à décrire ces pratiques en termes de hacking ? Si certains des articles rassemblés dans ce dossier portent sur des pratiques (la chipmusic examinée par Marilou Polymeropoulou) ou des travaux (comme les projets radiophoniques du collectif P-node présentés par David Christoffel ou le visualiseur musical Virtual Light Machine analysé par Eamonn Bell) qui sont très fortement liés au monde du hacking par un certain nombre de points Introduction 16 construite en réaction aux superstructures du capitalisme – alors il n’est sans doute pas pertinent de parler de hacking en dehors de ce double contexte, à moins de vouloir diluer à l’infini ce qui peut en faire la spécificité ou de vouloir restreindre son application à un simple usage métaphorique. Autrement dit, s’il est bien légitime de partir à la recherche des antécédents et précurseurs du hacking, il n’est peut-être pas nécessaire de vouloir à tout prix requalifier un certain nombre de pratiques préexistantes en termes de hacking ; en ce sens, les concepts de bricolage – compris comme l’utilisation de moyens détournés pour parvenir à une fin que l’on s’est fixé –, d’improvisation – comprise comme adaptation spontanée et créatrice à l’imprévisibilité de son environnement –, de détournement – compris comme déplacement à la fois pratique, contextuel et sémiotique – ou de braconnage – compris comme acte de résistance des individus au sein des sociétés de consommation – conservent évidemment toute leur pertinence pour qualifier les pratiques « hackantes » de l’ère prénumérique. Nous disposons donc maintenant de trois critères pour caractériser le hacking : un critère opératoire, un critère axiologique et un critère ontologique. Ces trois critères ne fonctionnent évidemment pas comme un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes, qui permettraient de départager le hacking du non-hacking ou du pseudo-hacking ; et selon le poids que l’on accordera à chacun d’entre eux, l’on pourra faire un usage plus ou moins restrictif (ou au contraire plus ou moins extensif) du concept de hacking. Néanmoins, ces critères peuvent nous aider à localiser plus précisément les cas de hacking musical, et à montrer en quoi 11 Baptiste Bacot et Clément Canonne 12 de contacts directs (demoscene, cheat codes, piratage, etc.), d’autres articles se proposent en effet d’examiner des mondes musicaux (la noise dans l’article de Sarah Benhaïm, l’improvisation libre dans l’article de Clément Canonne ou le reggae 8-bit et les microphones des crooners dans l’article de Nicolas Nova et François Ribac) dans lesquels la place de la culture hacker apparaît peut-être de manière moins évidente, ou du moins dans lesquels la revendication de l’appartenance à cette culture n’est pas explicite. De manière générale, on peut certes distinguer l’ordre des discours de l’ordre des pratiques ; et, ce n’est évidemment pas parce que le terme « hacking » n’apparaît pas directement dans les propos des enquêtés que leurs pratiques sont forcément étrangères à toute forme de hacking. En particulier, les articles de Sarah Benhaïm et de Clément Canonne montrent que les critères mentionnés ci-dessus pour caractériser le hacking s’avèrent également pertinents pour décrire la pratique des musiciens de noise ou d’improvisation libre. Et au fond, il n’y a rien d’étonnant à cela : ces deux courants se situent en effet à la croisée d’un ensemble de pratiques à la fois musicales (entre musiques expérimentales, underground et électroniques) et politiques (voir par exemple Saladin [2014] sur l’improvisation libre ou Benhaïm [2018] sur la noise) qui les rendent particulièrement réceptives à l’éthos hacker. Plus fondamentalement, l’analyse de ces pratiques à l’aune du hacking permet également de mettre en évidence leur cohérence. Le concept de hacking joue ici un rôle intégratif et permet de penser ensemble opérations instrumentales, régimes de valeurs (éthiques comme esthétiques) et ontologies implicites, en montrant comment ces différents aspects s’articulent au sein des pratiques de ces musiciens. Plus encore, l’identification au sein de ces pratiques des traces les plus visibles de l’ethos hacker (par exemple dans le goût pour le bricolage instrumental) peut amener l’ethnographe ou le musicologue à partir à la recherche d’autres éléments caractéristiques du hacking peutêtre moins immédiatement saillants. Le hacking se fait alors outil d’analyse : ainsi, la lecture des pratiques d’improvisation libre à l’aune de ce concept permettra-t-elle de mieux comprendre à quel point ces musiques – pourtant largement acoustiques – sont sous-tendues par l’ontologie du flux et du réseau propre à l’électronique, qu’il s’agisse de penser l’instrument sur le modèle d’un dispositif modulaire ou le traitement du matériau sonore sur le modèle de l’interpolation et de la transformation continues plutôt que sur celui de la manipulation d’unités discrètes. Dans la même perspective, le concept de hacking musical peut également jouer un rôle heuristique, en autorisant des rapprochements insoupçonnés entre des communautés souvent considérées comme très éloignées les unes des autres – par exemple en révélant le substrat commun existant entre la culture gamer et les musiques expérimentales d’inspiration rétro-technique. Au fond, la description de certaines pratiques musicales en termes de hacking vient tout simplement souligner le rôle joué par ces dernières dans les mouvements de contestation sociale – à la fois discrète et éparse – qui se trouvent fédérés sous la bannière du hacking. LL de Mars, artiste protéiforme lié au mouvement Copyleft depuis la fin des années 1990, décrit ainsi la manière dont les milieux militants les plus informés sur la question du hacking se sont hacker, tous les militants écoutaient du punk à texte. Puis ils se sont mis au rap, parce que pour toute une classe de militants de gauche, ça représentait un désir incapable de s’assouvir autrement de se rapprocher des minorités les plus offensées au quotidien par le pouvoir […] Mais aujourd’hui, ce Remerciements truc-là, la musique correspondante, adéquate, à une certaine représentation de soi politique, ce n’est plus la même, elle a bougé. On écoute beaucoup de musique expé, et on vit autrement la musique, comme des moments de musique justement nécessaires. En fait, c’est une retrouvaille avec la question musicale dans les milieux politiques, et du coup une retrouvaille avec la question musicale comme question politique. » (entretien avec Clément Canonne et Annelies Fryberger, 16 mars 2019) 16 1 Introduire la catégorie de hacking musical, c’est finalement réinscrire la musique au cœur des questionnements de notre temps : non seulement le hacking musical vient éclairer la manière dont communautés militantes et artistiques s’interpénètrent dans la contestation d’une culture commerciale Ce numéro rassemble une sélection d’articles présentés lors du colloque international « Musique & Hacking » organisé les 8 et 9 novembre 2017 au Musée du quai Branly – Jacques Chirac et qui a réuni une vingtaine de contributeurs. Ce colloque s’est tenu dans le cadre d’un projet de recherche soutenu par le Labex CAP associant l’Ircam, le laboratoire HT2S (CNAM) et le Musée du quai Branly. Nous remercions particulièrement Frédéric Keck et Anna Gianotti Laban, pour leur aide précieuse dans l’organisation de ce colloque, ainsi que Guillaume Pellerin et Émilie Zawadzki, qui ont mis sur pied le Music Hack Day venu clôturer l’événement. Musique et hacking : de l’éthique aux pratiques « Quand j’ai commencé à fréquenter les milieux et industrielle mondialisée souvent normalisante, mais encore permet-il de montrer comment les pratiques musicales peuvent se constituer en vecteur de diffusion de la culture hacker auprès de publics variés, voire contribuer à leur tour à façonner de nouvelles communautés de hackers. Introduction progressivement rapprochés des musiques expérimentales, qui donnaient à voir et à entendre in vivo ce même ethos hacker : 13 Baptiste Bacot et Clément Canonne Bibliographie Allard Laurence (2009), « Pragmatiques de l’internet mobile : technologies de soi et culture du transfert », in Abbas Yasmine et Dervin Fred, Technologies numériques du soi et (co)-constructions identitaires, Paris, L’Harmattan, p. 60-74. — (2016), « La remix culture : une poïétique ordinaire du Web », in Kaplan Frédéric et Nova Nicolas (eds.), La culture internet des mèmes, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, p. 62-75. Bacot Baptiste (2017), Geste et instrument dans la musique électronique : organologie des pratiques de création contemporaines, thèse de doctorat en Musique, histoire, société, EHESS. Benhaïm Sarah (2018), Aux marges du bruit. Une étude de la musique noise et du Do It Yourself, thèse de doctorat en Musique, histoire, société, EHESS. Berrebi-Hoffman Isabelle, Bureau Marie Christine & Lallement Michel (2018), Makers, enquête sur les laboratoires du changement social, Paris, Seuil. Blondeau Olivier & Latrive Florent (2000), Libres enfants du savoir numérique. Une Anthologie du « libre », Paris, L’éclat. Bosqué Camille (2015), « Des FabLabs dans les marges : détournements et appropriations », Journal des anthropologues, n os 142-143, p. 49-76, en ligne : https://journals.openedition.org/ jda/6207 14 Collins Nicolas (2006), Handmade electronic music. The Art of Hardware Hacking, New York, Routledge. Cummings Alex Sayf (2013), Democracy of Sound : Music Piracy and the Remaking of American Copyright in the Twentieth Century, Oxford, Oxford University Press. Davies Sarah R. (2017), Hackerspaces. Making the Maker Movement, Cambridge, Polity. DiBona Chris, Ockman Sam & Stone Mark (eds) (1999), Open Source : Voices from the Open Source Revolution, Sebastopol (CA), O’Reilly Media. Gottschalk Jennie (2016), Experimental music since 1970, New York, Bloomsbury. Himanen Pekka (2001), L’éthique hacker et l’esprit de l’ère de l’information, traduction française de Claude Leblanc, Paris, Exils. Jamet Romuald (2015), « Do it yourself ! Musique, éthique et contre-culture », in Lacroix Bernard, Landrin Xavier, Pailhès Anne-Marie & Rolland-Diamond Caroline (eds.), Les contrecultures : genèses, circulations, pratiques, Paris, Syllepse, p. 443457. Kirkpatrick Graeme (2002), « The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age », Max Weber Studies, vol. 2, no 2, p. 163-185. Lallement Michel (2015), L’âge du faire. Hacking, travail, anarchie, Paris, Seuil. Levy Steven (2010) [1984], Hackers : Heroes of the Computer Revolution, Sebastopol (CA), O’Reilly Media. McKenzie Wark Kenneth (2006), Un manifeste hacker, traduction française du collectif Club Post1984 Mary Shelley and C° Hacker Band, Paris, Critical Secret. Saladin Matthieu (2014), Esthétique de l’improvisation libre. Expérimentation musicale et politique, Dijon, Les presses du réel. Söderberg Johan (2008), Hacking Capitalism. The Free an Open Source Software Movement, New York, Routledge. Stoll Clifford (2005) [1989], The Cuckoo’s Egg : Tracking a Spy Through the Maze of Computer Espionage, New York, Pocket Books. Thomas Douglas (2002), Hacker Culture, Minneapolis, University of Minnesota Press. Turner Fred (2006), From Counterculture to Cyberculture, Stewart Brand, The Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, Chicago, University of Chicago Press. du savoir et la sérendipité bruitiste. Mots-clés : musique noise / expérimentation / DIY et hacking dans la musique noise. Une expérimentation bricoleuse du dispositif de jeu DIY / hacking / bricolage / électronique Abstract: Since the genre’s birth in the 1970s, noise music’s instrumental practices have stemmed from an alternative experimental culture. Among these practices, hacking and DIY cultures deeply influence its performance apparatus, while determining the learning and transmission processes that structure noise music economically and ethically. In DIY et hacking dans la musique noise… Article défend également l’autonomie des pratiques, l’accessibilité order to appreciate the way hacking operates within this genre, this paper will successively explore amateur practices that craft, misuse and patch-up electronic instruments. On the one hand, these self-taught practices contribute to a shift from individual music skills to engineering and DIY crafting. On the other hand, they depend on a circulation of Par Sarah Benhaïm (CRAL/EHESS) 1 communities associated with the open source movement. Résumé : Depuis sa genèse à la fin des années 1970, Responding to the hacker ethics, these spaces of sharing and la musique noise se distingue par des pratiques instru- DIY practices have fostered an anti-consumerist approach mentales étroitement liées à une culture d’expérimentation that supports practical autonomy, knowledge accessibility alternative. Parmi elles, le hacking et le DIY teintent en and noise serendipity. profondeur les manières de composer le dispositif de jeu en plus de gouverner les rapports d’apprentissage et de transmission qui structurent éthiquement et économiquement le genre. Pour rendre compte de la manière dont intervient le hacking dans la noise, l’article explore successivement les pratiques amateures qui s’apparentent au bricolage, au détournement et à la conception électronique d’instruments. Si ces manières de faire sont empreintes d’autodidaxie et participent à reconfigurer la figure du musicien en dépla- Keywords: noise music / experimentation / DIY / hacking / electronics La musique noise se trouve, depuis ses premières productions et improvisations bruitistes à la fin des années 1970, étroitement associée à un large éventail de gestes caractérisés par l’expérimentation 1 et par l’éthos çant la compétence instrumentale conventionnelle vers le bricolage et l’ingénierie, elles se transmettent aussi par le biais de ressources mutualisées au sein d’ateliers ou par l’intermédiaire d’une communauté internet associée à l’open source. Dans ces lieux de partages et au cœur des gestes bricoleurs se loge, en correspondance étroite à l’éthique hacker et au précepte DIY qui structure l’éthos de la noise, une approche anti-consumériste de l’instrumentation qui 1 On ne peut connaître l’issue de l’expérimentation qu’au moment où on la met en œuvre : ainsi théorisée par John Cage, l’expérimentation en musique a souvent été envisagée comme questionnement, à l’encontre de l’adhésion aux lois érigées par la tradition musicale occidentale. Ce concept, pensé selon cette figure majeure de l’histoire musicale dans une proximité étroite à celui de l’indétermination, Article 16 knowledge made possible by collective workshops or online 17 Sarah Benhaïm 18 du Do it Yourself (DIY). Si du point de vue de l’expérimentation instrumentale, une filiation esthétique plus établie peut être esquissée dans le sillage de nombreux artistes d’avantgarde, qu’il s’agisse par exemple de Luigi Russolo, de John Cage, de Harry Partch, de La Monte Young ou de Christian Marclay, les inventions et les mésusages instrumentaux qui caractérisent la nature de son jeu et de son instrumentation s’insèrent aussi dans une tradition du DIY qui associe activité manuelle créative et distanciation éthique à l’égard des performances technologiques. Dès ses premières occurrences, le DIY s’inscrit en effet dans une généalogie profondément manuelle : selon Steve Waksman (2004), cette expression employée dès 1912 dans des périodiques tels que fait en réalité l’objet d’un usage pluriel. Outre les filiations généalogiques – depuis l’expérimentation romanesque de Zola à l’exploration de la tradition expérimentale américaine – retracées par certains auteurs tels que Davis Nicholls et William Brooks, une autre version influente du concept a été popularisée depuis la France par le biais du travail de Pierre Schaeffer. Matthieu Saladin expose la pluralité des approches de l’expérimentation, anciennes comme contemporaines, questionnées dans leur rapport ambivalent à la modernité : « […] alors qu’une certaine tradition expérimentale réclame le retrait de l’individu dans son projet, d’autres formes visent l’expérience des limites, aussi bien chez les musiciens que chez les auditeurs, ou encore s’attachent à interroger les rapports au collectif. Mais les ambitions de l’expérimentation se retrouvent encore historiquement dans le vœu de troubler les frontières entre l’art et la vie – sinon entre les arts (dimension intermédiatique) –, d’investir les possibilités offertes par les nouvelles technologies, tout comme dans la volonté de questionner leur domination et d’en exploiter les failles. » (2012 : 1012) Étroitement liée à certaines des approches ici énoncées, l’expérimentation caractéristique de la musique noise associe le jeu librement improvisé, la place fondamentale consacrée au bruit ainsi que la sérendipité provoquée par les connectiques, comme nous l’observerons au long de cet article. Suburban Life Magazine fait œuvre d’injonction, principalement adressée aux hommes résidant dans les banlieues américaines au tournant du XX e siècle, à individualiser euxmêmes leur habitat plutôt qu’à déléguer le travail manuel aux professionnels. Pour ce qui concerne ses origines musicales, Fabien Hein (2012 : 49) les attribue au skiffle, ce genre américain des années 1920-1930 empreint de blues, de jazz et de country, qui se distingue par des pratiques de détournement d’objets bon marché et d’ustensiles ménagers. La dimension bricolée de l’instrumentation s’accompagne alors, par son accessibilité, d’une démocratisation de la pratique musicale chez les jeunes amateurs. Mais plus célèbre est sans doute l’appropriation du DIY par le mouvement punk dès le milieu des années 1970 : celui-ci s’inscrit dans une entreprise globale qui vise à acquérir une plus grande autonomie dans les pratiques de jeu par l’incitation à créer sans apprentissage instrumental préalable – c’est ici la simplicité des formes musicales et l’accessibilité des instruments fabriqués en série qui en sont le support –, mais aussi à travers les pratiques autonomes de production et de diffusion des concerts et des labels. C’est au sein de cet héritage qui encourage à travailler dans la proximité, dans la multiplicité et dans la simplicité à l’aide de ressources quotidiennes et accessibles, que s’inscrivent la musique noise et les pratiques sociales qui lui sont associées. Dérivée d’une production musicale étroitement liée à des milieux d’inspiration libertaire contemporains du punk, qu’il s’agisse de l’aspiration anarchiste des expérimentateurs de la côte Ouest états-unienne réunis dans le collectif LAFMS ou de l’approche plus nihiliste et autonome de la musique industrielle européenne, la noise est depuis 1 DIY et hacking dans la musique noise… ouverte dont les sources sonores sont le plus souvent multiples et hybrides – des synthétiseurs aux tables de mixage, des instruments conventionnels aux objets percussifs amplifiés, des lecteurs cassettes aux loopers –, le dispositif noise est le fruit de connectiques personnalisées, souvent agencées à partir de diverses pédales d’effet, qui œuvrent en tant que médiations d’une circulation sonore bruiteuse, transformée et amplifiée. Nous le verrons, l’ouverture du spectre sonore au monde des bruits implique souvent pour les artistes de fabriquer ou détourner leurs instruments, de jouer avec des matériaux défectueux, obsolètes ou habituellement déconsidérés, afin que l’environnement sonore soit l’objet d’une circulation qui puisse inclure des bruits conventionnellement considérés comme parasites. À partir des résultats d’une enquête menée auprès de praticiens et praticiennes de la scène underground parisienne, il s’agira en définitive de proposer par le biais de cet article une étude de ces pratiques instrumentales à la lumière de l’expérimentation musicienne et du précepte du DIY, depuis le bricolage individuel personnalisé aux ressorts communautaires du « faire » électronique. Le hacking comme bricolage : recyclage, détournement et circuit-bending Si le hacking peut renvoyer à des techniques qui mobilisent le plus souvent l’informatique et œuvrent à se concentrer sur l’exploitation des vulnérabilités, en particulier Article 16 ses prémices marquée par un environnement culturel qui, tout en défendant une économie alternative basée sur une activité d’auto-organisation de concerts et d’autoproduction discographique (Benhaïm, 2019), revendique parallèlement une liberté d’expérimentation bruitiste qui vise à favoriser l’expressivité potentielle de chaque individu en brouillant les frontières entre artistes et non-artistes. Elle est aussi influencée par leurs pratiques musicales qui, au-delà d’une caractérisation immédiate par le recours au bruit, à l’improvisation et au collage sonore, se fondent sur des bricolages instrumentaux – quand paradoxalement, le précepte DIY ne s’applique pas à ce domaine dans le mouvement punk. Ainsi observe-t-on dans la noise une intrication globale des ressources créatives et économiques qui relèvent du DIY et se revendiquent d’une autonomie et d’une autodidaxie non sans lien avec l’éthique hacker, qui défend pour sa part la « volonté de créer et de partager en se défaisant des contraintes imposées par le marché, la rentabilité, le droit de propriété » (Lallement, 2015 : 12). Les pratiques et les manières de faire sont de ce point de vue le point de jonction le plus manifeste : au sein de l’éventail des gestes instrumentaux relatifs à l’expérimentation bruitiste – bidouiller, détourner, bricoler, une terminologie qui a d’ailleurs pour particularité de s’appliquer aux pratiques de jeu autant qu’à la conception personnalisée du dispositif instrumental – se trouve ainsi une forme de hacking non pas pris au sens plus restreint de « piratage » apparenté au monde informatique, mais redéfini à l’aune des pratiques DIY dans une optique bricoleuse, low-tech et imprégnée des principes de recyclage et d’apprentissage autonome. En plus de constituer une instrumentation 19 Sarah Benhaïm Figure 1 : Dispositif instrumental d’Arnaud Rivière. © Juan Saez. en termes de sécurité, il peut aussi être conçu de manière plus vaste dans un cadre créatif associé à la mouvance DIY – pensons à l’exemple populaire du « Ikea Hack ». Il s’agit pour ce type de pratiques de bricoler et de détourner des objets afin de leur faire assurer d’autres fonctions que celles pour lesquelles ils étaient destinés au départ. Le terme français de « bidouille », consonnant avec la première acception du hacking comme d’une expérimentation étroitement liée au plaisir et à l’innovation, est d’ailleurs intimement liée à la notion de bricolage. La musique est un domaine privilégié de cette bidouille bricoleuse, dont l’improvisateur Arnaud Rivière 2 fournit un témoignage détaillé. « J’ai pas mal bricolé en cherchant un instrumentarium adapté à ce que j’avais envie de faire […]. Je suis resté avec cette table de mixage préparée, vu que j’avais pas les moyens de m’offrir un synthétiseur analogique. Donc vraiment une sorte de synthétiseur du pauvre. [...] j’ai réduit cet outillage-là avec quelques capteurs en plus. [...] Et je suis tombé dans une brocante sur un petit tourne-disque. [...] Aujourd’hui je joue soit avec la batterie électronique bricolée – [...], il y a cinq pads un peu mal foutus [...] – puis je la passe dans une mixette numérique, donc de la distorsion numérique qui a un grain assez particulier. […] Soit il y a le tourne-disque qui devient un instrument complet une fois placé dans une caisse en métal, car ça fait caisse de résonance. [...] une fois que j’ai pété trois ou quatre fois les bras en plastique et que je me suis construit des bras en aluminium dessus, j’ai pu coller d’autres capteurs et faire passer le circuit différemment dans la carte de pré-amplification. […] L’électrophone avec la table de mixage me permettent de mélanger les sources mais aussi d’avoir ces histoires de feedback. Il y a des tiges de métal qui sont dans certains input dans 20 2 Âgé de 36 ans au moment de l’enquête, le musicien et graphiste Arnaud Rivière est aussi co-organisateur actif du festival Sonic Protest. lesquels je remets de l’électricité et qui du coup permettent une sorte de synthèse sonore abstraite ; trois capteurs ; et j’ai un circuit de traitement qui fait de l’equalization et de la DIY et hacking dans la musique noise… 16 1 distorsion. C’est vraiment très rudimentaire. […] Comme d’outils et de matières –, et une probable débrouillardise, il y a un truc électrique sur la table de mixage, je rajoutais une capacité à “faire du neuf avec du vieux” (2010 : 7). [...] 48V en plus parce que je trouvais ça rigolo, ça faisait des Le bricoleur est un adepte de la flexibilité fonctionnelle ; il matières sonores. Sauf que ça a fait cramer les tables de lit l’objet, non dans son état présent, mais dans son état mixage et je me prenais des châtaignes dans les dents. Mais possible. Il conserve cette chose pour qu’elle devienne, non je n’ai pas de connaissance technique, je sais pas que peut-être, autre chose (2010, 15). » tel composant et tel composant on les met ensemble [...]. En termes de fabrication, je préfère prendre des trucs et les modifier pour mon usage. Ça c’est pas compliqué, il y a pas besoin de pré-requis technique pour y arriver. C’est plus du bricolage que de la construction. » Cet extrait d’entretien rend compte de cette intrication entre expérimentation et hacking à travers le bricolage généralisé du dispositif, dont les éléments sont ici recyclés et réparés par le musicien lui-même lorsqu’ils ne sont pas tout bonnement détournés de leur fonction première. Comme l’analysent Odin et Thuderoz, « “Bricoler” qualifie à la fois, et la réutilisation d’objets usagés – ou la combinaison réversible d’un stock limité Cette capacité créative à entrevoir le détournement des fonctionnalités d’un objet ouvre pour la musique un univers de potentialités qui permet au bricolage d’œuvrer en recyclage. Beaucoup d’artistes de noise privilégient l’achat de matériel d’occasion ou parcourent les brocantes à la recherche du moindre objet potentiellement utilisable à des fins musicales, notamment des petits claviers pour enfants. Une flexibilité bricoleuse qui résonne étroitement avec le glanage, ainsi que le souligne cette formule du musicien : « je fais ça un peu selon ce que je trouve. » Les ressorts de ce hacking renvoient directement à la question de la low-tech et de l’alternative choisie en termes de choix technologique : une Article Figure 2 : Dispositif instrumental d’Arnaud Rivière. © Magouka. 21 Sarah Benhaïm 22 part considérable de la genèse du dispositif découle en effet du contournement des coûts que suscite l’acquisition d’un synthétiseur analogique et d’une batterie. Une table de mixage préparée devient alors le « synthétiseur du pauvre » et les cinq pads « un peu mal foutus » adoptent les fonctionnalités d’une batterie. La généalogie du dispositif, qui demande de porter attention à la construction progressive de réponses et d’astuces aux problématiques matérielles ainsi qu’à l’ingéniosité bricoleuse qu’elle sous-tend, révèle une approche low-tech qui consiste à reprendre les fonctionnalités d’instruments industriels et professionnellement manufacturés en rendant le dispositif unique et personnalisé. En d’autres termes, il s’agit ici de faire preuve de capacité à innover en expérimentant avec les objets, tour à tour transformés, combinés, détournés et créés à partir de rien ; une pratique qui s’apparente aux « contournements créatifs 3 » décrits par le sociologue Morgan Meyer (2012) au sujet de la « biologie de garage ». Ces « façons inventives de travailler sans matériaux conventionnels et coûteux » (Meyer, 2012 : 319) sont en effet dans la noise une signature puissante de l’élaboration du dispositif de jeu, qui aspire à l’ingéniosité, à la créativité et à l’autonomie caractéristique de l’éthos DIY, tout en démystifiant les conventions de la pratique musicienne. Si le détournement bricoleur des médiums de lecture et d’enregistrement traduit déjà l’idée d’un mésusage possible des outils à des fins musicales, la pratique du circuit-bending constitue elle aussi un élément phare des musiques bruitistes en s’apparentant au hacking à travers l’exploitation des failles matérielles de l’objet. Elle consiste, pour générer de nouveaux sons, à court-circuiter des instruments électroniques de faible tension électrique ; un matériel qui relève souvent du hardware analogique, réputé pour être plus aisément manipulable et intuitif pour les novices. Evil Moisture 4 , qui expérimente depuis 26 ans à partir d’un dispositif évolutif composé d’un bric-à-brac de machines, est l’un des pionniers de cette pratique. Fasciné depuis l’enfance par l’archétype du scientifique fou et du laboratoire expérimental, son univers teinté de gore, de monstruosité et de pornographie s’accompagne d’une pluralité de techniques de collage, de bandes, d’enregistrements mais aussi de nombreuses manipulations d’interrupteurs, de switches et de circuits électroniques. « Vraiment, je n’y connais rien là-dedans, j’ai de la chance et c’est tout », me confie-t-il, tandis qu’il précise avoir malgré tout tenté d’apprendre en 1990 quelques bases en électronique à l’aide d’ouvrages spécialisés. Le musicien Popol Gluant 5 déclare pour sa part : 3 Cette expression (« creative workarounds ») est empruntée à Heidi Ledford. 5 Âgé de 30 ans au moment de l’enquête, Hendrik vit de ses dessins et des minimas sociaux. « J’ai déjà désossé un lecteur cassette, ça marchait très bien. Juste par la position des doigts, les circuits produisaient des bruits. Avec une cassette, ça distordait le son. J’enlevais les vis et j’ouvrais la boîte en plastique. C’étaient des sons assez puissants, assez gras, avec du corps. [...] Je n’ai aucune base technique. Ça m’intéresserait mais je suis trop feignant, trop de bases techniques... Je me suis déjà pris du jus, faut pas le sortir totalement de la carcasse, faut pas toucher certains endroits, il faut être prudent. » 4 Anglais d’origine, Andy Bolus s’est d’abord illustré à Londres avant d’arriver à Paris et d’occuper le célèbre squat de La Miroiterie, actif de 2000 à 2012. DIY et hacking dans la musique noise… Figure 3 : Appareils bendés et DIY d’Evil Moisture. Photographies libres de droit (prises par le musicien luimême, partagées sur son site internet et communiquées ici avec son accord). 16 1 6 Il faut reconnaître l’équivocité de la notion d’« amateur » qui, dans une qualification péjorative pensée à l’opposé de la rigueur attachée au professionnalisme, est souvent associée à l’incompétence. Selon Antoine Hennion, la figure de l’amateur entretient pourtant une réelle réflexivité sur ses pratiques, ses goûts et ses « attachements » – un terme utilisé pour les relations et les expériences, qui suppose de rompre l’opposition entre ce qui vient de l’extérieur et l’interaction en insistant sur la capacité à co-produire (2004). Plus généralement, le courant pragmatique de la sociologie a apporté puissante imprègne les récits et genèses des gestes et des dispositifs. de nombreuses nuances à la disqualification de l’amateur dans le sens commun, en réhabilitant notamment le rôle actif de cette figure à travers un « faire » qui repose sur des médiations avec des instruments, des communautés, des confrontations et des passions. Olivier Assouly écrit ainsi, au sein d’un ouvrage collectif qui vise à dresser un portrait complexe de l’amateur, entre production et consommation : « À la différence du connaisseur qui exerce son jugement en fonction d’une qualification que sanctionnent expressément des connaissances, notamment à l’instar de l’expert, l’amateur cultive son dilettantisme. Il ne s’autorise qu’en vertu de lui-même, au fil d’une construction du savoir qui échapperait aux itinéraires scolaire et académique. Il aime les objets, non pas en théorie, pas davantage sous la forme de représentations, mais dans des expériences répétées et différenciées qui sont autant d’entraînements et d’exercices, voire de bricolages […]. » (2010 : 9-10) Article De nombreux liens peuvent être esquissés entre les pratiques de bricolage précédemment exposées et le circuit-bending. D’une part, parce que se manifestent également un recyclage massif des interrupteurs et potentiomètres utilisés, ainsi qu’une forme d’assemblage astucieux des divers boîtiers ; d’autre part, parce qu’une dimension amateure 6 23 Sarah Benhaïm 24 Si Arnaud Rivière reconnaît à plusieurs reprises que le bricolage auquel il procède ne suppose aucune connaissance théorique ni aucun pré-requis technique, il exemplifie de manière emblématique une figure de musicien-bricoleur plus ambivalente. Contrairement à certaines représentations du sens commun qui tendent à concevoir le hacker comme un génie expert de techniques obscures, ce type de pratiques, commun dans les musiques noise et improvisées, relève d’une démarche ludique et amateure entièrement tournée vers l’expérimentation. Cela suppose de passer par un apprentissage composé d’erreurs, de risques mais aussi de trouvailles : si les aventures malheureuses du musicien avec l’électricité ont eu pour conséquence d’abîmer le matériel et de provoquer des décharges, elles ont dans le même temps été la source de nouvelles sonorités, résultant d’une recherche propre à la démarche expérimentale du musicien. Comme le suggèrent Popol Gluant et Evil Moisture, la « chance » semble en outre largement intervenir dans la pratique du circuit-bending, puisque demeure le risque que les courts-circuits grillent l’appareil ; mais ici aussi, l’expérience et la connaissance intuitive sont bien ce qui permet d’identifier plus précisément les endroits où réaliser les courts-circuits et couper les fils. Même si la pratique n’est pas exempte de risques, le jeu repose en effet sur une expérimentation « hackeuse » qui fait acte, au travers du geste, du processus de recherche lui-même. Comme le montre par ailleurs l’expérience de ces musiciens, qui partagent occasionnellement leurs connaissances à l’occasion d’ateliers, l’expérimentation autodidacte du bricolage et de l’électricité implique de progressivement gagner en habileté jusqu’à intégrer des bases en électronique et des savoir-faire spécifiques. En somme, le hacking de bricolage et de détournement, s’il est pleinement associé à la culture amateure revendiquée par les musiques DIY, constitue parallèlement une voie d’apprentissage expérimentale et autodidacte qui, nous le verrons, complexifie la notion de compétence. Le circuit court du court-circuit. Le DIY comme apprentissage et partage des ressources Tandis que beaucoup procèdent par tâtonnement lorsqu’il s’agit de modifier et de détourner les éléments de leur dispositif, d’autres décident de se lancer dans l’aventure de la fabrication intégrale d’un synthétiseur ou d’un générateur de sons. La motivation initiale résulte souvent d’une curiosité que suscite l’univers de l’électronique et de ses potentialités sonores, en résonance avec l’attrait que porte la noise envers la singularité des textures bruitistes. À la différence du hacking bricoleur évoqué précédemment, la fabrication DIY de machines électroniques exige de passer par un apprentissage plus technique et de faire usage de patience, ce qui ne correspond pas à l’ensemble des profils, bien que la pratique soit répandue. Ne disposant en amont d’aucune compétence en électronique – les électroniciens « Je me lance dans le DIY, je fais des modules pour mon système modulaire. J’achète des circuits imprimés sur Internet, parce que je ne suis pas assez bon électronicien, modules sous Arduino 8, vu que ça reste basé sur une puce programmable. » (Fusiller 9) Cet élan en faveur de l’apprentissage autodidacte s’inscrit dans un mouvement contemporain et global de démocratisation des compétences étroitement lié aux nouvelles possibilités offertes par Internet et les technologies numériques. Patrice Flichy (2010 : 10-11) déclare ainsi : puis j’achète ailleurs tous les composants électroniques. Je « La démocratisation des compétences repose soude et je branche. Je choisis et je regarde sur Internet, d’abord sur l’accroissement du niveau moyen de connais- où il y a une grosse communauté DIY [...] : ils font leurs sances (dû notamment à l’allongement de la scolarité) et sur propres systèmes modulaires, il y en a qui ont des murs la possibilité offerte par Internet de faire circuler les savoirs, entiers de trucs qu’ils ont fait eux-mêmes. Et comme c’est de livrer son opinion à un public plus vaste. L’amateur qui une communauté DIY, ils aiment faire partager ce qu’ils ont fait. » (Fred Nipi 7) apparaît aujourd’hui à la faveur des techniques numériques y DIY et hacking dans la musique noise… et électroniciennes de formation étant rares au sein de la scène noise, sinon absents – les artistes font la démarche d’apprendre les bases techniques de manière autodidacte en consultant les ouvrages spécialisés et les forums Internet liés à la communauté « DIY hardware ». ajoute la volonté d’acquérir et d’améliorer des compétences dans tel ou tel domaine. Il ne cherche pas à se substituer à 1 l’expert professionnel ni même agir comme un profession- base en électronique avant de commencer à bidouiller. En nel ; il développe plutôt une « expertise ordinaire », acquise gros, je n’avais pas touché un fer à souder depuis le collège par l’expérience, qui lui permet de réaliser, pendant son en cours de techno. Pour démarrer, j’ai fouillé sur Internet, temps libre, des activités qu’il aime et qu’il a choisies […]. sur le forum Electro-Music. J’ai acheté, en 2012 ou 2013 [...] Son expertise est acquise peu à peu, jour après jour, par la le bouquin Homemade Electronic Music de Nicolas Collins. pratique et l’expérience. » J’ai la deuxième édition et ça reste une bible, de par la concentration d’idées [...] et la pédagogie. J’ai téléchargé des PDF et des schémas à gogo... Le pas décisif, c’est lorsque tu achètes pour la première fois des composants et surtout une plaque d’expérimentation sans soudure. Là Cette « expertise ordinaire » acquise par l’expérience est aussi tributaire de ces alternatives à la formation scolaire et professionnelle que constituent les guides DIY, ces tu démarres un rituel infini d’essais/erreurs au kilomètre et tu avances petit à petit. Sans pour autant toujours savoir comment ça fonctionne, mais bon, tant que ça te plait, c’est accessoire. Le fait d’avoir fait de l’informatique a par contre sûrement été utile lorsque j’ai commencé à développer des 7 Âgé de 41 ans au moment de l’enquête, Fred vit de sa profession de technicien au CNAM. 8 Arduino est une plateforme électronique sur laquelle se trouve un microcontrôleur programmable en langage C++. Elle peut être utilisée pour l’élaboration d’objets interactifs indépendants ou être reliée à un ordinateur en communication avec des logiciels tels que Max/MSP ou SuperCollider. Le design matériel et le schéma des cartes sont distribués sous licence libre. 9 Âgé de 32 ans au moment de l’enquête, Jo Tanz est acousticien et dirige un label DIY de musique expérimentale. Article 16 « J’ai une formation scientifique mais je n’avais aucune 25 Sarah Benhaïm 26 « ressources pour développer l’autonomie de la communauté et favoriser l’entraide entre ses membres » (Hein, 2012 : 78), qui permettent aux novices de pouvoir, s’ils le désirent, suivre des schémas en vue de réaliser quelques modèlestypes. Internet fournit en effet un espace ouvert où la médiation s’élabore de manière alternative, par la mise à disposition en accès libre des schémas nécessaires à l’élaboration d’un instrument électronique, ainsi que par les forums spécialisés où experts et passionnés répondent aux questions pratiques des novices. Les internautes y vulgarisent les fondamentaux techniques nécessaires à la compréhension de l’électronique et expliquent les subtilités de leurs propres réalisations. Comme l’écrit Meyer (2012), ce modèle de co-production du savoir permet des collaborations entre spécialistes et profanes qui interrogent l’exclusivité de l’engagement dans les travaux de recherche des seuls experts. L’éthique associée à la culture DIY défend en effet une horizontalité des savoirs et des pratiques qui ne peut se manifester que par l’autonomisation de l’individu, ce qui explique l’ensemble des dispositifs mis en place par la communauté pour encourager l’autodidaxie. Souvent plébiscitée comme étant un lieu démocratique d’échange de connaissances, l’électronique DIY entretient de nombreuses porosités avec le domaine de l’open source, en particulier, si l’on se réfère à la définition proposée par Crémer & Gaudeul (2004), à travers les principes non-négociables d’ouverture, de modification, de libre circulation et distribution des biens 10 . Plus encore, ces manières de 10 Bien que cela puisse paraître paradoxal d’un point de vue extérieur, l’éthique open source n’est pas incompatible avec la recherche de personnalisation individuelle de l’instrumentation, faire ont pris une ampleur considérable avec le mouvement open science, qui, écrit Michel Lallement au sujet d’un laboratoire de biologie communautaire, vise à « ouvrir la boîte noire des savoirs » et à « travailler à la prospérité pour tous sur la base de technologies distribuées et décentralisées », qui doivent être modifiables selon le besoin des utilisateurs (2015 : 390). Il s’agit donc ici du collectif, constitué d’un réseau communautaire poreux composé de makers, d’artistes et de libristes, qui a pour vocation d’encourager les initiatives individuelles qui s’inscrivent elles-mêmes et en retour au cœur d’un réseau qui revendique ou valorise l’éthique portée par le DIY. En outre, les amateur-e-s de musiques bruitistes organisent et fréquentent ponctuellement des ateliers didactiques qui visent à transmettre savoirs et techniques pour fabriquer des instruments ou s’initier au circuit-bending. Le phénomène s’est notamment développé à partir des années 2010, au moment où des initiatives parisiennes telles que le projet Lutherie Urbaine de Thierry Madiot ou les ateliers organisés à la librairie Monte-en-l’Air, au squat de la Miroiterie et au lycée autogéré ont vu le jour. Il en va de même pour l’association BrutPop, qui développe à l’échelle nationale des ateliers de pratique et de création d’instruments avec un public autiste ou en situation de handicap psychique. La salle montreuilloise des Instants Chavirés, spécialisée dans la diffusion des musiques expérimentales, est commune dans l’univers de l’électronique DIY. La logique repose sur le fait d’apporter au plus grand nombre des ressources techniques et scientifiques fondamentales (plans, schémas et modules standards) à des fins d’appropriation et de modification, selon une visée émancipatoire individuelle et collective. 1 « Le DIY, c’est aussi un moyen de faire des économies par rapport au prix des instruments de musique et puis d’évoluer : donc là, un mois j’achète les circuits imprimés, un mois les composants électroniques, puis un autre mois tous les boutons... Ça fait une sorte de crédit ! C’est intéressant de faire soi-même son instrument. Puis on ne dépend pas des grands fabricants... » (Fred Nipi) « Il faut avouer que d’un point de vue économique, ça me semblait plus cohérent. En fait, tout me paraissait cher en comparaison de l’usage que je risquais d’en faire. Par exemple, ma table de mixage est une entrée de gamme donc je n’ai eu aucun scrupule à lui faire subir très rapidement des larsens de table. Mais si j’ai un Moog à 2 000 € dans les mains, hors de question de risquer de cramer la bête ! Pareil pour les modifications potentielles. Une fois qu’on s’est un peu penché sur ce qu’il y a à l’intérieur des machines, on s’aperçoit que la valeur réelle des composants de certains synthétiseurs, générateurs ou effets, est bien inférieure au prix de vente. Vraiment bien inférieure. Et ça n’est pas toujours justifié. » (Fusiller) Les témoignages soulignent l’intérêt économique de la démarche DIY, qui permet d’acheter les composants selon les besoins réels sans la marge de bénéfices réalisée par les grands groupes puis par les revendeurs, rendant le prix des synthétiseurs plus Article 16 également à l’initiative de nombreux ateliers DIY ayant donné lieu à des restitutions sous forme d’improvisations sonores collectives et même parfois à des créations de groupes plus pérennes, tel que Le bruit vient de la cuisine, à la suite des ateliers du Système B. Si la fréquentation de fablabs ne fait que peu partie de leurs pratiques, ces ateliers véhiculent, à leur image, « les principes de partage de connaissances, d’accès et de mise en commun [qui] sont souvent compris comme des valeurs transposables à tous les champs de l’activité humaine » (Bosqué, 2015 : 66), dont l’univers musical ne constitue ici qu’une variante de ce mouvement social croissant. Par ailleurs, l’intérêt économique de ces initiatives, s’il ne constitue pas la première motivation, ne doit pas être minimisé : au-delà de la valorisation du recyclage, la fabrication DIY d’un instrument électronique constitue une alternative économique substantielle au regard des solutions industrielles. DIY et hacking dans la musique noise… Figures 4 et 5 : Synthétiseurs DIY de Fusiller, © Sonic Protest (4 avril 2015, Centre Barbara FGO, Paris). 27 Sarah Benhaïm accessible qu’à l’accoutumée. L’acquisition des compétences est donc vécue à la fois comme une réappropriation des ressources et comme un enjeu économique considérable qui a pour effet de limiter au maximum le nombre d’intermédiaires. Cette démarche anti-consumériste proche de l’idée de circuit court résonne ainsi étroitement avec l’éthos du DIY, puisqu’il s’agit en réalité d’encourager les individus à autonomiser leur pratique et à s’émanciper au maximum des transactions et des relations de dépendance à l’égard du marché des instruments de musique. Singularisation et sérendipité du dispositif. De nouveaux horizons de jeu 28 En incitant les individus à confectionner et à hacker leurs instruments, le DIY donne lieu à une pléthore de manières de faire individualisées qui rompent avec l’uniformité supposée de l’industrie de la musique. Comme l’exemplifie le témoignage précédent, la valeur matérielle des instruments est en premier lieu reconsidérée : en utilisant du matériel bas de gamme, les artistes peuvent les détourner de manière plus décomplexée, ou les utiliser comme base du travail bricoleur. Il apparaît ainsi que le modèle de l’instrument de musique de belle facture ou de marque réputée est ici désacralisé au profit d’une valorisation de l’hybridité et de l’accessibilité économique, l’instrument-augmenté devenant le lieu même d’expérimentations. Plus globalement, dans un tel paradigme, les propriétés et les formes instrumentales industrielles ne sont plus des standards déterminants. Personnalisée selon les aspirations musicales de chaque artiste, la confection électronique DIY est en effet appréhendée comme un gage de liberté quant aux choix des effets, des textures et des combinaisons sonores à adopter. Un enthousiasme exprimé, par exemple, par Aaron Dilloway dans une interview parue dans le fanzine Special Interests, au sujet d’une machine réalisée par l’un de ses amis. « Je n’ai pas la capacité ni la patience de modifier moi-même mon matériel, mais je suis assez chanceux d’avoir quelques amis qui sont très forts dans ce genre de chose et qui m’ont aidé à réaliser certaines de mes idées. En ce moment mon pote Bbob Drake travaille pour moi sur un magnétophone à bandes auquel j’ai rêvé ces dix dernières années. J’ai élaboré des plans, discuté avec lui sur ce que je voulais et avais besoin de faire, puis il m’a montré ce qui était possible avec les outils avec lesquels on travaille. Lorsque cette machine sera terminée, je serai capable de créer le travail de bande en live le plus taré que j’ai jamais fait. » (Aspa, 2010 : 44) L’originalité des sons ou des fonctionnalités allant souvent de pair avec la singularité de l’instrumentarium, la perspective de jouer avec une machine personnalisée amène des horizons de jeu appréhendés comme inédits, au moins en termes d’expérience individuelle. De plus, lorsque la relative « maîtrise » du fonctionnement électronique permet de réaliser des tests en dehors des schémas prédéfinis, la fabrication autonome permet d’obtenir un résultat souvent inattendu mais apprécié des adeptes de l’improvisation. où on se dirigeait au départ. On se retrouve toujours avec des modes de jeu ou des sonorités qu’on ne cherchait pas. [...] Après on va pas se leurrer, des professionnels ont certainement déjà découvert toutes ces pseudo-innovations empiriques par le passé. Et ils les ont même surement souvent intégrées à leurs produits. Mais bon quand tu trouves ça dans ton salon, tu as au moins le plaisir d’être surpris ! Et puis lorsque tu trouves un son assez sale ou un mode de jeu ingérable, tu le conserves plus volontairement que si tu devais rendre des comptes au PDG de Korg. Lorsque je développe une machine, il y a aussi un moment où je me retrouve à considérer les aspects ergonomiques. […] Est-ce que je veux réduire la taille, pouvoir faire en sorte de faire communiquer mes modules entre eux, fermer le design ou le conserver plus ou moins modulable, etc. […] Donc tu te retrouves encore face au côté aléatoire de l’amateurisme total, contraint à des utilisations détournées ou finalement 16 1 différentes de l’idée initiale. [...] On peut dire que ça fait partie du charme de la chose, même si parfois ces restrictions à moitié volontaires peuvent devenir assez problématiques ou contraignantes. [...] Et là j’avoue que fabriquer ses machines présente un avantage non négligeable. Parce que ça reste souvent bien plus facile de modifier ou de mettre à jour quelque chose que l’on a développé soi-même, surtout sous Arduino. » (Fusiller) Ce sentiment d’émancipation à l’égard du matériel fabriqué en masse – « pas besoin de rendre des comptes à Korg » – tient au libre choix de fonctionnalités qui peuvent diverger de ceux que mettent en œuvre les industriels, même si ces derniers, loin de tous demeurer indifférents à ce mouvement hacker, se sont parfois adaptés à la demande en « ouvrant » davantage leurs machines 11. 11 Il est intéressant d’observer que ces dernières années, un industriel comme Korg a partiellement ouvert ses machines de façon à ce qu’elles puissent être hackées. Tandis que ce choix pourrait à première vue sembler paradoxal, il s’agit en réalité de prendre acte de pratiques DIY de plus en plus répandues pour s’insérer sur ce nouveau marché et rattraper au vol des clients et clientes qui pourraient définitivement se détourner des firmes commerciales. En somme, une stratégie et des aménagements néomanagériaux qui visent à vaincre les critiques qui lui sont adressées par une récupération des pratiques, tout en renforçant l’accumulation capitaliste, soit un symptôme emblématique du nouvel esprit du capitalisme (Boltanski & Chiapello, 2011). DIY et hacking dans la musique noise… si on suit un plan précis, le résultat se situe [...] rarement là La compréhension électronique et ergonomique de l’objet favorise en effet un débridage des possibilités techniques et d’éventuelles modifications par l’artiste selon sa propre logique de création – la nature bruitiste de certains sons ainsi que les modes de jeu incontrôlables étant, dans le cas de la musique noise, plus volontiers choisis. Ce type d’expérimentation mené autour des circuits imprimés, qui se nourrit d’astuces partagées et de savoir ésotérique, s’insère dans la continuité d’une histoire plus vaste des pratiques sociales liées au bricolage qu’exemplifie d’ailleurs de manière significative le concept de « débridage » : peu importe l’objet industriel sur lequel il s’applique et l’univers social auquel il se rapporte – pensons par exemple au bricolage des motos que rapporte avec passion Matthew Crawford (2010) –, il existe une proximité entre ces pratiques qui renvoie à une sociologie du bricolage entre soi et à l’échange de savoir-faire. La quête d’autonomisation individuelle, emblématique du principe du DIY, se manifeste effectivement par le biais d’une capacité d’action dans l’apprentissage qui n’est pas sans lien, dans l’électronique comme dans d’autres secteurs, avec la singularisation et l’optimisation. À l’instar Article « Lorsqu’on fabrique soi-même quelque chose, à part 29 Sarah Benhaïm des adeptes des logiciels libres du monde informatique, il existe en effet dans le DIY électronique une disposition à l’économie plutôt qu’une tendance à la surenchère de consommation matérielle. Comme l’écrit Gaël Depoorter, « pour les libristes, l’ordinateur n’est pas une “boîte noire enchantée” à partir de laquelle il faudrait s’adapter par fascination et incompétence, mais bien plutôt une ressource, un ustensile qu’il convient de modeler, paramétrer, bricoler soi-même pour qu’il réponde à ses propres besoins. » (2013 : 151) 30 L’idée n’est donc plus de s’adapter à l’outil, ici l’instrument de musique, mais d’instrumenter les ressources au service d’une singularité musicale. Il s’agit en effet de considérer que selon le bricolage effectué, les connexions des composants ou les options programmées via une plateforme de prototypage, les combinaisons et les sonorités produites imprègnent l’univers musical de l’artiste. Cette construction du style fonctionne par ailleurs dans les deux sens : il n’est pas seulement question de réaliser des machines sur mesure à l’image de ses projections mentales, en visant quelque résultat sonore potentiel ; un univers bruitiste singulier s’élabore principalement à partir de l’apprivoisement du geste et des possibilités matérielles, via le jeu expérimental sur l’instrumentation. L’observation des pratiques révèle que cette appropriation des ressources ne se fait pas toujours dans les règles de l’art (ou plutôt, dans les règles de la science). Comme l’évoque précisément le témoignage de Fusiller, ces nouvelles sonorités sont tout autant anticipées qu’elles résultent d’erreurs et de contraintes, une conséquence réelle des limites du matériel et du niveau de connaissance en électronique. Les « règles » de l’électronique DIY édictées non sans humour par Nicolas Collins ne font d’ailleurs pas secret du caractère parfois opaque et aléatoire de cette pratique : « de nombreux hacks sont comme les papillons : beaux mais éphémères » ; « en électronique certaines choses sont réversibles avec des résultats intéressants, mais certaines choses sont réversibles seulement avec des résultats irréversibles » ; ou « si ça sonne bien et que ça ne fume pas, ne t’inquiète pas si tu ne comprends pas » (2006 : 225). À cette complexité scientifique se juxtapose en outre l’intuitivité de l’expérimentation. En conditionnant le dispositif et en modifiant les modes de jeu, les nouvelles fonctionnalités sonores imprègnent l’expérimentation à travers un mélange de contrôle et d’aléatoire qui participe plus largement à une conception « noise » du dispositif. Ewa Justka 12 déclare, lors d’un entretien retranscrit dans la revue polonaise Glissando : « Le domaine DIY comprend une large dose d’intuition. Sans cela, il serait très difficile de sculpter quoi que ce soit. Le processus est souvent fondé sur le fait d’agir selon l’intuition, qui n’est pas basée sur les schémas électroniques. C’est souvent une chance, parce que c’est exactement ce qu’est le bruit – une erreur, quelque chose de non désiré. À travers les erreurs je découvre quelque chose de nouveau, de différent. » (Citée par Lewandowska, 2014 : 143). La musicienne met ici en lumière l’intuitivité de jeu qui découle d’une instrumentation hackée et DIY, dont la disposition 12 Ewa Justka est une musicienne polonaise qui réside à Londres. Elle anime de nombreux ateliers sur le DIY électronique. DIY et hacking dans la musique noise… 16 1 aux bruits est souvent connectée à la manifestation inattendue de la conception et des effets de l’électronique. La sérendipité se manifeste ainsi autant sous les traits d’une conséquence fortuite que d’une recherche consciente, le plaisir de l’invention et de la survenance des phénomènes sonores étant à la fois corrélé au caractère expérimental de la musique et à l’amateurisme qui résulte parfois du DIY. Il convient en effet de considérer que l’indétermination induite par le fait de ne pas être en mesure de prévoir (ou alors de manière limitée) les sons produits par ces bricolages, est en réalité l’une des composantes d’un paradigme esthétique de l’échec 13 , ainsi qu’a par exemple pu l’étudier 13 Pour un vaste panorama des musiques développant une esthétique de l’échec à partir de processus comme l’ennui/attente, la laideur, l’informe et l’absurde, voir l’ouvrage Boring Formless Caleb Kelly (2009) à partir des médiums de lecture détournés. Si elle agissait déjà en tant que condition possible de l’expérimentation dans la tradition musicale d’avant-garde, elle apparaît dans la musique noise – à l’instar d’autres esthétiques musicales contemporaines comme le glitch – sous une forme particulièrement radicale qui met au premier plan les « parasites » bruitistes. En somme, pratiques et matériau musical articulent ici une conception intégrative du monde sonore qui questionne ontologiquement le bruit, en plus de mobiliser une esthétique de l’indésirable, du rebut, du non-contrôle et de l’inconfort qui imprègne plus globalement le genre (Benhaïm, 2018 ; Guesde & Nadrigny, 2018 ; Hainge, 2013 ; Hegarty, 2007). Nonsense. Experimental Music and the Aesthetics of Failure d’Eldritch Priest (2013). Article Figure 6 : Créations DIY d’Ewa Justka. Photographie extraite d’une vidéo de Natalia Ambroziak (28 août 2014). 31 Sarah Benhaïm La fierté et le savoir par le « faire » Il apparaît que la fabrication autonome du matériel est en réalité chargée d’un fort capital symbolique à travers la valorisation de la créativité de l’individu. Le premier intérêt que les musiciens et musiciennes mentionnent au sujet des pratiques DIY est le plaisir et la fierté d’avoir réalisé un instrument à partir de rien. Au contraire des machines standardisées, les instruments inventés portent la singularité des individus qui les ont réalisés et, résultant d’une recherche sonore extensive, ils s’apparentent à des œuvres d’art. À en juger par les réactions que manifeste le public lors des concerts de musiques bruitistes, le matériel de jeu personnalisé suscite beaucoup de curiosité et d’admiration, un engouement qui doit évidemment être évalué en regard des conventions habituelles d’instrumentation, ainsi que le souligne Karin Weissenbrunner : « Dans une culture envahie par des biens de consommation produits en masse et par des techniques de copier/ dispositif mais aussi, par effet de miroir, son identité d’artiste. En effet, les technologies constituent bel et bien une forme de signature de l’éthos et des valeurs privilégiées que sont ici la singularité, l’individualité et l’originalité. Le handmade, qui porte au premier plan la créativité individuelle, représente une alternative aux formes standardisées qu’incarnent les technologies industrielles et les classifications organologiques conventionnelles. En rompant avec l’ergonomie, les fonctions et les modalités d’apprentissage codifiées qui fondent les conventions instrumentales, ces technologies arborent de nouvelles possibilités qui modifient notre conception de la musique mais aussi du « faire musique ». Lorsqu’il ne s’agit pas d’une conception handmade mais de pratiques de recyclage et de feedbacks, c’est alors l’assemblage des divers éléments du dispositif et leurs connexions qui importent : à cette plastique sonore modulable qui signe l’identité musicale se mêle ainsi la distinction que vaut la reconnaissance de la créativité de l’artiste 14 . Outre le capital symbolique porté par de telles réalisations, se manifeste aussi le développement de capacités personnelles à coller, les mouvements de recyclage et de sampling dans la musique opposent l’individualité et l’originalité aux problèmes de reproduction et de copie. L’électronique handmade, qui relie le simple matériel au son, apporte un contrepoint à l’éclat des outils technologiques conçus par la machine, tels que les ordinateurs, les smartphones, etc. » (2015) 32 Si l’apprentissage de l’électronique DIY implique de passer par une phase préalable de mimétisme via l’acquisition de ressources partagées (consultation de tutoriels standards, utilisation de circuits déjà imprimés, etc.), il permet aussi d’offrir rapidement de nouvelles compétences permettant de personnaliser son 14 Chaque dispositif a son propre agencement, qui conditionne sa propre « circulation » sonore et son propre son, au point que la mise en cohérence de cet ensemble est considérée comme un élément de première importance dans le style de l’artiste. Cette anecdote rapportée par David Novak en témoigne parfaitement : un musicien néophyte avait, lors d’un concert de Merzbow, filmé l’ensemble des éléments qui composaient son matériel et leur interconnexion spécifique, dans le but de se les procurer et de reproduire ensuite les connectiques à l’identique ; bien que l’usage qu’il fit du dispositif fut différent, il fut malgré tout l’objet de fortes critiques de la part des amateur-e-s qui reconnaissaient, dans la machine, le « spectre de Merzbow » (Novak, 2013 : 144). « Sérieusement, c’est un processus très complexe. J’ai commencé par un jeu intuitif avec les composants. Plus tard, j’ai commencé à vraiment m’intéresser au côté scientifique, c’est-à-dire à l’exploration de ce que contiennent les 16 1 composants, de ce qu’est la loi d’Ohm, de la manière dont circule un signal dans les circuits électriques, de la façon dont ont été créés les semi-conducteurs, de quoi est fait le circuit intégré et à quel point les équations de Maxwell sont étonnantes... » (Citée par Lewandowska, 2014 : 143) L’expérience rapportée par la musicienne montre comment la compétence se transforme elle-même au gré des essais et des expérimentations. L’approche intuitive de l’instrumentation se mue progressivement en une exploration scientifique, qui permet dès lors de réaliser ses propres schémas électroniques afin de concevoir des machines personnalisées. Le DIY, écrit Depoorter au sujet de l’informatique, incite en effet les individus « à (re)conquérir leur capacité d’action dans leur apprentissage et leur pratique de l’outil […], perceptible dans la valorisation de la figure de l’autodidacte » (2013 : 151). Cette extension des compétences individuelles suggère ainsi que Conclusion En prenant pour objet certaines pratiques de hacking qui composent l’éventail étendu de gestes caractéristiques de la musique noise, cet article a mis en exergue les démonstrations de bricolage, les expérimentations ludiques, les astuces et les accommodements, la visée ergonomique et la personnalisation de l’outil aux propres modalités de jeu des artistes, nous révélant par conséquent l’importance de l’amateurisme et de l’autodidaxie dans l’expérimentation bruitiste, à laquelle fait écho une certaine bienveillance à l’égard de la sérendipité et de la survenance de bruits parasites. Ces contournements créatifs, signes d’une inventivité qui émerge à partir d’une confection non-conventionnelle et financièrement accessible, épousent des valeurs hétérodoxes qui, en plus d’interroger la propriété intellectuelle et industrielle, contestent un conformisme et une uniformité ressentie des conventions instrumentales au travers d’un goût pour le « faire », pour l’originalité et pour l’anti-consumérisme modélisé par les pratiques de recyclage et de bricolage. Cette intuitivité que permettent l’expérimentation bruitiste et la confection d’un dispositif singulier est appréhendée par les artistes comme un ressort favorable à leur expressivité, et représente un levier non moins important en termes d’accessibilité à la pratique musicale. DIY et hacking dans la musique noise… l’artiste de noise n’est plus simplement un musicien, mais un expérimentateur proche des figures du bricoleur, voire de celle de l’ingénieur. L’autodidaxie du profane constitue en somme le moteur d’une acquisition de compétences scientifiques au service de sa créativité musicale et artistique. Article comprendre certains principes scientifiques et à intégrer plus généralement de nouvelles connaissances. Acquérant progressivement une compréhension du fonctionnement de l’électronique, les musiciens et musiciennes sont tentés de développer davantage leurs compétences et de découvrir leur appétence scientifique au fil de la pratique – même si une formation scientifique préalable peut sans aucun doute contribuer à appréhender plus en détails l’électronique en tant que système ou même à développer des aptitudes de programmation. Ewa Justka est elle-même passée par cette expérience : 33 Sarah Benhaïm 34 En plus de nous inviter à repenser les hiérarchies instrumentales et gestuelles, ces pratiques ont également mis en valeur l’inscription collective et communautaire de cette autodidaxie amateure au travers d’une circulation des valeurs et des ressources véhiculées par le Do it Yourself et par l’éthique hacker. À travers la transmission en libre accès de guides et de plans sur Internet, ou par l’intermédiaire d’échanges collectifs menés au cœur des ateliers DIY, l’éthique libriste prend la forme de pratiques concrètes de partage de savoir-faire qui offrent au musicien les outils de sa propre réappropriation de moyens d’action dans le processus créatif. L’initiative amateure typique de l’expérimentation bruitiste, d’une part, et la culture de mutualisation des ressources qui sous-tend le monde de l’instrumentation hackée, d’autre part, œuvrent de concert à créer des espaces potentiels où les artistes accèdent, par la suppression d’intermédiations traditionnelles – ici l’organologie conventionnelle et l’ingénierie acquise par le biais scolaire – à une plus forte autonomie. Selon Philippe Le Guern (2012 : 37), le paradigme change en effet dès lors que les outils de production ne sont plus inaccessibles : avec des usages et des technologies qui favorisent la polyvalence, le musicien s’extrait des contraintes de division des tâches et de spécialisation des activités, et retrouve la maîtrise du processus créatif dans son ensemble. Il apparaît de la sorte que le hacking et le DIY instrumentaux, s’ils se caractérisent par une conception expérimentale et autonome de l’art qui encense l’autodidaxie et la singularité, proposent plus généralement un modèle qui étiole à la fois les frontières entre experts et profanes par l’ouverture et la mutualisation des ressources, les frontières entre instruments conventionnels et sources sonores bricolées par des pratiques handmade, détournées et recyclées, et les frontières entre l’art et la science (ici électronique) par une acquisition de compétences qui tend vers une ingénierie visant à autonomiser sa pratique artistique. En tant que gestes et pratiques affiliés au registre de l’expérimentation, ils s’affirment en tant que manières de faire simultanément individualisées et connectées par des réseaux communautaires poreux, qui détonent visà-vis d’une industrie de la musique jugée trop uniforme. Le hacking comme le DIY officient donc comme une reconquête des moyens d’action dans l’apprentissage du point de vue de la création, source d’émancipation individuelle, mais aussi du point de vue de la musique elle-même, où la libération du code informatique prônée par les hackers pourrait, plus symboliquement, renvoyer à une libération des conventions musicales incarnée par la résurgence bruitiste. Plus largement, ce « bidouillage » qui caractérise la démarche d’expérimentation instrumentale de la noise apparaît en définitive comme l’une des nombreuses facettes d’une scène profondément imprégnée et gouvernée par le précepte d’action du DIY : entre autres, faire ce qu’il est possible de faire avec peu de ressources, créer du singulier à partir du rebut, jouer de la musique sans avoir jamais suivi d’enseignement spécifique, détourner les circuits conventionnels de l’industrie musicale en autoproduisant des cassettes, ou organiser des concerts dans des lieux éphémères souvent inappropriés pour des musiques à fort volume. Assouly Olivier (ed.) (2010), L’amateur. juger, participer et consommer, Paris, Institut français de la mode/Éditions du regard. Benhaïm Sarah (2018), « Aux marges du bruit. Une étude de la musique noise et du Do it Yourself », thèse de doctorat en Musique, histoire, société, EHESS. — (2019), « Noise records as noise culture : DIY practices, aesthetics and trades », in Bennett Andy & Guerra Paula (eds.), DIY Cultures and Underground Music Scenes, Londres, Routledge, p. 112-124. 16 1 Boltanski Luc & Chiapello Ève (2011), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard. Bosqué Camille (2015), « Des FabLabs dans les marges : détournements et appropriations », Journal des anthropologues, no 142143, p. 49-76. Collins Nicolas (2006), Handmade electronic music : the art of hardware hacking, New York, Routledge. Crawford Matthew B. (2010), Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail, traduit par Marc Saint-Upéry, Paris, La Découverte. Crémer Jacques & Gaudeul Alexandre (2004), « Quelques éléments d’économie du logiciel libre », Réseaux, vol. 124, no 2, p. 111-139. https://doi.org/10.3917/ res.124.0111. Depoorter Gaël (2013), « La communauté du logiciel libre. Espace contemporain de reconfiguration des luttes ? », in Flichy Patrice (2010), Le sacre de l’amateur. Sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique, Paris, Seuil. Guesde Catherine & Nadrigny Pauline (2018), The most beautiful ugly sound in the world : à l’écoute de la noise, Paris, MF. Hainge Greg (2013), Noise Matters. Towards an Ontology of Noise, Londres, Bloomsbury. Hegarty Paul (2007), Noise/music. A History, New York, Continuum. Hein Fabien (2012), Do it yourself. Autodétermination et culture punk, Congé-sur-Orne, Le Passager clandestin. Hennion Antoine (2004), « Une sociologie des attachements. D’une sociologie de la culture à une pragmatique de l’amateur », Sociétés, vol. 85, no 3, p. 9-24. https://doi.org/10.3917/ soc.085.0009. Kelly Caleb (2009), Cracked Media : The Sound of Malfunction, Cambridge (Mass), MIT Press. Lallement Michel (2015), L’âge du faire. Hacking, travail, anarchie, Paris, Seuil. Le Guern Philippe (2012), « Irréversible ? Musique et technologies en régime numérique », Réseaux, vol. 172, no 2, p. 29-64. https://doi.org/10.3917/ res.172.0029. Lewandowska Weronika M. (2014), « It Has to Be Loud and It Has to Shine. An Interview with Ewa Justka », traduit en anglais par Ewa Kozik, Glissando, no 25. Meyer Morgan (2012), « Bricoler, domestiquer et contourner la science : l’essor de la biologie de garage », Réseaux, vol. 173-174, no 3, p. 303-328. https://doi.org/10.3917/ res.173.0303. Novak David (2013), Japanoise. Music at the Edge of Circulation, Durham, Duke University Press. Odin Florence & Thuderoz Christian (2010), Des mondes bricolés ? Arts et sciences à l’épreuve de la notion de bricolage, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes. DIY et hacking dans la musique noise… Aspa Mikko (2010), « The Art of Analogue Tape Noise. Araon Dilloway (Hanson Records) », Special Interests, no 3 (mai). Frère Bruno & Jacquemain Marc (eds.), Résister au quotidien ?, Paris, Presses de Sciences Po, p. 133-160. Priest Eldritch (2013), Boring Formless Nonsense : Experimental Music and the Aesthetics of Failure, New York, Bloomsbury Academic. Saladin Matthieu (2012), « L’expérimentation comme questionnement », Tacet, no 2, p. 6-22. Waksman Steve (2004), « California Noise. Tinkering with Hardcore and Heavy Metal in Southern California », Social Studies of Science, vol. 34, no 5, p. 675-702. https://doi. org/10.1177/0306312704047614. Weissenbrunner Karin (2015), « Subversive Qualities in Experimental Practices », EContact !, Experimental Practices and Subversion in Sound, vol. 16, no 4. En ligne sur : http://econtact. ca/16_4/weissenbrunner_ subversive.html. Article Bibliographie 35 Minter are congruent with our contemporary understanding of hacking. Keywords: counterculture – resistance / digitality / representation (visual) / sound system / technologies – devices / websites – blogs – forums Résumé : Associée à la suite logicielle du Jaguar CD (un périphérique associé à une console de jeux vidéo Atari sortie en 1995, mais qui n’eut guère de succès), la Virtual Light Machine (VLM) de Jeff Minter préfigurait les visualiseurs de musique souvent intégrés aux lecteurs multimédias numériques du début des années 2000. Elle avait été conçue pour lire un CD et générer en temps réel des animations plus ou moins synchronisées avec la musique. En 1996, Jeff Minter publiait en ligne le « Yak’s Quick Intro to VLM Hacking », un guide expliquant comment personnaliser les 1 By Eamonn Bell (Columbia University) Abstract: Foreshadowing in purpose and execution the 81 paramètres prédéfinis du visualiseur, grâce à un menu caché dans le logiciel. Le travail logiciel de Minter, qui est peu connu au-delà de la communauté des historiens et des music visualizers that were widely distributed with software passionnés de jeux vidéo, mérite une place dans l’histoire media players during the early 2000s, Jeff Minter’s Virtual des technologies grand public de visualisation de la musique. Light Machine (VLM) was distributed in the firmware of the À partir de sources primaires numériques (pages Web, commercially unsuccessful Atari Jaguar CD games console, messages sur les forums de discussion, code d’origine du which was released in 1995. The VLM was designed to play an audio CD and generate real-time animations in moreor-less tightly coupled synchrony with music. The following year, Minter published “Yak’s Quick Intro to VLM Hacking”, VLM), cet article cherche à déterminer dans quelle mesure les pratiques définies par Minter peuvent être retrouvées dans les normes contemporaines du hacking. an online guide describing how to customize the visualizer’s 81 graphical presets that revealed a hidden menu in the software. Minter’s software work, not widely known outside of the community of video-game historians and enthusiasts, deserves inclusion in a broader history of consumer music visualization technology. I draw on born-digital primary Mots-clés : contre-culture / numérique / représentation visuelle / sound system / technologies / sites internet – blogs – forums / hacking / visualisation musicale Article 16 Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine: Unpacking the code and community behind an early software-based music visualizer Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… Article to which the practices explicitly and implicitly endorsed by sources—including newsgroup posts, web pages, and the original code for the VLM itself—to understand the extent 37 Eamonn Bell Introducing the Virtual Light Machine includes the Virtual Light Machine™ (VLM). No other game system has VLM. VLM literally looks at audio compact discs as they are played and spontaneously produces a spectrum analysis of every incoming sound. This information is assembled in a frequency map of the music and assigned complex visual equivalents. Advanced 64-bit data processing makes it possible for the translation to take place almost faster than On June 23, 1994, a breathless newswire from the Atari Corporation announced the impending release of its Jaguar CD console add-on accessory for the US market. Indulging in a number of dubious mixed metaphors, the press release described one of the accessory’s more distinctive selling points: it was to be distributed with a built-in, interactive music visualizer, designed and programmed by the British video-game artist Jeff Minter. “Thanks to the many talents of Jeff Minter, author of the award-winning Tempest 2000™, Atari’s new CD-ROM 38 the ear can hear it so images are in perfect tune with the sound as it is played. The result is a stunning light show. VLM is perfect for parties and every other listening environment where audio compact discs are enjoyed.” (Newswire, 1994) Promotional copy on the Jaguar CD’s packaging (Figure 1) proclaimed that “VLM brings your music to life”, and that owners could “pop in a music CD, sit back and watch as 65,000 colors warp, contort and distort to every beat, octave and power chord”. Owners of the Virtual Light Machine (VLM) listened to the music of their choice as multicolored, pixillated graphics moved Figure 1: Promotional copy in three languages on the back panel of the original packaging of the Atari Jaguar CD. Source: http://jagcube.atari. org/jaguarcd.html. Accessed 28 October 2018. Copyright: Atari Corporation, Inc. 16 1 onscreen and appeared to change in response to the music heard. Despite its attractive graphics processing power, the ill-fated Jaguar caused significant financial problems for Atari—they sold just 125,000 units worldwide between its release in 1993 and 1995, and were burdened with another 100,000 units that remained on inventory by the end of that year (Atari Corporation, 1996). The Jaguar CD add-on (shown in Figure 2) for which Minter was commissioned to write the VLM was itself an even less widely available piece of consumer electronics. 1 Uncertainties about the precise extent of its failure aside, the commercial reach and impact of the Jaguar CD 1 It is widely asserted that Atari sold only the first production run consisting of 20,000 units of the Jaguar CD; there is some evidence from serial numbers and manufacturing dates shared online by Jaguar CD owners that this is unlikely to be the case. See, for example, https://atariage.com/forums/ topic/156319-jaguar-cd-real-production-quantityand-hardware-variations (accessed 6 August 2019). paled in comparison with that of its direct competitor: released on the last day of 1994, the CD-based Sony Playstation sold over 102 million units by March 2007 (Sony Computer Entertainment, 2011). The main interface offers conventional CD playback features; the media transport buttons (play, pause, skip forward, etc.) are displayed prominently. Like the majority of audioreactive software visualizers, the VLM is driven by continuous acoustic signals (i.e. the sounds themselves) and not discrete data that might be implied by an instrumental performance or derived from a musical score. 2 When the user presses the up or down arrows on the D-pad, an overlay of a volume slider appears on the screen, allowing control of the playback volume, or “gain”. If the gain is set too low, the visualizer’s shapes remain sluggish and inactive, even if the track is 2 Cf. The Music Animation Machine (1985–) of Stephen Malinowski, which primarily consumes a symbolic representation of the score (Bain, 2008: 29-31). Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… Article Figure 2: The Atari Jaguar with the Jaguar CD add-on in situ, along with its idiosyncratic controller. The Atari Jaguar controller featured a telephone-style numeric keypad, which is used in the VLM to switch between visualizer presets. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atari-Jaguar-CD-wController. jpg. Accessed 14 July 2019. Credit: Released into the public domain by EvanAmos. 39 Eamonn Bell 40 up-tempo; too high and the animation seems to respond hyperactively to the music. The finicky VLM does not always produce desirable audiovisual correspondences between, say, the pulsing bassline of an acid house track and the vibrating shapes on screen. Tweaking the playback gain appeared, for most users, to be the only way to adjust the visualizer’s behavior. The VLM allowed players to select from an array of different types of visualizations. Minter used language already in common use in the audio synthesis world to describe how these different visualization strategies were arrayed: each distinct kind of visualization is called a “preset”; presets are organized into nine “banks”, containing nine presets each, for a total of 81 preset visualization styles (Figure 3). Players used the idiosyncratic telephone-style number pad on the Jaguar’s controller to literally dial in the desired preset from a finite palette of options. Presets in the same bank share a basic visualization conceit with each family member constituting a variation on some underlying visual theme. Little would the average player know Minter had hidden in VLM software the facility to create brand new presets by manipulating dozens of audio-visual software parameters opening up millions of new possibilities for visualization. Before I explain this hidden menu in greater detail, I begin by situating the VLM in the context of other similar devices that preceded it. Figure 3: The author’s montage of screenshots of each one of the 81 of the preset visualizations provided by the Virtual Light Machine out of the box. Source: http://jagcube.atari. org/jaguarcd.html. Accessed 28 October 2018. Last updated 22 January 2002. Color organs, video synthesizers, music visualizers, lightsynths; oh my! 16 1 Jeff Minter’s VLM is part of a long line of devices that co-ordinate music and light in time: from the notorious ocular clavichord of Louis Bertrand Castel (1725) to the tastiera per luce that accompanied Scriabin’s Prometheus (1915) and early-twentieth-century “color organs” in their image. The dawn of film spurred the Soviet experiments with draw-on sound, as well as those of Rudolf Pfenninger and Oskar Fischinger, the later also widely known for his experiments in “visual music” using cut-outs and other novel techniques for stop-motion animation. 3 The mid-century witnessed Gordon Pask’s cybernetic Musicolour (1953-1957) and the pieces of John and James Whitney (starting in the late 1950s), leading to the computer-controlled animations of Laurie Spiegel (1974-1976) and Lillian F. Schwartz (1970-). 4 The desire to 3 On the Soviet and Austro-German histories of drawn-on sound respectively, see Izvolov (2014) and Levin (2003). See also Patteson (2016: 106-113). 4 On the Whitney brothers’ work, see Patterson (2009). On Gordon Pask’s Musicolour, see Pickering (2010: 313-321). For Spiegel on her graphic practice in her own words, see Spiegel (1998). A large selection Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… Points of reference “see sound” is perhaps most recently attested to by the visualization software that was bundled with widely used audio player software including Nullsoft’s Winamp (1997), Windows Media Player 7 (2000), and the Apple iTunes player (2001). 5 Importantly, these audiovisual experiences were fully commodified, and widely accessible to the millions of PC owners. Unlike the preponderance of one-off or experimental devices represented in this selective history, and like the VLM, this software brought real-time, reactive music visualization into the home. A self-avowedly abbreviated account of this lineage has been sketched by Amy Alexander and Nick Collins; they acknowledge the futility of trying to “tie up all the historical threads of audiovisual performance” and focus primarily on contemporary VJ and live cinema work. 6 Ideally complementary to those histories of abstract cinema provided by film studies, a comprehensive history of music and light with an explicitly musicological tint has yet to be completed. 7 Karen Collins, William Gibbons, and Roger Moseley have each separately noted the intersection between video games and the development of new music visualizations, citing dozens of music-related video games that feature music visualization of some kind. Their examples of Schwartz’s film work is available online at http:// lillian.com/films/ (accessed 6 August 2019). 5 Visualizer plugins were available for Winamp at least as early as 1998; the first version of the influential Advanced Visualization Studio (AVS) appeared with Winamp 2.61 (2000). 6 Alexander and Collins (2017). 7 Though see Whyte (2019) for work in precisely this direction. Article Then, I consider the specific senses in which “hacking” can be understood in relation to the device. Finally, I discuss the advantages of studying this digital artifact through the close consideration of its code and of the online trace of its community of owners. 41 Eamonn Bell 42 range from simple rhythm games to fully-featured simulacra for musical performance, represented by Harmonix’s Guitar Hero family of video games. 8 Their ludomusicological work justifies a focus on games in the context of the history of music visualization, bringing insights from a medium ordinarily excluded from organological or film-history perspectives on the topic. There are, nevertheless, notable points of contact between Minter’s digital practice and avant-garde visual art in the twentieth century arising from the experimental use of video technology. For instance, Peter Sachs Collopy has traced the twentieth-century use of analog circuits to generate and modify video signals, through to the hybrid digital-analog systems that allowed for finegrained computer control of electronic circuitry (Collopy, 2014). Collopy, like many of the artists whose work he cites, uses the umbrella term “video synthesizer” to refer to the various systems he discusses; the implied analogy is justified, since “designers modeled video synthesizers on audio synthesizers” (Collopy, 2014: 74). Minter would have been sympathetic to this analogy, since he uses the term “lightsynth” to refer not only to his VLM, but also to its several predecessors, each of which share the aim of creating a more-or-less independent play of light. Here, I prefer the term “music visualizer” to describe such a device that, using the representation of a recording as an audio signal, produces animated images intended to be viewed in synchrony with music—whether 8 Collins (2013: 581-582); Gibbons (2018: 92ff.); Moseley (2013). or not they require or facilitate interaction by their users. 9 The Jaguar CD was not the first consumer music visualizer. Indeed, the Atari Corporation had already developed an electronic visualizer unit for the home consumer goods market—the Atari Video Music (C240)—as early as 1976, though it was neither especially sophisticated nor popular. 10 Nor was the Jaguar CD, the first home video game console to include a music visualizer. That dubious honor goes to the 3DO, a CD-based entertainment system first manufactured in 1993 that included a visualizer system that allowed its users to choose one of four lurid preset visualizations driven by the sounds of an audio CD that had been inserted. 11 9 Minter, on the other hand, reserves this term (“visualizer”) for hardware or software creations that do not accept user input, and emphasizes that what distinguishes his lightsynths from such visualizers is precisely their interactivity. The reality of multimedia technology is messy and resists taxonomies. For scholars of multimedia, it is probably more productive, instead, to speak of degrees of interactivity, audioreactivity, and autonomy in the techniques and interfaces of music/sound visualizers, emphasizing both their family resemblances and dissimilarities, than to draw bright lines between them and balkanize their study on the basis of terminology. 10 The Atari Video Music has received little academic scrutiny, though see the cursory description in Bogost (2011), cited in Gibbons (2018: 92). Online videos published on YouTube provide adequate technical overviews of the device and its limited capabilities. See, for example, “RetroTech: Atari Video Music - The Migraine Machine” (2017): https://youtu. be/wle0eqBwtL8 or “Ben Heck’s Atari Video Music Teardown” (2016): https://youtu.be/INnpnJvDXDg (both accessed 6 August 2019). 11 For more on the 3DO, a technically innovative system that was nevertheless a commercial failure, see Wolf (2008: 162-163). to work like Minter’s and that of other demoscene participants. In Minter’s own account of the history of visualizations, he describes a run-in with a Nullsoft employee ʽwho apologized for ‘borrowing’ the techniques I’d used on the [Atari] Jaguar VLM for their own visualizations.ʼ”(Morris, 2015: 55) 16 1 The VLM’s strategies of music visualization, which are discussed in detail below, anticipate those softwares that mediated the experience of hundreds of millions of listeners as they consumed MP3s in the age of Napster, but also reflect an interest in techniques of video art already well established by 1995. Minter’s work thus may constitute a link between these pre-digital, mid-century, non-commercial experiments and the fully commoditized packaging of the same techniques as visualizer plugins for PC media player software in the 2000s. Senses of “hacking” No longer conferring a specific sense of technical ability with cutting-edge computer hardware or software, as it might once have meant to the wizards of MIT profiled by Stewart Brand in his influential Rolling Stone feature (1972), the term has become frustratingly nebulous. The word “a mentality that chooses to challenge conventional knowledge and behavior. Wark refers to factors which Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… “Winamp’s visualizations owes a large aesthetic debt “hacker” rarely occurs today without some constraining modifier. Perpetrators of data breaches are reported in the news as “malicious” hackers; penetration testers must be “Certified Ethical” hackers before they can be hired by standards-compliant businesses; less-scrupulous enterprises may hire “grey” or “black hat” hackers to do their dirty work; “self-described” or “self-proclaimed” hackers are dismissed as fantasists. Gisle Hannemyr has identified at least three distinctive (if not entirely distinct) senses in which the word “hacker” is used, and, drawing on Steven Levy’s Hackers (1984), identifies some definitive aspects of the “hacker attitude”. According to Hannemyr, hackers tend to “reject hierarchies, mistrust authority, promote decentralization, share information, and serve [their] community” (Hannemyr, 1999). In any event, neither prescriptivist pleas for a wider meaning to the word hacker nor nostalgic attempts to restore some lost, less complicated sense of the word, make for a theory of hacking: what it is that a hacker does. One ramified account of such a theory is outlined in Mackenzie Wark’s A Hacker Manifesto, a thoughtful attempt to raise class consciousness in the participants of a newly-identified struggle between the “hacker” and “vectoralist” classes (Wark, 2004). Corrado Morgana, glossing this central opposition in an introduction to a brief but striking collection of short writings by avant-garde video-game artists, explains that hackers possess Article However, the present focus on the Jaguar CD VLM is motivated by the fact that it marks a milestone on the entry of real-time music visualizers into the home, via the by-then-well-established market for home video games. Furthermore, as Jeremy Wade Morris has noted, there may be an even more intimate link between Minter’s software and these commonplace visualizers: steer convention and behavior as ‛vectoral.’ These vectors, such as property, information, and capital, are steered by 43 Eamonn Bell ‛vectoralists’ who would guide behavior for economic gain or other institutional control by fostering predictable behavior. The artist that thinks games questions, juxtaposes, reinvents and challenges these vectors.” (Morgana, 2010: 8) The present focus on a piece of consumer entertainment technology and its extended reflection on the multiple senses in which it may be considered to be a site of “hacking”—here focusing on Hannemyr’s “hacker ethic” (after Levy and others) and Wark’s more explicitly political analytic— reminds us that even consumer devices in the contemporary domestic milieu are susceptible to being hacked, with all the liberatory potential that that might entail. More often used to conjure up extra lives, immortality, or gameworld wealth beyond imagination, David Surman has claimed—concisely and convincingly—that cheating in video games is “hacking for the masses” (Surman, 2010: 77). Like hacks in the broader technological community, video game cheat codes also function as kind of cultural capital in gaming communities. Knowing cheat codes imputes insider status to the holder of that knowledge. Surman describes an interactive game-level editor hidden in Sonic The Hedgehog (1991) that is revealed by inputting a similarly cryptic cheat code. Identifying what Hannemyr and others theorize as the hacker ethic in action, Surman writes that “[these] players vied for an opportunity to penetrate through the surface of the gameworld, to claim leadership and advantage, and wrestle control of the game from the orthodoxies of standard play.” (Surman, 2010: 75) 44 The conception of hacking as invoked by Hannemyr and Wark, then, is a normative one. “Hacking” is less a virtuosic display of skill or proficiency with a particular technical system (the stereotype has the hacker at the keyboard of a programmable computer), and more of a stance with regard to how one ought to act when confronted with technology. It is, perhaps above all, an ethic of curiosity about how things—socially as much as technologically—might have been otherwise. Like accessing the hidden menu in the VLM, cheating in video games does not require a particularly high level of technical involvement; indeed, the vast majority of video game cheaters simply consume cheat codes or download scripts to tamper with games whose implementation they themselves do not fully understand. But their interest in doing so, as Surman points out, is not a chiefly technical one: video-game cheating is contiguous with the hackerly predilection for demystification. So much is in evidence, as we will see, in “Yak Quick’s Guide to VLM Hacking”, the how-to guide documenting how Minter had left a hidden menu inside the VLM for users who shared precisely that impulse. Evidence base In this article, I draw on two principal kinds of primary source to trace the ends to which the FFT (Fast Fourier Transform) is put in Minter’s software: online discourse about the VLM and the code for the VLM itself. Fist, the website for Minter’s software development firm, Llamasoft, provides a valuable overview of the visualizer, Minter being most intimately familiar with the VLM concept over the many decades of its history. A glimpse into the former community of 1 12 For example, AtariAge (https://atariage.com/index. php), AtariForum (http://www.atari-forum.com/), or JagCube (http://jagcube.atari.org/) (all accessed 6 August 2019). 13 At the Atari Document Archive: https://docs.devdocs.org/ (accessed 6 August 2019). Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… emulator to re-run the BIOS on my laptop, playing with an almost functionally identical (if remediated) simulation of the VLM. 14 Importantly, however, I also chose to study the VLM in vitro: in addition to emulating the original gameplay environment, we can look at the code itself, using freely and widely available software tools designed to inspect the content of executable files. Inside otherwise inscrutable machine code can be found plaintext code comments, metadata, and—as we will see—hidden, undocumented software features. Retracing the sequence of events in which I myself came to understand the VLM, we first consider the visualizer’s source code in “Following the code”, and then, in “Polling rec.games.video.atari”, turn to the deeper insights into the software that were gained from the online community of Jaguar aficionados. Following the code Consider a bit-for-bit copy of the contents of the Jaguar CD’s BIOS. The BIOS, standing for Basic/Input Ouput System, is the software that is loaded almost immediately upon a console’s being started for the first time. Since code like this that performs this function is not intended to be changed by 14 For a discussion of some of the limitations of emulation and attempts to resolve them, see Newman (2012: 140-149). For the results presented here, I used v.0.06b of the t2k.exe emulator (for Windows) and the Jaguar CD BIOS file (MD5 checksum: 77cd95c7ad06a39f4c59995094aa10f9) available on Minter’s website at http://www.llamasoftarchive. org/oldsite/llamadloads2.html. Minter considers this material public domain, writing at: http://www. llamasoftarchive.org/oldsite/llamasoft/readme.txt (both accessed 6 August 2019). Article 16 players that clustered around the Jaguar and the Atari Corporation more generally, can also be gleaned from the online archive of the “rec.games.video.atari” newsgroup. More ad hoc forms of commentary are no less useful, despite their register: blogs and retrogaming forums are valuable sources of insight into the Jaguar CD and Atari more generally. 12 One online community of note is the now-dormant but once surprisingly vital community of developers of “homebrew” games and software for the Jaguar. Their appetite for technical documentation and code has led to service manuals, part lists, schematics, and even source code being made available online. 13 The ROM dump that includes the VLM code cannot be executed on today’s personal computer—the code is written in machine code, a low-level, non-portable type of code that is targeted to run on the specific constellation of microprocessors that jointly make up the Jaguar and the Jaguar CD. In this way, the Jaguar CD exemplifies a “platform”: a combination of software and hardware with a particular set of affordances to developers and players (Bogost & Montfort, 2009). Fortunately, an emulator, a program that carefully simulates the hardware of an obsolete computing platform on a modern “host” computer, can be used to experience the VLM—even absent the rare and expensive hardware. I built up my functional description of the VLM by using just such an 45 Eamonn Bell the user and is “burned” semi-permanently into a EEPROM chip on the console motherboard, it is often called “firmware”, alluding to its seeming at times like hardware, and at times like software. Such bit-for-bit copies of game data are sometimes called ROM files—ROMs for short. ROMs are the digital records of obsolete and discontinued games that fuel the retrogaming hobby: without these software copies, retrogamers would have to own or have access to an actual console and a physical copy of the game media for every old game they wanted to play. So it goes for researchers, too. Opening the ROM f i le for the Jaguar CD firmware (which, as we know, includes the VLM code) in a regular text editor spews out mostly non-human-interpretable data. However, machine code may contain byte sequences that can be interpreted as potentially human-readable alphanumeric characters. Inside otherwise inscrutable machine code, we can find code comments, metadata, and—as we will see— hidden, undocumented software features. I used the open-source software tool strings, part of the standard toolkit of the reverse engineer, to check the BIOS for any traces of human-readable text. Although much of the output remains inscrutable, at least in the first instance, the first string to pop out of the noise is the following statement: Virtual Light Machine v0.9//(c) 1994 Virtual Light Company Ltd./Jaguar CD-ROM version/(c) 1994 Atari Corporation//FFT code by ib2/Grafix code by Yak/~c100: 46 This message proclaims the identity of the code that follows it in the BIOS file: “Virtual Light Machine v0.9”. Copyright notices like these are commonplace in software: in the event of a dispute, an author’s claim to copyright can be supported by pointing to the existence of these marks. This banner also reveals two interesting nuances of attribution: one relating to intellectual property (IP), and one of the division of software labor. First, the Jaguar CD-ROM “version” is claimed by the Atari Corporation, while the IP for the VLM concept itself is claimed by Virtual Light Company, Ltd., a UK-based limited liability company founded by Minter. Such a distinction attempts to give juridical support to Minter’s firm belief, discussed above, that the VLM is a cross-platform concept: a legal claim that the VLM “idea” is not tied to its instantiation in any one particular game system. The second distinction tells us which coders were responsible for different parts of the VLM: “FFT code by ib2/Grafix code by Yak”. Yak is perhaps Jeff Minter’s most frequently preferred pseudonym; ib2, on the other hand, refers to Ian Bennett, one of Minter’s former colleagues at the semiconductor firm, Inmos, that fostered the development of the VLM in the late 1980s. Both Minter and Bennett’s handles are three characters long, a practical nod to the character limits on arcade cabinet high-score tables. As the code attests, Bennett was responsible for the FFT code in Minter’s visualizer. The Fourier transform is a mathematical technique for decomposing a complicated time-varying signal—say music—into an equivalent form, as a mixture of simpler, periodic sine-wave components. Applied to recordings of simple monophonic sounds performed by musical instruments (acoustic or otherwise), it reveals how complex timbres resolve into a fundamental pitch 1 15 See Anscombe (2003: 299-300), reporting a conversation from 1995. Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… Tukey remains a popular and robust FFT algorithm; Ian Bennett’s implementation of the FFT included in the VLM code shares the key features of the Cooley-Tukey algorithm. Like all modern video games consoles, the Jaguar is composed of many specialized integrated circuits, which can be broadly divided into the main central processing unit (CPU) and two main co-processor systems—the latter two co-processors were nicknamed Tom and Jerry. Their main areas of responsibility were video and sound output, respectively. Bennett chose to write the FFT computation routine for the digital signal processing (DSP) microchip inside Jerry because it provided some special features intended for such computations that the other Jaguar microprocessors did not. 16 These are specified in the instruction set for the DSP, the set of possible basic computational operations defined by the computer system to which all software written for the Jaguar CD will ultimately be reduced. Instruction 48, MIRROR, permutes the content of a memory location, which, as the technical documentation for the Jaguar notes, “is helpful for address generation in Fast Fourier Transform (FFT) operations” (Brennan, Dunn & Mathieson, 2001: 10). Furthermore, given that this instruction is implemented in the physical design of the chip itself, the MIRROR instruction exemplifies how material conditions in silico afford certain kinds of optimization, and in turn, the use of the FFT. In this way, material features of the Jaguar system itself afford the FFT Article 16 and a distinctive pattern of overtones or partials. It can also be used to analyze more complex recordings, providing a rudimentary parsing of polyphonic recordings into a segmented auditory scene, separating out the musical activity of low-, medium-, and high-pitched sounds into components that can be analyzed and processed separately. In turn, the results of such an analysis may be used to trigger and modulate the visual events in a musical visualizer. Though purpose-built spectrum analyzers were available from the 1950s onward, a set of mathematical and computational optimizations that were perfected in the 1960s and became collectively known as “fast” Fourier transform (FFT) algorithms allowed for the practical spectral decomposition of live signals by digital computers (Deery, 2007). The first implementation of an FFT algorithm is usually credited to James W. Cooley and John Tukey for work described in their 1965 publication “An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series” (Cooley & Tukey, 1965). The origin of the so-called CooleyTukey FFT algorithm is a particularly interesting one. 15 Remote sensing of the seismographic signatures of nuclear detonations allowed monitoring organizations and national geospatial intelligence agencies to verify the behavior of parties to treaties like the Limited Test Ban Treaty, which was signed in 1963 and placed constraints on the testing of nuclear weapons in a drive toward nuclear disarmament (Bishop, 2016). To this day, the algorithm described by Cooley and 16 This is based on my review of the assembly code targeted for Jerry, which has been made available online. 47 Eamonn Bell and these features were determined prior to the creation of the VLM software. Such properties lie at the level of the platform and bottom out as material features of the microchip processors themselves. Further into the BIOS code are the following lines, which contain dozens of phrases whose conspicuous absence from the main VLM user interface gives rise to the question: if these strings are not intended to be visible by the user during normal gameplay, what explains their inclusion in the code shipped with the Jaguar CD? ~g1:20:Bank> ~g1:20: @~g1:1:Edit Mode~e3:4: @~g1:1:Editing: Effect~e3:4: @~g1:1:Editing: Symmetry Generator~e3:3: @~g1:1:Editing: Digital Video Feedback~e3:3: @~g1:1:Editing: Wave Plotter~e3:3: @~g1:1:Spectrum and Triggers~e3:3: @~g1:1:Trigger Settings~e3:3: @~g1:1:Adjust width using joypad 48 It turns out that the hidden features of the VLM insinuated by these lines of code are only unlocked when the player inputs an undocumented sequence of controller inputs that are highly improbable in regular gameplay. A series of posts by Minter to the “rec.games.video.atari” newsgroup in 1996 explain precisely how to cause these menus to appear, describing officially undocumented controller actions that activate a hidden feature, a set of actions that even casual gamers would recognize as cheat codes. Software features such as this, that are hidden behind obscure game behaviors, are sometimes called “easter eggs”: they are “digital objects, messages, or interactions built into computer programs by their designers […] intended as a surprise to be found by the user, but […] not required in order to use the program.” (Nooney, 2014: 165) In his methodological guide to the study of game music, Tim Summers describes a mode of collecting analytical data he calls “reactionary play”: playing against the grain, taking in-game actions or adopting strategies unsanctioned—or perhaps even unimagined— by the game designer. Doing so can probe the limit cases of the game with the hope of revealing its musical mechanics, telling us under what circumstances musical cues are triggered, cycled, or muted (Summers, 2016: 12). It should be noted that even extended reactionary play, following Summers, would be highly unlikely to take us “behind the curtain” of the VLM: the cheat codes required to get to the hidden menus remain “out of reach” within the gameworld. Of course, Summers takes pains to enumerate alternative “sources of data” for the study of video game music including, importantly, the game engine code itself. Thus, to Summers’s impressive and useful inventory of means to understand music–video game relations, we add cheats and hacks: (semi-)clandestine ways of interacting with video games that violate the norms of regular, expected gameplay, but fall short of a completely forensic—and technically non-trivial—deconstruction of the software. Polling rec.games. video.atari Without the benefit of the synoptic view on the digital artifact provided by these tools however, owners of the Jaguar CD “Okay, to get this thread back on topic and to give you a starting point: Try 1,3,star,zero. That’s just the start “is there any way to customize the banks?? […] though.” (Yak [Jeff Minter], 1996). could ANYONE please tell me if any eastereggs exist and if so, how to activate them.” (Rha, 1995) 16 1 This is the first indication on the newsgroup of suspicions that there might be hidden content in the visualizer part of the Jaguar CD firmware. Rha’s desire to customize the preset visualizations is echoed by other subscribers to the news group. We have already seen how the VLM is distributed along with the Jaguar CD operating system, as firmware, in a read-only EPROM chip, and is therefore prohibitively difficult for most end-users to update. 17 The distribution of the VLM in the device firmware, a tactic that Minter hoped would secure as wide an audience as possible for his visualizer, necessitated just such a trade-off: the VLM would be shipped to every owner of the Jaguar CD, but once the unit left the factory, the software could not be modified. This raised the stakes for a question like Julienne Rha’s. Since no new features—for example, the desired ability to customize the preset banks—could be added to the VLM by its developer, it was important for players to 17 At least without replacing the chip with new hardware or by using other specialised tools. Entering Minter’s pattern reveals the first of two hidden menus: the “Spectrum and Triggers” menu (Figure 4). This screen visualizes the beating heart of the VLM: the real-time decomposition of the music into the frequency–intensity domain that the FFT algorithm supplies. Like a graphic EQ visualization, the height of each bar represents the magnitude of frequencies within some fixed range, or bandwidth. The midpoint of each range increases in frequency from left to right. In other words, low-pitched sounds make peaks on the left; high-pitched sounds are peaky on the right. Triggers are defined by a combination of parameters that dictate what shapes of the spectrum cause the visualizer to change in response to the music. 18 For each trigger, the “Spectrum and Triggers” menu exposes just two parameters, which pertain to the audio step: total customization of the visual effects was, at this stage, out of reach to the participants in the newsgroup. According to Scott Lawrence’s analysis of the trigger 18 Each trigger has an associated width (represented graphically by the red bars in the frequency-domain display) and a trigger minimum (represented by a horizontal grey line). Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… know exactly what was there, and, if it was hidden, how to uncover it. Then, on March 18, 1996, Minter posted to a thread looking for further clues (a thread that had, in the meantime, devolved into a flamewar about a completely different game): Article in 1995 turned to another source in search of knowledge about their new purchase: the rec.games.video.atari Usenet group, a distributed message system that relayed plain text messages posted to the group between subscribers. On November 14, 1995, less than two months after the release of the Jaguar CD, a user named Julienne Rha posted to rec.games.video.atari: 49 Eamonn Bell Figure 4: “The Spectrum and Triggers” menu showing the bars that correspond to the frequency–intensity domain data computed by the Fast Fourier Transform (FFT). Source: Author’s screenshot of the t2k.exe emulator running under Linux/WINE. 50 conditions, each trigger fires or otherwise modifies just one visual effect, according to a set of rules that results in “a situation where loud sudden things will cause a trigger, however constant noises will probably not cause triggers. Also, quiet noises will never cause triggers.” (Lawrence, 2009) The ability to control these parameters in the “Spectrum and Triggers” menu gave players a more fine-grained and more reliable way to tune the VLM than simply adjusting the gain level, a relatively crude and one-dimensional means of controlling the behavior of the visualizer. Tweaking the parameters for each trigger using these menus adjusts these policies so that the graphics appear to synchronize to musical activity in particular parts of the spectrum, based on generic or expert expectations about how particular songs will sound. Activity in different parts of the spectrum may therefore be loosely correlated to musical content: the low frequencies of the bass drum or a synthesized bassline might be set to trigger one visual event, whereas the higher frequencies of an instrumental line or wide-band sound effect will activate another. Minter understood certain presets to be better suited to certain tracks or genres. In the same post that introduced the VLM editor mode, Minter included a listening suggestion: “BTW - for general most excellent VLMing… get that NIN cd with the 5 mixes of ‘Closer’ on it, select track 3 and effect 4:9… intense or what?” (Yak [Jeff Minter], 1996) Minter provided updates to a page on his personal website that listed his own listening recommendations, often suggesting “music like Erasure (especially their singles) and Total customization? Music for Boys by the Pet Shop Boys works really well with that module [i.e. VLM effect preset], because it starts out just showing the sound wave, then when the real music starts, 16 1 the screen figuratively explodes.” (Geiger, 1995) Users did not require a game disc or cartridge to load the VLM; indeed, the visualizer is only accessible when a game disc is not inserted. As such, it is predisposed to work with a particular kind of format, the audio CD. Some explored the possibility of linking the output of other playback systems—tape decks, LP players, and radios—to the VLM, to widen the range of audio sources with which it could work. For example, a newsgroup poster requested schematics for the device, who was “tring to connect my jaguars vlm system into my sterio so i can play tapes,records etc through the vlm chip (sic).” (Bolser, 1996) Such “interpersonal interactions mediated by a game”, as Karen Collins has intimated, also exemplify a kind of interactivity, one that “take[s] place on a much vaster and temporally longer scale” than the The precise correspondence between trigger and visual effect is more fully determined in later set of menus, along with the actual definition of the graphical content of each effect. As Minter would later write, the “Spectrum and Triggers” menu “was just a red herring to confuse people looking for the hack”; the true hidden menu that would allow players to customize the preset visualizations was one more step away. Just two days later, Minter posted to the newsgroup with details of how to reveal another screen, the real—comprehensive— visual effects editor. Carefully following Minter’s instructions reveals a second set of menus. These menus, shown in Figure 5, allow for even finer control over the visual elements corresponding to each trigger and the periodic functions of substantial complexity that control how basic elements of the visualization move across the display. Here, players can fully parameterize many of the generative graphical processes that, Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… instant-to-instant interactions that determine how video games behave in the moment of play (Collins et al., 2013: 575). A more generous understanding of interactivity both exceeds and complements the control–feedback model that Collins uses to analyse audiovisual relationships in video games. Such digital traces of community of players provide further evidence for the VLM’s interactivity, understood both as a characterization of the relationship between the player and the game, but also of those relationships between players, regardless of their spatial or temporal remove. Article a VLM that he felt best matched each musical selection (Minter, 1995). Newsgroup users also shared recommendations for suitable matches (Millar, 1995). The circulation of such “good fits” shows how a community can implicitly define a set of desirable audio-visual correspondences. These valued correspondences can come not only from the creator (along with the sanction afforded by Minter’s authority), but from the player-users themselves. For example, writing in reply to a post titled “What do you like to play on VLM?”, Brian J. Geiger answered: 51 Eamonn Bell Figure 5: VLM effects editor sub-menu showing the two visual effects which together make up preset 4-9. Source: Author’s screenshot of the t2k.exe emulator running under Linux/WINE. 52 when superimposed, generate the diverse banks of preset visualizations. The “Spectrum and Triggers” screen clarified the dependency between the analysed audio spectrum and the visual cues, defining six “triggers” that can be tuned to different regions of the frequency-amplitude domain. Using the next level of menus, we now focus more closely on the fourth setting in the ninth bank of presets (4-9) by visiting the sub-effect slot menu. From this menu, we learn that each individual preset consists in the superimposition of up to six distinct visual effects which are optionally passed through a “symmetry generator”, which is parameterized in another submenu, shown in Figure 6. Despite its emergent visual complexity 4-9 was a relatively straightforward preset composed of just two such sub-effects: “Draw Spectrum As Intensities” and “Digital Video Feedback area”. Of the two, it is the digital video feedback effect that creates the ever-shifting play of multiple forms that characterizes many of the VLM’s presets. The technique was simple but effective. Thus, over the course of these two messages, Minter had revealed to the newsgroup a pair of “cheat” codes: a set of controller inputs that cause the game to behave in undocumented ways. Some days later, on March 31, Minter summarized his revelations in a complete guide to the VLM in a newsgroup post with the subject line: “Yak’s Quick Intro to VLM Hacking”, the title invoking the ethic of Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… 16 Figure 6: Some examples of further sub-menus inside the hidden VLM effects editor. Source: Author’s screenshot of the t2k.exe emulator running under Linux/WINE. 1 boring : “Because if you’re interested, you can find out a lot about how the VLM works.” Next, hacking the VLM feeds an intellectual curiosity. As Minter explains, “[Draw Spectrum As Intensities] basically plots the output of the FFT through the symmetry generator. On its own, or combined with DVF [digital video feedback], this is a good setting to use for effects that you want to be precisely audio-reactive.” The technique of digital video feedback (DVF) is the visual analogue of an audio echo effect: a seed visual form is generated and immediately duplicated, usually with a rotational and/or translational spatial offset. This image is then recursively fed Article subversion and détournement familiar to the patient readers of certain mid-90’s bulletin boards and newsgroups. Minter’s guide comprehensively detailed how to access the hidden menus, and what could be achieved in them. Minter’s three word answer to the rhetorical question—why?—explicitly address the existence of the hidden menu in terms that recollect Hannemyr’s sketch of the hacker ethic: “Because it’s fun.” (Yak [Jeff Minter], 1996) First, and crucially, Minter offers the ludic motivation. Minter’s commitment to fun supersedes any professional commitment to ship fully-tested and stable software. Minter much prefers something broken but fun to something perfect but 53 Eamonn Bell back into the duplicator, creating a plenum of superimposed copies of the original seed form, interactively collapsing into a singularity. The kaleidoscopic effect is familiar to anyone who has stood in between two facing mirrors, or pointed a home-video recorder or a webcam back at the monitor displaying its own output. Feedback techniques were close to axiomatic for the early New York-based explorers of the potentials of video art. Woody Vasulka recalls that “in 1969, the first common artifact of [the video] medium was a video feedback. It became overnight everyone’s art […] [.] It was so easy to make.” (Wilson & Melega, 1981: 9) DVF techniques, and the closely-related mirror symmetry effects, like those worked out and exposed in the VLM’s hidden menus are a recurring design motif in Minter’s video game work. 19 Lastly, Minter characterizes the hidden menus as a means to empower the user with the tools to create their own effects, so that they might exceed Minter’s self-confessed creative limitations arising from a badly-timed illness: “Because a lot of the default FX are fairly nonoptimal, largely ’coz at the time I was designing the banks I had pneumonia and was feeling like shit, and I always find that I make better FX when I feel good.” 54 19 See, for example, his early Psychedelia (1984) through to the ever shifting background art of Tempest 3000 (2000), Space Giraffe (2007), and, more recently, Polybius (2016) as well as his work on the Xbox 360’s built-in music visualizer, codenamed “Neon”, discussed in more detail below. Minter’s perfectionism aligns with the hacker ethic, which has the hacker “either attempting to right those parts of [their] program that are not functioning as smoothly as they might, or, alternatively, adding elements that are designed to improve what is already there.” (Darley, 2000: 23) 20 In his guide, he reinforces the provisional nature of the code: “the edit interface is buggy and pretty user-hostile; it’s got no error-checking and it’s possible to crash the VLM […] Hell, it was never intended for end-users.” Sue Morris has observed that those first-person shooter games that feature level editors, which allow gamers to design and sometimes share custom gameworlds or “maps”, should be seen as “co-creative media”. Just as in the case of the VLM, “[n]either developers nor player-creators can be solely responsible for the production of the final assemblage regarded as ‘the game’, it requires the input of both.” (Morris, 2003) Players of the VLM are invited to engage with and modify, however temporarily, a piece of software whose limitations are freely acknowledged by its creator. By including the hidden preset effect editor menus in the Jaguar CD VLM, Minter deliberately facilitated playful co-creation on the part of his players, leaving the back door open so curious users could transcend the game’s functional and aesthetic limitations by using a tool originally intended for the sole use of software developers. The 20 In this connection, on the characteristic toolmaking impulse of the hacker, see Levy (1984: 142ff). 1 21 This position transparently owes its debts to the work of Bruno Latour, though I do not profess to Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… as a reminder of the constitutive force of things on multimedia software, troubling implicit and explicit assumptions that human actors dominate the author function when analyzing co-creative media. This reconfiguration directs our attention back to the VLM’s dependence on the Fast Fourier Transform algorithm. Far removed from the clinical Cold War logic that motivated the need for a faster Fourier transform, Minter’s video game art instead embraces an offbeat, outsider aesthetic. Abandoning realism, he prefers to populate his games with furry animals instead of humanoid playable characters and cartoonish chaos over and above simulated violence. Minter advertised his earliest lightsynth “as a new, non-competitive form of entertainment… no enemies, no killing, just light and colour, […] it was clear that some people just didn’t ‘get it’ at all. […] I guess it was hard to review since it wasn’t a game, and all the reviewers were used to was games.” (Minter, 2005a) Reviews of Minter’s games, like this review of Space Giraffe (2007), often invoke their psychedelic aspect—the point of reference is often acid or some other psychoactive substance: “the throbbing LSD nightmare that is the background […] makes this game uniquely aggravating” (Amrich, 2007; see also Ruggill, 2015: 85-87; Weinel, 2018: 130131). Minter himself is not entirely averse to coy allusions to the origins for the visual language of the VLM. As he notes on his website: Article 16 circulation of the cheat codes that summon up these secret menus, in Surman’s words, afforded a “hacking for the masses” that opened Minter’s VLM to extension and elaboration beyond the ossified state in which commercial contingencies determined that it should leave the software development workshop. Above all, Minter’s hidden menu is a solicitation to interact with this audio-visual toy and to implicate savvy users in a process of software co-creation that empowered them to address the software’s inevitable lacks. “Yaks Quick Intro”, then, is more than just a user’s guide to the hack. It is also a statement of purpose, a manifesto: it specifies terms of engagement with the VLM, which privilege fun, curiosity, and above all, the invitation to get involved in the co-creation of the VLM software, through an interface that came with no guarantees about its stability. But the VLM, and software more generally, is not merely the product of a co-production of two kinds of putatively human authors (“developers” and “player-creators”), it is an assemblage of actors and actants that is also, in part, non-human: the Jaguar CD device, its controllers, the particular audio CD-ROMs that happen to be available to its players, the FFT-specific instructions afforded by its processor architecture, Minter’s guide to “hacking” the machine, the Usenet infrastructure through which knowledge of the cheat codes propagated, etc.—the litany is infinitely extensible. 21 These facts serve be dogmatic with regard to Actor-Network Theory. In English, see the helpful introduction to many of Latour’s ideas in Latour (2005). 55 Eamonn Bell “I found myself with this stunning little bit of kit which could produce effects I’d never dreamed of (well, I probably had dreamed of them, but not in a legal state of mind).” (Minter, 2005b) After all, Minter named his earliest published experiment in interactive color games Psychedelia, while the first incarnations of the VLM—the prototypes first developed at Inmos—made their appearance at raves. At one point, Minter’s work had featured in live DJ sets by the British house duo The Orb (Minter, 2005b). Whatever Minter’s position on the matter, however, the visual language of the VLM and its contextual association with genres and performance contexts that can be generously described as psychedelia-adjacent, suggests it may productively be read as a counter-cultural supplement to the listening experience. Yet, as we have noted above, it drew on advances in numerical computing that had been developed in direct response to Cold War demands for global geospatial intelligence collection. This irony could be construed as a quirk—a unintended-but-pleasant consequence—of a fully liberalized market for scientific research that flows, inevitably, into consumer products. Following the more cynical view of Friedrich Kittler, we might view it as further evidence of the systemic influence of military–industrial research on the entertainment industry. 22 56 22 Ever-provocative and eminently quotable, Kittler (in)famously remarked that “the entertainment industry is, in any conceivable sense of the word, an abuse of army equipment,” (Kittler, 1999: 96). Kittler had music in mind: Stockhausen’s Kontakte (1958-60) made use of army surplus signal generators. It is provocative, in conclusion, to ponder FFT algorithm in commercial music visualizers as its own “grand hack”, a creative rerouting or redirection (loosely following Wark) of the intellectual innovations emanating from technocracy of wartime scientific research. Away from the battlefield and into the stoner’s den, the algorithm becomes neutered and mocked as technology of warfare by being press-ganged into the service of psychedelic lightshows. The ethic of the spirited curiosity that typifies Hannemyr’s hacker—exemplified equally well by the erstwhile subscribers to rec. games.video.atari or the contemporary researcher, armed with tools to dismantle obsolete software—is legible both in the moment-to-moment play of lights of Jeff Minter’s Virtual Light Machine and, especially, in his tactical disclosure of the intricacies of the complex (socio-)technical system that animates them. Feedback, feedforward A later version of Minter’s VLM that he developed for the Nintendo Gamecube caught the attention of a product manager at Microsoft, an encounter that ultimately led to Minter’s implication in the design of the music visualizer which shipped with Microsoft’s Xbox 360 in 2005. Reflecting on the inclusion of his software on a system that witnessed sales in the hundreds of millions of units, Minter writes: “I am happier with it than I have ever been with anything I’ve created in my entire career. And we got it into to reach a decent sized audience. Millions and millions... }:-D.”(Minter, 2005a) T he ma rket penetration of the Xbox 360 dwarfed the preceding commercial instantiations of the VLM that preceded it: in addition to the Jaguar CD version discussed in detail above, an updated version of Minter’s visualizer was distributed in the firmware of a number of feature-rich DVD players manufactured under the Nuon brand. 23 Unlike the Jaguar CD VLM, no hidden menu or interactive preset editor is included with the Xbox 360 or the Nuon players. Minter, perhaps, was at last satisfied with a realization 16 1 23 Nuon was a short-lived but forward-looking experiment in home entertainment hardware designed in the early 2000s, and Minter was invited to include an updated version of the VLM in a number of units. For more on Nuon, see MOSS (2015). Bibliography Alexander Amy & Collins Nick (2017), “Live Audiovisuals”, in Collins Nick and d’Escrivan Julio (eds), The Cambridge Companion to Electronic Music, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, p. 123-137. doi: 10.1017/9781316459874.009. Amrich Dan (2007), “Space Giraffe (review)”, Official Xbox Magazine, September. Available at: https://web.archive.org/ web/20091123125836/http://www. oxmonline.com/article/reviews/ xbox-live-arcade/s-z/space-giraffe (Accessed 29 October 2018). Anscombe F. R. (2003), “Quiet Contributor: The Civic Career and Times of John W. Tukey”, Statistical Science, 18(3), p. 287-310. doi: 10.1214/ss/1076102417. Atari Corporation (1996), Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31, 1995, Form 10-K., United States Securities and Exchange Commission. Available at: https://www.sec.gov/Archives/ edgar/data/802019/0000891618-96000213.txt. Bain Matthew N. (2008), Real Time Music Visualization: A Study in the Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… more than 20 years’ work, one of my lightsynths is going of his lightsynth concept on a platform with what he described as “monster shader performance” and “a hell of a lot of grunt”, not to mention its impressive audience; during the era of the Jaguar CD, Minter asserted, “consumer-level hardware was simply not powerful enough to really implement such a thing properly” (Stuart, 2005). Nevertheless, in a December 2005 post to the forums at YakYak.org—“Llamasoft baanter and moosings – It’s like Deliverance with Sheep”—Minter provided documentation that described in detail how each of the Xbox 360’s four controllers can be used to modify and interact with the visualizer. These details were not distributed with Microsoft’s console either in the official manual or within the software itself (Yak [Jeff Minter], 2005). The spirit of “Yak’s Quick Intro to VLM Hacking”, of implicating the user in the creation of better audiovisual software worlds through customizable software and profligate information sharing, lived on. Visual Extension of Music, PhD diss., The Ohio State University. Ben Heck’s Atari Video Music Teardown (2016). Available at: https://youtu.be/INnpnJvDXDg (Accessed 6 August 2019). Bishop Ryan (2016), “Smart Dust and Remote Sensing: The Political Subject in Autonomous Systems”, in Beck John & Bishop Ryan (eds), Cold War Legacies: Systems, Theory, Aesthetics, Edinburgh, Edinburgh University Press (Technicities). Bogost Ian (2011), How to Do Things with Videogames, Minneapolis, MI, University of Minnesota Press (Electronic mediations, 38). Article the firmware again… Microsoft firmware. […] At last… after 57 Eamonn Bell Bogost Ian & Montfort Nick (2009), “Platform Studies: Frequently Questioned Answers”, Proceedings of the Digital Arts and Culture Conference. Digital Arts and Culture, December 12-15, Irvine, CA. Geiger Brian J. (1995), Google Groups, rec.games.video.atari. Available at: https://groups. google.com/forum/ - !original/rec. games.video.atari/29DEW34zSAs/ MxKff90PCH8J (Accessed 15 July 2019). Bolser Daniel (1996), “VLM , CAN U HELP!”, alt.atari-jaguar.discussion, available at: https://groups.google. com/forum/#!original/alt.atarijaguar.discussion/gSN6hnQkznY/ oNI-lMveQUkJ (Accessed 9 November 2018). Gibbons William (2018), Unlimited Replays: Video Games and Classical Music, New York, NY, Oxford University Press (Oxford music/ media series). Brennan Martin, Dunn Tim & Mathieson John (2001), Jaguar Technical Reference Manual: Tom & Jerry, revision 8, ATARI Corp. Collins Karen (2013), “Implications of Interactivity: What Does it Mean for Sound to be ‘Interactive’?”, The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics, Oxford: Oxford University Press, available at: http://dx.doi.org/10.1093/ oxfordhb/9780199733866.013.0011. Collopy Peter S. (2014), “Video Synthesizers: From Analog Computing to Digital Art”, IEEE Annals of the History of Computing, 36(4), p. 74-86. doi: 10.1109/ MAHC.2014.62. Cooley James W. & Tukey John W. (1965), “An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series”, Mathematics of Computation, 19(90), p. 297. doi: 10.2307/2003354. Darley Andrew (2000), Visual Digital Culture: Surface Play and Spectacle in New Media Genres, London, Routledge. Deery Joe (2007), “The Real History of Real-Time Spectrum Analyzers”, Sound & Vibration, January, p. 54–59. Available at: http://www. sandv.com/downloads/0701deer. pdf (Accessed 15 July 2019). 58 Hannemyr Gisle (1999), “Technology and Pleasure: Considering Hacking Constructive”, First Monday, 4(2). doi: 10.5210/fm.v4i2.647. Izvolov Nikolai (2014), “From the History of Graphic Sound in the Soviet Union; or, Media without a Medium”, in Kaganovsky Lilya and Salazkina Masha (eds), Sound, Speech, Music in Soviet and PostSoviet Cinema, Bloomington, IA, Indiana University Press, p. 21-37. Kittler Friedrich (1999), Gramophone, Film, Typewriter, Stanford, CA, Stanford University Press (Writing science). Latour Bruno (2005), Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford, Oxford University Press (Clarendon lectures in management studies). Lawrence Scott (2009), “Reverse Engineering VLM-1 Triggers”, Yorgle Notebook, available at: http://yorgle.org/vlm/ (Accessed 18 October 2018). Levin T. Y. (2003); “‘Tones from out of Nowhere’: Rudolph Pfenninger and the Archaeology of Synthetic Sound”, Grey Room, 12, p. 32-79. doi: 10.1162/152638103322446460. Levy Steven (1984), Hackers: Heroes of the Computer Revolution, Garden City, NY, Anchor Press/Doubleday. McKenzie Wark Kenneth (2004), A Hacker Manifesto, Cambridge, MA, Harvard University Press. Millar Jay T. (1995), “Re: What do you like to play on VLM?”, rec. games.video.atari, available at: https://groups.google.com/ forum/#!original/rec.games. video.atari/29DEW34zSAs/ YCwREWHXzvsJ. Minter Jeff (1995), “In the Toilet”, available at: http://www. llamasoftarchive.org/oldsite/ gruntingoxfiles/ztoilet.html (Accessed 18 October 2018). — (2005a), “Neon”, available at: http://www.minotaurproject. co.uk/neon.php (Accessed 6 November 2018). — (2005b), “VLM - History”, available at: http://www. minotaurproject.co.uk/vlm.php (Accessed 6 November 2018). Morgana Corrado (2010), “Introduction Artists Re:Thinking Games”, in Catlow Ruth, Garret Marc & Morgana Corrado (eds), Artists re:Thinking games, Liverpool, UK, Liverpool University Press, p. 7–14. Morris Jeremy W. (2015), Selling Digital Music, Formatting Culture, Oakland, CA, University of California Press. Morris Sue (2003), “WADs, Bots and Mods: Multiplayer FPS Games as Co-creative Media”, in DiGRA ’03 - Proceedings of the 2003 DiGRA International Conference: Level Up. DiGRA, Utrecht, The Netherlands. Available at: http://www.digra. org/wp-content/uploads/digitallibrary/05150.21522.pdf. Moseley Roger (2013), “Playing Games with Music (and Vice Versa): Ludomusicological Perspectives on Guitar Hero and Rock Band”, in Cook Nicholas & Pettengill Richard Newman James (2012), Best Before: Videogames, Supersession and Obsolescence, Milton Park, Abingdon, Routledge. Nooney Laine (2014), “Easter Eggs”, in Ryan, Marie-Laure, Emerson Lori & Robertson Benjamin J. (eds), The Johns Hopkins Guide to Digital Media, Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, p. 165166. 16 1 Patterson Zabet (2009), “From the Gun Controller to the Mandala: The Cybernetic Cinema of John and James Whitney”, Grey Room, 36, p. 36–57. Patteson Thomas (2016), Instruments for New Music: Sound, Technology, and Modernism, Oakland, CA, University of California Press. Pickering Andrew (2010), The Cybernetic Brain: Sketches of Another Future, Chicago, University of Chicago Press. PR Newswire (1994), “Jaguar CDROM under $200; Atari reveals CDROM and outstanding CD”, Press release, 23 June. Ruggill Judd Ethan & McAllister Ken S. (2015), Tempest: Geometries of Play, Ann Arbor, MI, University of Michigan Press. Sony Computer Entertainment (2011), PlayStation® Cumulative Production Shipments of Hardware | CORPORATE INFORMATION | Sony Computer Entertainment Inc. Available at: https://web. archive.org/web/20110524023857/ http://www.scei.co.jp/corporate/ data/bizdataps_e.html (Accessed 26 October 2018). Spiegel Laurie (1998), “Graphical GROOVE: Memorial for the VAMPIRE, a visual music system”, Organised Sound, 3(3), p. 187-191. doi: 10.1017/S1355771898003021. Stuart Keith (2005), “Jeff Minter vs Xbox 360: How Microsoft bought the light synth vision”, The Guardian: Technology, 5 July. Available at: https://www. theguardian.com/technology/ gamesblog/2005/jul/05/jeffmintervs (Accessed 10 November 2018). Consciousness in Electronic Music and Audio-Visual Media, New York, NY, Oxford University Press. Whyte Ralph (2019), “A Light in Sound, a Sound-like Power in Light”: Light and/as Music in the History of the Color Organ, PhD diss., Columbia University. Wilson MaLin & Melega Jackie (1981), “Woody and Steina Vasulka: From Feedback to Paganini”, Artlines, May, p. 8–10. Available at: http://www.vasulka.org/archive/420a/Artlines(5056).pdf (Accessed 10 November 2018). Wolf Mark J. P. (ed.) (2008), The Video Game Explosion: A History from PONG to Playstation and Beyond, Westport, Conn, Greenwood Press. Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine… Moss Richard (2015), “Remembering Nuon, the Gaming Chip that Nearly Changed the World—but Didn’t”, Ars Technica. Available at: https://arstechnica. com/gaming/2015/06/before-theps2-nuon-famously-tried-andfailed-to-combine-dvd-and-gameconsoles/ (Accessed 14 July 2019). atari. Available at: https://groups. google.com/forum/#!original/rec. games.video.atari/iYfTh00SwJ8/ mT0Nq2cNDcEJ (Accessed 30 October 2018). Yak (Jeff Minter) (1996), “Re: VLM Codes”, rec.games.video.atari. — (2005), “Neon/360 Controls part 1, YakYak”, Available at: http:// www.yakyak.org/viewtopic. php?f=25&t=46432 (Accessed 15 July 2019). Summers Timothy (2016), “Analyzing Video Game Music: Sources, Methods and a Case Study”, in Kamp Michiel, Summers Timothy & Sweeney Mark (eds), Ludomusicology: Approaches to video game music, Sheffield, UK, Equinox Publishing (Genre, music and sound). RetroTech: Atari Video Music - The Migraine Machine (2017). Available at: https://youtu.be/wle0eqBwtL8 (Accessed 6 August 2019). Surman David (2010), “Everyday Hacks: Why Cheating Matters”, in Catlow Ruth, Garret Marc & Morgana Corrado (eds), Artists re:Thinking games, Liverpool, UK, Liverpool University Press, p. 74-77. Rha Julienne (1995), “VLM Codes?? Do They Exist?”, rec.games.video. Weinel Jonathan (2018), Inner Sound: Altered States of Article (eds), Taking it to the Bridge: Music as Performance, Ann Arbor, MI, University of Michigan Press. 59 world can be understood as acts of hacking. Based on a series of 20 interviews with major actors of the French free Élaborer son dispositif d’improvisation : hacking et lutherie dans les pratiques de l’improvisation libre 16 1 Par Clément Canonne (IRCAM-CNRSSorbonne Université) Résumé : Cet article s’emploie à montrer en quoi les activités de lutherie de musiciens issus du monde de l’improvisation libre rencontrent les principes et valeurs associées aux pratiques de hacking. À partir d’une vingtaine d’entretiens réalisés avec des acteurs importants de la scène française des musiques improvisées, on détaille d’abord les opérations caractéristiques du hacking – l’ouverture, le détournement, le recyclage et le partage – qui se retrouvent au cœur des pratiques de lutherie des improvisateurs, avant de mettre en évidence le rôle essentiel joué par ces mêmes opérations dans les usages que font les musiciens de leur instrument dans le temps de la performance. Au final, ce sont précisément les multiples hacks que les musiciens font à leurs dispositifs qui leur permettent de concilier des exigences de jeu a priori contradictoires, entre réactivité et autonomie, improvisation scene, we examine how crucial aspects of hacking—opening, recycling, misappropriating, sharing— affect their instrument-making. We then show how such practices regulate live interactions with their devices during performances. In the end, hacking their devices enables these improvisers to actually conjugate seemingly contradictory needs: reactivity and autonomy; flexibility and workability; reproducibility and unpredictability. Keywords: instrument-making / improvisation / bricolage / serendipity / hacking / recycling / misappropriation / experimental music Par définition, l’improvisation musicale est une forme de création instrumentée : l’improvisateur crée de la musique à son instrument, avec son instrument, par son instrument, pour son instrument, parfois même contre son instrument, mais rarement sans son instrument 1. Comme le rappelle le saxophoniste Steve Lacy : « l’instrument, voilà ce qui compte : c’est le matériau, la préoccupation véritable » (cité dans Bailey, 1999 : 110). À bien des égards, l’exploration de l’instrument constitue donc l’un des centres spécifiques de l’activité créative des improvisateurs, qu’il s’agisse de partir à la recherche d’une sonorité singulière qui soit propre au musicien, d’enrichir la palette timbrale de l’instrument, ou même de s’affranchir des contraintes organologiques dont celui-ci est porteur. adaptabilité et maniabilité, reproductibilité et imprévisibilité. Mots-clés : lutherie / improvisation / bricolage / sérendipité / hacking / détournement / recyclage / musiques expérimentales Élaborer son dispositif d’improvisation… ment-making practices that pervade the free improvisation 1 On inclut bien sûr ici la voix au nombre des instruments. Article Article Abstract: In this paper, we show how the numerous instru- 61 Clément Canonne 62 Cette tendance à l’exploration instrumentale est particulièrement manifeste dans le monde de l’improvisation libre. Selon Alain Savouret – qui fut longtemps professeur d’improvisation au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris – l’appropriation de l’instrument y est poussée au plus loin, « jusqu’à la distorsion factuelle de celui-ci » (cité dans Canonne, 2010 : 244). Et en effet, nombreux sont les improvisateurs « libres » à pratiquer la « lutherie sauvage » ou le bricolage instrumental (Nicollet & Brunot, 2004) – de la préparation d’instruments préexistants à la confection d’instruments autonomes, en passant par l’assemblage d’objets plus ou moins hétéroclites en un set d’improvisation singulier. Dans le cadre du présent article, je voudrais précisément montrer en quoi les activités de lutherie de ces musiciens rencontrent les principes et valeurs associées aux pratiques de hacking – défini ici en première approximation comme un ensemble d’opérations souvent ingénieuses (l’ouverture, le détournement, l’association, le recyclage, la récupération, etc.) portant sur l’environnement matériel (des produits manufacturés de l’industrie de masse aux objets naturels) et sous-tendues par une certaine posture critique (pouvant concerner aussi bien le statut des objets techniques que la place des déchets et autres rebuts dans nos sociétés capitalistes mondialisées). Je m’appuierai pour cela sur un corpus d’entretiens menés auprès d’une vingtaine de musiciens qui sont tous des acteurs importants de la scène française des musiques improvisées. Le but de ces entretiens était de tenter de comprendre ce qui fait un instrument d’improvisation, d’une part, en mettant au jour les logiques de création et les savoir-faire qui présidaient à la constitution de tels dispositifs, d’autre part, en analysant les usages que font les musiciens de leur instrument dans le temps de la performance. Ont été ainsi interrogés les pianistes Sophie Agnel, Frédéric Blondy et Ève Risser ; les guitaristes Julien Desprez et Pascal Marzan ; les percussionnistes Toma Gouband, Lê Quan Ninh et Alfred Spirli ; les violonistes Prune Bécheau et Jean-François Vrod ; l’organiste et saxophoniste Jean-Luc Guionnet ; le trompettiste Christian Pruvost ; le tromboniste Thierry Madiot ; la harpiste Hélène Breschand ; Nicolas Chedmail, qui joue du « spat » (une sorte de cor spatialisé) ; Mario de Vega et Arnaud Rivière, qui jouent tous deux un dispositif d’improvisation construit autour d’une table de mixage préparée ; Frédéric Le Junter, qui joue des « tables préparées » constituées d’instruments et de machines de sa propre confection ; eRikm, qui joue des platines vinyles ; Jérôme Noetinger, qui joue d’un magnétophone à bandes Revox ; et Pascal Battus, qui joue des « surfaces rotatives », un dispositif construit autour d’un disque de banc de montage en rotation contre lequel sont pressés divers objets. Certes, aucun des musiciens mentionnés ci-dessus ne se revendique explicitement du hacking, ou ne fréquente les lieux qui lui sont traditionnellement associés (fab labs, hackerspaces, etc.), et ce d’autant plus que l’informatique et les technologies numériques n’occupent généralement qu’une place très marginale dans leur travail. Mais cela ne signifie aucunement que les valeurs du hacking n’aient pu infuser de manière plus implicite leurs pratiques, via un certain nombre de points de contact fonctionnant comme autant de passerelles : le refus de l’industrie et de la culture de masse ; le rôle essentiel des objets techniques dans 16 Hacking et lutherie 1 La constitution d’un dispositif d’improvisation commence le plus souvent par un geste d’ouverture. Comme la plupart des objets techniques, un instrument se présente en général au musicien avec un certain nombre de bornes matérielles. Ces différentes formes de clôture (couvercles, vis, points de soudure, etc.) ont pour fonction de maximiser la pérennité de l’objet ; mais en empêchant le musicien d’accéder à un certain nombre de zones dont la manipulation pourrait conduire à l’endommagement de l’instrument, ces clôtures matérielles interdisent également à l’instrumentiste de prendre réellement la main sur son instrument et, partant, de se l’approprier. Comme le rappelle le luthier Léo Maurel, spécialisé dans la fabrication d’instruments « insolites » ou « expérimentaux », ce qui va prendre beaucoup de temps à l’ingénieur, au concepteur, ça va être de borner les objets, de leur mettre des limites pour ne pas qu’ils soient endommagés, par exemple de mettre les circuits électroniques dans des boîtes, pour que les contenus et les soudures tiennent plus longtemps… ou d’empêcher que l’on puisse taper trop fort sur une touche de piano pour que le marteau ne se casse pas […]. [Dans les vielles à roue que je fabrique], l’interface est ouverte, tu peux l’ouvrir, tu as accès aux réglages, sauf que tu peux aussi mettre tes doigts sur la roue, donc tu peux abimer les réglages. De manière générale, on peut dire que je travaille Élaborer son dispositif d’improvisation… « Dans la fabrication d’objets tout autour de nous, sur des interfaces ouvertes, à fort potentiel de détournement, où tu inclus dans la fabrication de l’objet, dans l’interface, le fait qu’il va pouvoir être facilement détournable. » (entretien avec Léo Maurel du 28 novembre 2017) Ouvrir son instrument consiste donc d’abord très concrètement à enlever ou à déplacer certaines pièces matérielles qui empêchent d’accéder à d’autres parties de l’instrument. Mario de Vega a ainsi commencé son travail en ôtant le capot de la table de mixage qu’il venait d’acheter d’occasion, afin de pouvoir avoir accès directement aux composants électriques de la table et être capable de provoquer des courts-circuits en crachant ou en envoyant des bulles de savon sur ces composants. De même, Jérôme Noetinger a d’abord enlevé le couvercle et le galet presseur de son magnétophone Revox pour pouvoir stopper les plateaux d’une simple pression de l’index, contrôler le défilement des bandes à la main, revenir en arrière, faire du scratch, etc. Quant à Jean-Luc Guionnet, alors qu’il voulait séparer la sortie du clavier de la sortie de la boîte à rythme de l’orgue électrique Bontempi trouvé quelques années plus tôt dans un vide-grenier, il a découvert en ouvrant l’instrument qu’une molette lui Article la production comme dans la diffusion ; la valorisation de la créativité, de la singularité et de l’ingéniosité ; etc. Plus encore, le concept de hacking peut ici fonctionner comme un analyseur pertinent, précisément en ce qu’il permet de souligner la cohérence des explorations instrumentales de ces improvisateurs, en intégrant sous un ethos commun un ensemble de dispositions et d’usages qui pourraient autrement sembler disparates. Je passerai donc d’abord en revue les opérations caractéristiques du hacking qui se trouvent mobilisées dans les pratiques de lutherie de ces musiciens, avant de montrer plus en détail la manière dont ces opérations contribuent spécifiquement à la réalisation d’instruments ou de dispositifs dédiés à l’improvisation. 63 Clément Canonne permettait de régler individuellement l’accord de chaque note, ce qui lui a permis de se confectionner son propre tempérament. Mais on trouve aussi des gestes similaires chez les musiciens jouant des instruments plus traditionnels : Sophie Agnel, Frédéric Blondy et Ève Risser ouvrent pour ainsi dire quotidiennement leur instrument, puisque la pratique du piano préparé nécessite précisément d’ouvrir le couvercle de son piano (ou de l’ôter, dans le cas des pianos droits) pour accéder directement aux cordes et à la table d’harmonie. Plus fondamentalement, ces gestes d’ouverture matérielle supposent que le musicien s’affranchisse des frontières symboliques qui entourent généralement les instruments de musique dans la tradition occidentale savante et qui non seulement maintiennent l’instrument à distance de l’instrumentiste mais encore le séparent de son environnement matériel. Le tromboniste Thierry Madiot raconte ainsi qu’il lui a fallu des années avant qu’il ne s’autorise à véritablement expérimenter sur son instrument : Pour les improvisateurs que j’ai pu interroger, l’instrument n’est donc pas un donné – un objet clos dont les propriétés sont fixées en amont une fois pour toutes par le luthier (pour les instruments traditionnels) ou par le monde de l’industrie musicale (pour les dispositifs électroniques) ; au contraire, il peut être ouvert et, par là même, personnalisé, modifié ou détourné. Ouvrir l’instrument, à la fois matériellement – en passant outre les bornes placées là par le luthier ou l’ingénieur – et symboliquement – en le dépossédant de son « aura », – permet ainsi de « prendre la main » sur l’instrument et, par là-même, enclenche un processus de singularisation artistique de l’improvisateur : « Le fait de démonter le trombone, de mettre des ballons à la place de l’embouchure, ça a créé plein de modes de jeux qui ont marqué que c’était un peu mon territoire… quoi qu’il arrive, ça m’appartenait complètement, j’avais le plaisir de ne pas avoir entendu ça ailleurs. Du coup, j’avais un espace entre guillemets vierge… alors qu’au trombone, je tombais toujours dans les voies de ceux qui avaient expérimenté avant, que ce soit [Vinko] Globokar, [Paul] Rutherford ou [Albert] Mangelsdorff. » (entretien avec Thierry Madiot du 12 octobre 2017) « Quand tu as un beau trombone, il faut faire attention, il faut l’essuyer, et tout à coup, tu as tout un truc social, euh, je peux faire quelque chose avec ? Le trombone, avant d’imaginer que c’était juste un tuyau, ça m’a pris un temps fou, des années et des années avant de me dire : mais finalement ce n’est qu’un tuyau, ce n’est qu’un tube ! Tu prends un tube, on prend la même longueur, légèrement conique, et on va Cette appropriation de l’instrument passe en grande partie par le détournement et la recherche d’usages non-standards ou imprévus – une pratique qui caractérise centralement l’activité des hackers, selon Nicolas Auray : avoir quasiment un son de trombone. Pour tout instrument, 64 on devrait pouvoir avoir des instruments réduits, réduits en « L’exploration [de la machine] ne se réduit pas au termes techniques, une clarinette avec trois trous, et puis si dépassement de performances. Elle a pour contenu plus géné- tu mets une anche en plastique, le son n’est pas si différent ral la découverte de caractéristiques techniques imprévues que ça… pour désacraliser l’instrument, le mettre à distance. d’une machine […]. Par extension, le terme hacker identifie Et moi ça m’a pris des années sur le trombone… » (entretien tout utilisateur qui découvre des utilités imprévues pour avec Thierry Madiot du 14 décembre 2016) les objets techniques […]. La focalisation sur l’exploration 1 conduit à un sabotage des normes techniques (de sécurité une machine qui est faite pour enregistrer un signal et pour ou de compatibilité) au nom de la performance ou de la le reproduire dans la plus haute fidélité, c’était vraiment la vitesse. Les hackers sont des collectionneurs de ruses pour Rolls des mélomanes. Et là, l’idée, c’est pour le coup d’ins- supprimer et contourner la normalisation de l’usage inscrite trumentaliser l’appareil, et de l’utiliser d’une autre manière. » dans l’objet. » (Auray, 2000 : 14-15) (entretien avec Jérôme Noetinger du 29 septembre 2017) Le détournement peut d’abord se traduire par la confection d’une copie ou d’un instrument dérivé, comme dans le cas de Thierry Madiot qui a fabriqué, en s’inspirant du trombone, tout un ensemble de trompes télescopiques en plastique thermoformé dont la longueur peut atteindre jusqu’à vingt mètres. Le détournement consiste ici à extraire le « code source » de l’instrument pour le disséminer au sein de multiples communautés sous la forme d’objets extrêmement peu coûteux et faciles à appréhender 2 . Mais le détournement prend plus traditionnellement la forme d’un hack d’usage (Allard, 2010) – qui consiste ici pour le musicien à utiliser son instrument ou un des objets composant son dispositif d’improvisation d’une manière tout autre que ce qui avait été initialement imaginé par le luthier ou par l’ingénieur. Le fait d’utiliser, comme eRikm avec ses platines vinyles ou Jérôme Noetinger avec son magnétophone à bandes, un appareil conçu pour diffuser de la musique enregistrée comme un instrument – et donc comme une source autonome de production sonore – constitue assurément un cas paradigmatique d’un tel hack d’usage : Le hack d’usage peut également survenir de l’exploitation d’un glitch ou d’un problème de conception, ce dont témoigne l’utilisation singulière que fait Arnaud Rivière de sa pédale de looper, ou l’effet de vibrato que Jean-Luc Guionnet parvient à obtenir sur son orgue : 2 La création de ces trompes a d’ailleurs débouché sur la constitution de l’ensemble Zyph dont tous les membres jouent des trompes munies de ballons en latex. Élaborer son dispositif d’improvisation… « Ce n’est pas une machine qui est faite pour ça : c’est « Le looper, c’est pareil, ça dépend comment ça s’utilise… quand j’enregistre plusieurs fréquences très aiguës de la table de mixage avec de très légers changements, le looper n’arrive pas à comprendre, il ne reproduit pas seulement les quelques fréquences qui seraient empilées les unes sur les autres, à un moment ça lui sature le processeur et il part dans des distorsions qui ne sont pas ce pour quoi il a été créé au départ. » (entretien avec Arnaud Rivière du 12 octobre 2017) « En ouvrant [mon orgue], j’ai regardé comment c’était fait et là j’ai tout compris […]. Il y a un câble électrique qui est tendu tout le long du clavier, un seul, et quand j’appuie, ça fait contact avec ce câble. D’où, quand j’appuie fort, le câble bouge, et donc il modifie le son si je fais une autre note. Il modifie un peu, il tremblote, il fait un truc. Ce n’est pas fait pour ça, mais du coup, c’est détournable. » (entretien avec Jean-Luc Guionnet du 6 juin 2018) Enfin, le détournement des instruments et dispositifs passe régulièrement par leur altération matérielle – altérations qui permettent généralement aux improvisateurs de produire des sons qui semblent largement étrangers à l’instrument, par exemple en faisant sonner un piano comme un instrument à Article 16 des fonctionnalités imprévues qui caractérise le hacker le 65 Clément Canonne Figure 1 : Les multiples blocs de pistons soudés les uns aux autres qui forment le cœur du spat’ cor de Nicolas Chedmail vent capable d’effets de souffle ou de textures multiphoniques : « J’ai commencé à préparer le piano pour pouvoir faire au piano ce que je faisais à la flûte. Comme j’étais flûtiste et que j’explorais des sons différents des sons dits “normaux”, je me suis dit qu’il fallait que je les explore au piano […]. Je voulais pouvoir mélanger un son frotté au piano avec un saxophoniste qui souffle ; à la flûte je savais le faire, mais au piano pas. Alors j’ai commencé à chercher comment faire tous ces sons au piano. » (entretien avec Ève Risser du 13 mars 2014) 66 L’altération de l’instrument est parfois définitive – comme les blocs de pistons supplémentaires que Nicolas Chedmail a progressivement soudé à son cor pour contrôler la spatialisation (sélectionner le pavillon sur lequel le son va sortir) et plus généralement la circulation de l’air au sein du réseau de tuyaux et de boucles d’effet que constitue l’instrument (voir figure 1) – mais elle est plus souvent le fait d’associations matérielles plus ponctuelles : les pianos de Frédéric Blondy ou de Sophie Agnel sont préparés (avec des objets et des matériaux variés : boules en verre, polystyrène, ebows, patafix, canettes de coca, boîtes de sardines, etc.) ; la grosse caisse de Lê Quan Ninh est entourée (d’une multitude d’objets – pommes de pin, plateaux de disques durs, cymbales, etc. – lui servant à frotter et frapper la peau de sa grosse caisse, ou à filtrer les résonances de son instrument) ; et la guitare de Julien Desprez est augmentée (par l’adjonction d’un grand nombre de pédales d’effets). Le fait d’associer de manière plus ou moins ponctuelle différents objets périphériques à un élément central (un instrument, un dispositif de diffusion sonore, un micro, etc.) – voire d’« instrumentaliser » (en les amplifiant) un certain nombre d’objets 3 – a 3 Sur la notion d’instrumentalisation, comprise comme l’exploration du potentiel sonore des objets Élaborer son dispositif d’improvisation… Figure 2 : Les « surfaces rotatives » de Pascal Battus 1 et j’en ai embarqué deux. » Comme le résume Pascal Battus, « mon instrument, c’est une chaîne sonore qui est complètement éclatée, fragmentaire, c’est comme un instrument qui se défait et se refait. En fait, c’est comme un instrument que je fabriquerais à nouveau à chaque instant » (entretien avec Pascal Battus du 13 juin 2017). Cette conception modulaire de l’instrument, fait de composants qui peuvent « entrer » et « sortir » du dispositif d’improvisation, se retrouve, à un degré ou à un autre, chez la plupart des improvisateurs avec lesquels je me suis entretenu, ceux-ci rechignant généralement à stabiliser définitivement le set d’objets utilisés et, par là, à clore une fois pour toute leur instrument : « Ce qui m’amuse beaucoup, c’est que les objets changent très lentement au fur et à mesure : il y a des objets qui apparaissent et des objets qui disparaissent. Des amis par leur manipulation et leur amplification, voir Keep (2009). Article 16 deux conséquences essentielles sur la pratique des improvisateurs interrogés. D’une part, cela débouche sur une conception à la fois fluide et modulaire de l’instrument – constitué de différentes parties qui peuvent changer au cours du temps. Pascal Battus ajoute ainsi très régulièrement de nouveaux éléments au stock d’objets qui constituent ses « surfaces rotatives » (voir figure 2). Quand je l’ai rencontré une première fois en juin 2017, il venait d’ajouter à son set « des couvercles de boîte à Sushi, [qui permettent] d’avoir des sons d’une puissance énorme, avec des aigus qui vrillent dans les oreilles » ; et quand je l’ai revu quelques mois plus tard en novembre 2017, il avait déjà fait un nouvel ajout : « C’est récent, ces petits verres à apéro. Ça devait être cet été, à un cocktail, je ne sais plus. Il y en avait plein donc je me suis dit que j’allais essayer me donnent des choses. Ce type de polystyrène m’a été suggéré par un ami. Ou ça : c’est une découverte, c’était en 67 Clément Canonne démontant ma scie circulaire, la lame est tombée, je me suis « À partir du moment où tu commences à découvrir dit : “ouah, elle a l’air de sonner”, et donc je l’ai utilisée pour que ce qui émet une fréquence, tu peux le capter, tu vas voir. C’est un peu comme une famille, comme des compa- être à l’affût… on se rend compte qu’on est dans un monde gnons… mais il y en a qui disparaissent à jamais. Des fois, de parasite permanent ! » (entretien avec Jérôme Noetinger c’est uniquement parce que je dois prendre l’avion, je dois du 29 septembre 2017) limiter le poids, j’en enlève, et puis j’oublie de le remettre. Je ne suis pas accroché à mes objets, en sachant que je « Cet objet, je l’ai trouvé dans la rue, ça fait partie vais pouvoir faire ci ou ça avec. En fait, il n’y a pas du tout d’un système qui sert à bloquer les feuilles dans les égouts. dans mon esprit le côté nomenclature. » (entretien avec Lê Tout de suite, il m’a parlé, j’ai bien senti qu’il y avait des tiges Quan Ninh du 26 novembre 2017). en métal qui étaient reliées, donc qui devaient vibrer, ça se sent tout de suite, on peut presque sentir les vibrations […]. « Pour moi ce n’est jamais définitif, je ne cherche pas En fait, je suis plus dans une logique de trouvaille, d’utiliser la stabilité. Je serai toujours ravi de découvrir d’autres trucs… ce qui m’entoure, plutôt que d’aller chercher quelque chose il n’y a pas de limite à ça […]. À un moment, j’imaginais fixer de précis. Parce qu’en fait il y a une telle richesse dans les les supports sur le magnétophone, pour avoir une sorte de objets qui nous entourent quand on sait les regarder… » mini-portique, avec des ressorts, des petites percussions, (entretien avec Pascal Battus du 13 juin 2017) pour pouvoir les travailler directement. Donc pour moi, il y a toujours des évolutions possibles. » (entretien avec Jérôme Noetinger du 29 septembre 2017) « Je regarde tout le temps des trucs… moi j’aime les objets, et je regarde partout, tout le temps, ce qui traîne. Et à un moment donné, j’ai une idée, et j’essaye. Je connais bien D’autre part, les opérations d’association toujours renouvelées qui sont au cœur de leurs dispositifs instrumentaux conduisent les improvisateurs à être à l’écoute de leur environnement matériel, à se saisir des objets et matériaux croisés sur leur chemin et dont ils pressentent le potentiel instrumental ou sonore : « En fait, j’ai remarqué qu’il y avait une petite virtuosité qui s’installait dans le fait d’imaginer une matière. Maintenant, s’il y a un mec qui vient avec un verre en plastique et qui me dit : ça, ça pourrait sonner comment ? Je ne l’essaye même pas, parce que j’imagine très bien tout de suite le résultat sonore. » (entretien avec Ève Risser du 13 mars 2014) « Il y a aussi l’attrait de l’objet, ça peut être du caillou, un beau caillou qui sonne, qui a un aspect particulier… ça peut être la matière, une granulation qui permet une itération, je vais passer mon doigt pour entendre. » (entretien avec 68 Thierry Madiot du 14 décembre 2016). le monde du son, je sais comment ça marche. Alors parfois j’ai des espèces de fulgurances en voyant certains objets. » (entretien avec Jean-François Vrod du 2 octobre 2018) Le fait que l’instrument soit considéré comme un objet à la fois ouvert (susceptible d’être modifié) et fluide (dont les contours évoluent au fil du temps) conduit donc en définitive à brouiller la frontière entre l’instrument et son environnement : c’est potentiellement tout l’environnement matériel du musicien qui est susceptible d’être instrumentalisé par l’improvisateur ou digéré par son dispositif de jeu. Cela se manifeste notamment dans l’appétence des improvisateurs interrogés pour la récupération et le recyclage d’objets trouvés ou jetés : comme le déclare par exemple Arnaud Rivière, « je ne peux pas passer devant un dépôt d’ordures dans la rue sans m’y arrêter ! » (entretien avec Arnaud Rivière du 12 octobre 2017). Récupérer, ensuite, c’est souvent utiliser des objets qui échappent d’une manière ou d’une autre à l’ensemble de normes (techniques comme esthétiques) qu’ils sont censés exemplifier – en raison d’un défaut de fabrication ou bien d’une altération liée à leur usage – et qui permettent ainsi au musicien d’obtenir des résultats sonores singuliers ou de découvrir des usages non-standards, rejoignant ainsi une certaine « esthétique de la défaillance » propre aux musiques glitch (Kelly, 2009) : Élaborer son dispositif d’improvisation… Après les pratiques d’ouverture et de détournement, il s’agit là d’un troisième point de contact essentiel avec les valeurs du hacking 4 . Cette pratique de la récupération et du recyclage s’inscrit en effet le plus souvent dans une perspective critique visant à questionner le statut des objets techniques, qu’il s’agisse de leur obsolescence, de leur standardisation ou de leur coût (économique comme écologique). Récupérer, c’est d’abord travailler avec un matériau abondant gratuit (ou presque gratuit) qui, d’une part, renforce l’indépendance économique du musicien et, d’autre part, autorise l’expérimentation : « Ce lecteur CD, il a un truc spécial, vu qu’il était à la déchetterie et qu’il était cassé, c’est qu’il tourne même quand dant d’une technologie qui est aussi coûteuse, et d’être vraiment dans quelque chose de… réutilisé, j’aime bien cette idée de récupération. Et puis c’est des choses que je peux 16 trouver partout, il suffit de manger un flan et j’ai un nouvel objet à utiliser. » (entretien avec Pascal Battus du 13 juin 2017) 1 « Je suis plus dans l’agencement que dans la fabrication… et on est dans un monde qui est très bien pour l’agencement, il y a plein de choses qui sont jetées, on peut tout récupérer. » (entretien avec Thierry Madiot du 14 décembre 2016) « Pour moi récupérer c’est aussi lier au fait de pouvoir faire beaucoup d’expériences. Par exemple, pour les bouteilles de whisky, j’en ai récupéré des dizaines, de diamètres différents, et j’ai pu tout de suite tailler là-dedans, essayer, et voir ce que ça donnait. De manière générale, je suis habitué à prendre des matériaux pas chers pour pouvoir faire des expériences. » (entretien avec Frédéric Le Junter du 25 octobre 2017) 4 Sur le rôle crucial joué par les pratiques de recyclage et de récupération au sein des communautés de hackers, voir notamment Lallement (2015). il est ouvert, ça c’est délirant, ça me permet d’approcher très près mon micro contact. » (entretien avec Jérôme Noetinger du 29 septembre 2017) « Ça c’est un disque avec lequel j’ai pas mal joué, c’est un disque de Savouret que j’ai trouvé aux puces, et qui est fantastique parce que je l’ai trouvé avec le rond central mal imprimé, donc il y avait une boucle déjà sur l’imprimé ! » (entretien avec eRikm du 16 novembre 2017) Récupérer, enfin, c’est d’une certaine façon s’affranchir de l’obsolescence des objets industriels. La plupart des musiciens interrogés partagent l’idée qu’il y a toujours plus à faire avec un objet que ce pour quoi il a été conçu ou que les objets ont une durée de vie qui dépasse toujours leur cycle d’usage standard, comme en témoignent les plateaux en polystyrène utilisés par Pascal Battus qui, « même lorsqu’ils sont à bout, arrivent encore à sortir des sonorités insoupçonnées » (entretien avec Pascal Battus du 13 juin 2017). On retrouve ici l’idée exprimée par Kenneth McKenzie Wark, lorsqu’il fait du hacker un extracteur de virtuel : Article « J’aime bien aussi cette idée de ne pas être dépen- 69 Clément Canonne « Pour le hacker, il y a toujours dans l’actuel l’expression d’un excédent de possible, l’excédent du virtuel. C’est le domaine incompressible de ce qui est réel sans être actuel, ce qui n’est pas mais qui pourrait être. Hacker, c’est libérer le virtuel dans l’actuel, pour exprimer la différence du réel. » (McKenzie Wark, 2006 : §22) Mais utiliser des objets obsolescents revient aussi à émanciper ces objets du temps (court) des produits de l’industrie musicale pour les faire rentrer dans le temps (long) des instruments de musique. Quand un objet est déjà obsolète, il ne peut pas devenir davantage obsolète : cela lui confère ainsi paradoxalement une stabilité qui vient faciliter son instrumentalisation par l’improvisateur, de l’acquisition progressive d’un répertoire de gestes et d’actions allant s’élargissant jusqu’à la transmission d’un savoir-faire instrumental à d’autres musiciens : « Pour moi, la notion de récupération, c’est quelque chose qui m’a toujours vraiment passionné, qui m’a toujours sein de réseaux qui permettent aux improvisateurs de partager leurs ressources et leurs savoir-faire. On ne trouvera guère ici de fab lab ou de hackerspace (voir BerrebiHoffmann, Bureau & Lallement, 2018) qui viendraient centralement structurer la communauté de ces improvisateurs-makers, et ce d’autant plus que leurs activités de lutherie reposent bien davantage sur un ensemble de bricolages ponctuels que sur des opérations techniques d’envergure nécessitant un outillage sophistiqué associé à une utilisation experte. Certes, un lieu de résidence comme Lutherie Urbaine à Bagnolet, a pu à un moment jouer un rôle équivalent, de par la mise à disposition d’outils et de machines (plutôt rudimentaires), mais aussi de par la présence de Thierry Madiot, qui transmettait à la fois conseils pratiques (par exemple, où se procurer à bon prix tel ou tel matériau) et informations techniques (par exemple, sur l’utilisation des compresseurs d’air) aux musiciens accueillis : questionné, en tout cas. C’est cette idée qu’on est dans un monde où tout va très vite au niveau de la technologie… « C’est une sorte de fab lab de fait, sans technologie, aujourd’hui, il y a plein de gens qui me demandent : mais juste avec une perceuse et un fer à souder… Donc c’est pourquoi tu ne travailles pas avec un ordinateur ? Mais on ne surtout pour aider à cette communication entre les uns et demandera jamais à un flûtiste pourquoi il ne travaille pas avec les autres, entre des gens qui sont assez isolés. Comme un autre instrument qui serait […] le futur de la flûte. Tandis je commence à être un peu plus vieux dans ce milieu, je qu’effectivement, il y a une évolution technologique par rapport peux être en position d’aider à ça. Je ne veux pas formater à ces machines-là où on a toujours du mal à comprendre qu’on ça… mais moi ça m’a tellement manqué quand j’avais une ne vive pas avec son temps. Alors maintenant ça revient à la vingtaine d’années d’avoir ce genre de ressources que j’ai mode – je peux transmettre à des plus jeunes – mais en tout envie que ça existe cet endroit-là pour que ça vive et que cas je n’ai toujours pas senti la limite du plaisir que j’ai de jouer ça fasse du sens… mais bon c’est fragile, il y a plein de avec ça et puis je découvre toujours des choses, des petites problématiques socio-économiques, et des problèmes de choses, mais encore des nouvelles choses. » (entretien avec pratiques, aussi. On a beau avoir une bonne idée, si personne Jérôme Noetinger du 29 septembre 2017) ne vient, ça ne marche pas. » (entretien avec Thierry Madiot du 14 décembre 2016) 70 Il faut enfin dire quelques mots ici sur la manière dont ces pratiques de lutherie – largement individuelles – s’inscrivent au Mais comme le souligne Thierry Madiot, le projet de transformation de 1 « C’était très expérimental notre manière de travailler, eux ils étaient très branchés musique contemporaine, moi Hacking et dimensions de l’instrumentalité Élaborer son dispositif d’improvisation… Nous avons donc vu qu’un certain nombre d’opérations caractéristiques du hacking – l’ouverture, le détournement, le recyclage et le partage – étaient au cœur des pratiques de lutherie des improvisateurs. Il s’agit maintenant de montrer le rôle que jouent ces opérations dans la performance d’instruments ou de dispositifs qui ont été conçus pour être utilisés, au moins pour une large part, en situation d’improvisation libre. Tout instrument résulte de compromis entre des objectifs parfois contradictoires, et les dispositifs d’improvisation n’y font pas exception. Les musiciens interrogés attendent donc de leur instrument qu’il satisfasse un certain nombre de critères. Premièrement, l’instrument doit être capable de s’adapter à une grande variété de situations sonores – ce qui se traduit souvent par la diversité des objets et des matériaux qui composent le set d’improvisation – tout en restant peu encombrant 5 , mais surtout relativement maniable et ergonomique – et donc compatible avec l’exigence d’invention en temps réel qui caractérise l’improvisation. Deuxièmement, j’avais un petit train de retard. Et c’est là que j’ai commencé à mettre des objets [dans le piano]. Thierry mettait déjà des gobelets dans son pavillon [de trombone], il m’en a passé, il y a beaucoup d’objets qui ont circulé comme ça. En tout cas, c’est vraiment avec ce trio que j’ai eu pour la première fois des désirs de sons qui me manquaient. Donc j’ai dû trouver comment les faire. » (entretien avec Sophie Agnel du 9 janvier 2018) 5 La question du poids de l’instrument (ou du set de préparation) est revenue systématiquement au cours des entretiens : en particulier, au sein d’une scène caractérisée par la grande mobilité des musiciens, le poids maximal de 20 kg imposé par les compagnies aériennes pour les bagages en soute est devenu de facto la limite à ne pas dépasser pour tous les improvisateurs interrogés ! Article 16 Lutherie Urbaine en fab lab dédié aux lutheries expérimentales n’a pas vraiment pris. En réalité, les échanges entre ces improvisateurs empruntent des chemins beaucoup plus informels, liés à la communauté de pratiques qui les rassemble. Ils fréquentent ainsi les mêmes salles de concerts et sont donc régulièrement témoins des trouvailles ou astuces des uns et des autres qu’ils peuvent ensuite « emprunter ». Plus fondamentalement, tous ces improvisateurs participent d’une scène qui favorise les pratiques collectives, qu’il s’agisse de rencontres occasionnelles ou de groupes constitués : ils jouent donc fréquemment les uns avec les autres, au gré de projets aux configurations et à la stabilité variables. Au sein de ce réseau, certains improvisateurs comme Jean-Luc Guionnet, Pascal Battus ou Thierry Madiot occupent une place particulièrement centrale, comme en atteste le fait qu’ils aient pu collaborer, à un moment ou à un autre, avec la quasi-totalité des musiciens rencontrés au cours de cette enquête. Ils jouent donc un rôle tout particulier dans la circulation des dispositions et des savoirfaire associés à l’exploration instrumentale et à la lutherie expérimentale. Sophie Agnel décrit ainsi son trio avec Thierry Madiot et Hélène Breschand comme un véritable « laboratoire » : 71 Clément Canonne 72 il doit permettre la reproductibilité des actions sonores – et donc répondre fidèlement aux intentions musicales de l’improvisateur – tout en possédant une certaine imprévisibilité – faisant ainsi de l’instrument un véritable partenaire d’interaction capable de suggérer de nouvelles directions à l’improvisateur. Troisièmement, il doit être réactif – c’est-àdire que le son suive l’action sans délai – tout en étant capable d’autonomie – c’est-à-dire qu’il puisse aussi produire des sons sans être directement sollicité par l’improvisateur, par exemple pour que celui-ci puisse se saisir d’un nouvel objet sans que cela ne se traduise nécessairement par un silence. Et enfin, quatrièmement, il doit être modulaire – en étant constitué de différentes parties susceptibles à la fois d’évoluer au cours du temps et de se voir assignées des fonctions sonores ou musicales bien particulières – tout en étant intégré – c’est-à-dire qu’il sonne malgré tout comme un instrument, disposant d’une signature sonore propre et bien identifiable dans le flux d’une performance collective. Tous les improvisateurs interrogés ne résolvent évidemment pas de la même manière ces différentes « équations ». Et à bien des égards, les choix qu’opèrent les musiciens sont révélateurs de la manière dont ils conçoivent la pratique de l’improvisation : improviser, est-ce plutôt une affaire de contrôle ou d’accident ? D’interaction ou de génération ? Est-ce se dire que tout est possible ou bien est-ce plutôt explorer un territoire bien délimité ? Est-ce une activité intrinsèquement virtuose ou pas ? L’examen précis de la relation existant entre les choix de lutherie des improvisateurs et les conceptions de l’improvisation qui régulent leur pratique musicale mériterait assurément un article à part entière. Je me contenterai donc ici de montrer comment les opérations de hacking discutées dans la première partie de cet article permettent précisément aux improvisateurs de résoudre certaines des tensions présentées ci-dessus. D’abord, les improvisateurs vont multiplier les astuces ou bricolages leur permettant de simplifier ou d’optimiser la production de certains types de sons. Le pianiste Frédéric Blondy a ainsi longtemps cherché comment produire des sons continus au piano : au début, il utilisait du crin de cheval pour frotter directement les cordes mais ce geste lui monopolisait les deux mains. Il lui a donc substitué une simple baguette en bois qu’il coince entre les cordes, et qu’il frotte verticalement avec une de ses mains après l’avoir préalablement humidifiée, ce qui lui permet d’avoir une main libre pour faire autre chose (jouer sur une autre partie du piano, placer une nouvelle préparation, etc.). Nicolas Chedmail envisage quant à lui d’ajouter une pédale de charley déportée à son spat’ qui lui permette de prendre en charge une partie du contrôle des pistons au pied, optimisant ainsi la rapidité du passage d’une boucle d’effet à une autre. Cette recherche d’optimisation des moyens de la production du son par le détournement ou l’association matérielle se retrouve chez pratiquement tous les improvisateurs interrogés. Certains vont même jusqu’à bricoler des dispositifs autonomes pour pouvoir produire des sons sans avoir à entretenir un geste ou une action, comme Arnaud Rivière qui utilise plusieurs actionneurs motorisés « pour pouvoir faire autre chose [en même temps] et donc pouvoir accéder à plus de polyphonie » (entretien avec Arnaud Rivière du 12 octobre 2017). Ensuite, la pratique du détournement et le développement de hacks d’usage permet « Au début, je prenais mes objets pour des sons, alors que maintenant, je les vois plus comme des possibilités de sons. » (entretien avec Ève Risser du 13 mars 2014) « Au départ, j’avais beaucoup d’objets, il y avait une palette énorme mais en fait, pendant un concert, je ne peux pas tout utiliser… mais je me suis rendu compte que même si j’ai un seul objet, je peux l’utiliser dans tous les sens, découvrir d’autres manières de l’utiliser… donc avoir moins ce côté « prendre des choses » mais utiliser une chose et aller jusqu’au bout de cette chose, c’est une autre manière de jouer. » (entretien avec Pascal Battus du 13 juin 2017) 16 Les boules chinoises de Frédéric Blondy vont par exemple servir à produire une multitude de sons : des sons de percussions Article 1 fortissimo en frappant les boules directement sur la table d’harmonie ; des distorsions, lorsqu’elles vibrent en combinaison avec un ou plusieurs ebows ; des sons détempérés lorsque Frédéric Blondy les fait glisser sur les cordes entre le chevalet et les pointes d’accroche ; des « sons de galet » en faisant rouler les boules sur les chevilles à l’extrême gauche du piano ; etc. De même, une simple baguette en métal va servir assez naturellement à Jérôme Noetinger à produire des sons percussifs (en la frappant régulièrement sur la bande magnétique de son Revox), mais aussi à effacer les sons préalablement enregistrés sur la bande du magnétophone (en maintenant une pression continue sur la bande). Quant aux ballons qu’utilisent Thierry Madiot ou Christian Pruvost en guise d’embouchure (voir figure 3), ils leur permettent une impressionnante variété de modes de jeu : balayages harmoniques, sons graves et granulaires, claquements percussifs, cris d’alarme ou textures multiphoniques, et sans doute bien d’autres encore. Comme le rappelle Christian Pruvost : Élaborer son dispositif d’improvisation… généralement aux musiciens interrogés de trouver un équilibre entre diversité et maniabilité. Les objets utilisés par les improvisateurs sont en effet rarement cantonnés à un seul usage ; au contraire, intégrer un objet à son set d’improvisation consiste précisément à trouver comment démultiplier ses usages : Figure 3 : Thierry Madiot : trombone et ballon. 73 Clément Canonne « On se disait avec Thierry [Madiot], c’est comme que là, peut-être qu’au départ je l’ai plutôt pris [ce ressort] une anche multiple à forme et à géométrie variable. Donc pour répéter ce truc mais une fois que je l’ai eu en main, à partir de là, c’est infini, il n’y a pas de limites, on trouve ça a amené à autre chose, alors que s’il a un seul usage, la sans cesse de nouveaux sons. » (entretien avec Christian piste se ferme tout de suite. » (entretien avec Arnaud Rivière Pruvost du 6 février 2018) du 12 octobre 2017) Il s’agit donc non seulement de pouvoir produire une large palette de sons avec un seul et même objet pour ne pas se retrouver « bloqué » trop rapidement avec un objet ou « coincé » en cas de changement abrupt dans la musique, mais encore de permettre aux objets eux-mêmes de suggérer de nouvelles pistes, comme l’explique très clairement Arnaud Rivière en commentant la manière qu’il a eu de se servir d’un petit ressort au cours d’une performance : Enfin, le fait de détourner les objets (et donc de les utiliser d’une manière qui n’avait pas forcément été anticipée par leur concepteur), de les altérer matériellement, ou d’utiliser des objets récupérés (et donc présentant éventuellement des défauts ou des imperfections) permet aux musiciens d’introduire une certaine imprévisibilité au cœur même de leurs dispositifs d’improvisation. Utiliser une pomme de pin pour frotter sur la peau d’un tom ou d’une grosse caisse (voir figure 4), comme le font Toma Gouband ou Lê Quan Ninh, est ainsi hautement imprévisible, en raison de la géométrie particulière de la pomme de pin : « S’il n’y a qu’une seule fonction pour chaque objet, du coup, à chaque fois que je vais le prendre dans la main, je vais savoir exactement pourquoi je l’ai en main, alors 74 Figure 4 : La batterie de Toma Gouband, qui associe pierres et pommes de pin. comme j’ai une longue pratique du frottement sur la peau, je sais par mémoire que la pomme de pin va être encore plus grasse sur la peau, plus épaisse en termes de son, qu’une simple tige en métal, par exemple. Mais je ne vais pas savoir exactement ce qui va se passer parce qu’avec la pomme de pin on ne sait jamais… donc je vais la frotter et là, peu importe l’intuition qu’il y avait, de toutes façons, c’est toujours déjà différent. » (entretien avec Lê Quan Ninh du 26 novembre 2017) 1 « Il y a un mouvement infime qui fait que l’objet va être plus ou moins en contact. C’est ça qui permet d’avoir de toutes petites choses. Si je le mets en contact, ça fait « [l’accident], c’est un bout de ma pratique. C’est un du son continu, voire des hauteurs. Mais des fois ça arrive accident qui est aussi heureux que le reste, qu’un geste que sans que ça soit voulu. Quand ça arrive, j’ai la sensation j’aurais voulu… il y a un truc où l’intention n’est plus si claire dans les mains, et donc là, je suis capable de le reproduire… entre ce que moi j’envoie et ce que le dispositif renvoie lui- ou en tout cas plus facilement, parce que je viens de le même. » (entretien avec Arnaud Rivière du 12 octobre 2017) jouer, donc je sais que c’est à tel endroit, selon tel angle, là je sais que je peux le faire comme ça. C’est aussi pour ça que j’ai besoin de beaucoup pratiquer avant de jouer, parce que j’ai besoin de me remettre les trucs en main, c’est plein de sensations qui sont de l’ordre de l’infime, avec plein d’informations sur le poids, l’angle, la manière de tenir, il y a trop de choses que je ne peux pas retenir… et puis je m’en fous, j’aime bien ce côté d’être surpris par ce qui arrive, et puis voilà. Mais c’est vrai qu’il y a sans doute plus de la moitié des sons que je fais, j’ai une idée de comment ça sonne parce que je connais le matériau mais je ne sais pas quel son va sortir. » (entretien avec Pascal Battus du 7 novembre 2017) Il y a évidemment un lien très fort entre la recherche de nouveaux usages pour les objets et la création d’un instrument qui dispose d’une agentivité propre – et ce notamment par son potentiel d’imprévisibilité. En un sens, c’est l’imprévisibilité (relative) de l’instrument qui permet à l’improvisateur de découvrir de nouveaux usages pour les objets qui lui sont associés ; et, réciproquement, c’est le fait de disposer d’un répertoire d’objets dont les usages sont toujours mouvants qui permet de maintenir l’instrument au Article 16 De même, les surfaces rotatives de Pascal Battus lui permettent d’atteindre un point d’équilibre entre reproductibilité et imprévisibilité. Le dispositif est en effet construit autour d’un disque de banc de montage récupéré qui présente une très légère oscillation quand il est en rotation – oscillation qui rend plus aléatoire le contrôle de la pression appliquée à l’objet : Certains dispositifs sont par ailleurs intrinsèquement générateurs d’accidents. C’est par exemple le cas du dispositif joué par Arnaud Rivière. D’une part, il est construit autour d’une table de mixage en feedback à laquelle s’ajoutent de nombreux micro contacts, d’où une production souvent accidentelle de buzz et autres larsen. D’autre part, le musicien utilise aussi des petits moteurs pour mettre en vibration certains objets ou produire des sons percussifs de manière autonome. Non seulement ces moteurs menacent toujours de s’arrêter (puisqu’ils tournent avec des piles récupérées plus ou moins vides) mais encore ils risquent, par le mouvement qu’ils provoquent, de faire tomber d’autres objets. Mais comme le rappelle Arnaud Rivière en commentant une de ses performances au cours de laquelle il avait précisément éteint de manière accidentelle son tourne-disque en voulant retourner le disque de métal qu’il y avait placé et qui ne tenait pas bien en place, Élaborer son dispositif d’improvisation… « Je sais que si je frotte avec une pomme de pin, 75 Clément Canonne « bon » degré d’imprévisibilité. Autrement dit, les objets ne « suggèrent » pas passivement leurs usages au musicien comme autant d’affordances d’action (Gibson, 2014) ; au contraire, l’improvisateur découvre ces usages en manipulant effectivement ces objets dans le temps de la performance, au contact d’un dispositif partiellement imprévisible. Les instruments d’improvisation sont donc fondamentalement des machines à sérendipité, qui favorisent le surgissement de « trouvailles » sonores ou d’usages alternatifs : « Je ne pense pas à me dire : tiens, j’ai envie de tel son, comment je pourrais le produire ? A priori, c’est plutôt l’objet qui… je perçois qu’un objet va avoir des fonctions multiples qui vont pouvoir être intégrées au set et du coup, en le manipulant, peu à peu, les fonctions qui vont m’être utiles à moi, dans ce dispositif, apparaissent. Il y a vraiment un truc de trouvaille. » (entretien avec Arnaud Rivière du 12 octobre 2017) Ce sont peut-être les surfaces rotatives de Pascal Battus qui constituent le plus bel exemple de « machine à sérendipité ». Pascal Battus utilise notamment en guise de surfaces des matériaux caractérisés par leur friabilité : presser une barquette en polystyrène contre un disque en rotation rapide, c’est évidemment accélérer son usure et, à terme, provoquer une fêlure. Mais loin d’être synonymes de la mort de l’objet, ces fêlures sont au contraire l’occasion de découvrir de nouveaux sons, ou de nouvelles techniques de jeu – comme le fait d’alterner rapidement entre plusieurs doigts sur le côté de la barquette pour créer un tremolo de timbre : « Il va y avoir une barquette qui va casser, ou il va y avoir une fente, et là je la casse complètement, ou alors c’est 76 pendant un concert, et dans le feu de l’action… là d’ailleurs, tu vois, celle-là aussi elle est en train de se péter… ce qui est bien, c’est que ça donne aussi d’autres possibilités sonores [il essaye et produit une sorte de sifflement très aigu]. Et puis après, elles finissent par casser, mais j’utilise même les petits bouts comme ça, je peux les utiliser pour faire des [tremolo de timbre], j’ai trouvé ça au bout d’un moment. » (entretien avec Pascal Battus du 7 novembre 2017) Si le hasard joue évidemment ici un rôle important, on reste néanmoins très loin des dispositifs que l’on rencontre plus typiquement au sein de la scène noise, qui favorisent les couplages complexes et hétérodoxes de composants électroniques dans le but de produire des résultats inattendus. Autrement dit, la logique de ces instruments d’improvisation est moins celle de l’empilement hasardeux, voire invraisemblable – à la manière des mécanismes à la Rube Goldberg décrits par Grimaud, Tastevin et Vidal (2017), qui cherchent à « obtenir moins avec plus », à démultiplier les composantes et les étapes de circulation pour garantir l’imprévisibilité du processus – que celle du creusement ou de l’approfondissement qu’autorise la maîtrise technique. La plupart des improvisateurs interrogés passent en effet énormément de temps à pratiquer leurs instruments, et laissent toute sa place à l’idée d’une manipulation virtuose du dispositif, qu’il s’agisse de précision (des gestes instrumentaux) ou de vitesse (dans la modification de l’agencement du dispositif). Cette manipulation virtuose – voire acrobatique (Stoichita, Grimaud & Jones, 2011), dans l’équilibrage subtil et fragile qu’elle suppose des multiples points de contact entre l’improvisateur et son instrument – participe en tout cas fortement du caractère inouï des sonorités que les musiciens parviennent à tirer de leurs instruments et, partant, de l’émerveillement qui peut saisir 16 Conclusion 1 On l’a vu, le rapport des improvisateurs à leurs instruments se caractérise par une très grande diversité de « prises » matérielles. Mais après tout cette diversité n’est surprenante que si on la rapporte à la relation qui unit les interprètes à leurs instruments dans le monde de la musique savante occidentale, si bien exemplifiée par la figure du pianiste – à la fois extérieur à son instrument (et ce d’autant plus que les pianistes jouent souvent sur des instruments qu’ils ne connaissent pas) et déléguant à d’autres les opérations matérielles susceptibles d’être réalisées sur l’instrument (à commencer par son accord). Car partout ailleurs, les appropriations matérielles de l’instrument par l’instrumentiste sont plutôt la norme : les « baroqueux » fabriquent leurs anches de basson ou ajustent soigneusement la mécanique de leur clavecin ; les violonistes 6 En cela, la pratique des improvisateurs que j’ai pu interroger obéit assez nettement au « régime de singularité » qui, selon Nathalie Heinich, gouverne le monde de l’art moderne depuis l’époque romantique (voir Heinich, 2016). Élaborer son dispositif d’improvisation… traditionnels auvergnats utilisaient des clés ou des lames de couteau au contact de leur violon pour imiter le son d’autres instruments, comme la cornemuse ; et plus largement, un très grand nombre de musiciens de par le monde fabriquent tout simplement euxmêmes leurs instruments. En un sens, les improvisateurs que j’ai rencontrés s’inscrivent donc dans un rapport à l’instrument qui n’a rien d’extraordinaire – si ce n’est que, précisément, l’appropriation matérielle est ici envisagée comme un moyen essentiel de singularisation au sein d’une communauté de pratiques 6 . Mais il ne faudrait pas non plus se méprendre sur le rôle exact joué par les objets – et plus généralement les altérations matérielles – dans la pratique de ces improvisateurs. À bien des égards, toutes ces prises matérielles – adjonction d’objets, altérations, détournements – qu’exercent les improvisateurs sur leurs instruments peuvent être considérées comme les étapes d’un processus d’involution instrumentale visant à mettre l’improvisateur en contact direct avec la matière sonore elle-même, par-delà la sophistication des médiations techniques qui caractérise bien souvent les instruments de la musique occidentale. Pour reprendre la critique générale que Tim Ingold (2013) adresse aux approches anthropologiques de la culture matérielle, l’analyse des objets manufacturés qui nous entourent et avec lesquels nous interagissons ne doit pas faire oublier l’importance que revêtent les Article l’auditeur quand il entend « chanter » les deux barquettes en polystyrène de Pascal Battus à une quinte juste d’intervalle, ou quand Frédéric Blondy convoque son « jardin japonais » en mettant progressivement en vibration une multitudes de préparations disposées dans tout le piano. Qu’il s’agisse de bricolages visant à optimiser les moyens de la production du son, de détournements visant à démultiplier les usages possibles pour un même objet ou de l’exploitation du potentiel d’imprévisibilité d’objets récupérés, les pratiques caractéristiques du hacking jouent donc un rôle fondamental dans l’élaboration d’un dispositif qui soit à même de satisfaire ce qu’attendent les musiciens d’un instrument dédié à l’improvisation. 77 Clément Canonne 78 matériaux dont tous ces objets sont faits, et le rôle qu’ils jouent dans la manière que nous avons de nous représenter notre rapport aux objets. De même, la matérialité manifeste de tous ces instruments ne doit pas occulter le fait que cette prolifération matérielle est souvent pensée par les improvisateurs non comme une fin en soi – qui ramènerait le travail de l’improvisateur à une pratique de la sonification ou à une « musique d’objets » – mais comme un moyen d’accès au flux vivant de la matière sonore. À mille lieux d’une pratique hylémorphique de l’improvisation – qui verrait le musicien sculpter, par la seule force de sa volonté musicale, une matière sonore inerte – tous ces instruments donnent au contraire à voir une pratique de l’improvisation que l’on pourrait qualifier de « longitudinale » – dans laquelle les musiciens s’efforcent de faire avec un flux de matière sonore qui a sa vie propre, d’interagir avec une matière qui possède sa résistance, son grain et sa directionnalité – et dont les ballons de Thierry Madiot fournissent peut-être l’illustration la plus parlante : « Moi, je ne fais que souffler, après c’est le ballon qui fait. Donc il faut être à l’écoute du matériau, de ce qu’il propose… il faut accepter ces transitoires, ces minutes bordéliques pour obtenir quelque chose qui se passe, et qui soit particulier. Donc tu as une zone de travail, une zone de sons, d’énergies à mettre en route, et après tu dois faire avec. » (entretien avec Thierry Madiot du 12 octobre 2017) Tous ces improvisateurs s’inscrivent donc par-là très clairement dans la démarche d’émancipation qui caractérise centralement le mouvement des hackers : mais plus qu’à une libération de l’information contenue dans les objets techniques, c’est bel et bien à une libération de la matière même des instruments qu’ils nous invitent. Auray Nicolas (2000), Politique de l’information et de l’informatique. Les pionniers de la nouvelle frontière électrique, Thèse de Doctorat en sociologie, EHESS. Bailey Derek (1999), L’improvisation : sa nature et sa pratique dans la musique, Paris, Outre Mesure. Berrebi-Hoffmann Isabelle, Bureau Marie-Christine & Lallement Michel (2018), Makers. Enquête sur les laboratoires du changement social, Paris, Seuil. Canonne Clément (2010), « Enseigner l’improvisation ? Entretien avec Alain Savouret », Tracés, no 18, p. 237-249. 16 1 Gibson James (2014), L’approche écologique de la perception visuelle, Bellevaux, Éditions Dehors. Heinich Nathalie (2016), « L’art en régime de singularité : quelques caractéristiques sociologiques de l’art contemporain », in Quemin Alain & Villas Bôas Glaucia (eds.), Art et société : recherches récentes et regards croisés, Brésil/France, Marseille, OpenEdition Press, en ligne : https://books.openedition. org/oep/530. Ingold Tim (2013), Making : Anthropology, Archeology, Art and Architecture, New York, Routledge. Keep Andy (2009), « Instrumentalizing : Approaches to improvising with sounding objects in experimental Music », in Saunders James (ed.), Ashgate Research Companion Experimental Music, New York, Routledge, p. 113130. Kelly Caleb (2009), Cracked Media : The Sound of Malfunction, Cambridge, MIT Press. Lallement Michel (2015), L’âge du faire : hacking, travail, anarchie, Paris, Seuil. McKenzie Wark Kenneth (2006), Un manifeste hacker, Paris, Criticalsecret. Nicollet Gérard & Brunot Vincent (2004), Les chercheurs de sons, Paris, Éditions alternatives. Stoichita Victor A., Grimaud Emmanuel & Jones Graham (2011), « Préambule. De la technique comme contorsion », Ateliers d’anthropologie, no 35, en ligne : https://journals.openedition.org/ ateliers/8838. Élaborer son dispositif d’improvisation… Allard Laurence (2010), Mythologie du portable, Paris, Le cavalier bleu. Grimaud Emmanuel, Tastevin Yann Philippe & Vidal Denis (2017), « Low tech, high tech, wild tech. Réinventer la technologie ? », Techniques & Culture, no 67, p. 1229. Article Bibliographie 79 on hysteresis as a metaphorical practice of hacking, i.e. disrupting social conventions, processes, and practices, ultimately changing the field of the chipscene. Knowledge of limitations: hacking practices and creativity ideologies in chipmusic Keywords: Chipmusic / creativity / digital culture / electronic music / ethnography Résumé : L’objet de cet article est la chipmusic et sa scène. Nous y examinons l’influence du pratiques de hacking sur ses conventions sociales et ses pratiques culturelles. L’article porte plus précisément sur les contraintes du genre, et sur deux types connaissances que les praticiens en tirent : les connaissances pratiques et les connaissances propositionnelles. La chipmusic est un sous-genre de la musique électronique, à l’esthétique 8-bits typique, qui tire ses principes d’une subculture informatique amateure l’ayant By Marilou Polymeropoulou (School of Anthropology and Museum Ethnography, University of Oxford) 1 abordons l’éthique et les objectifs des hackers, ainsi que la manière dont ceux-ci ont été mis en œuvre au sein de la scène démo et transmis à la scène chipmusic. À l’aide Abstract: This paper centres on chipmusic and the chipscene, de la théorie bourdieusienne de l’habitus, de la doxa et exploring the ways in which hacking practices and processes de l’hystérésis, nous analysons les résultats d’enquêtes inform social conventions and cultural practices. The central de terrain centrées sur la fertilité créative des contraintes. axis of this paper evolves around limitations and the kind Nous commençons par étudier le détournement de logiciels of knowledge that their exploration offers to the interested et les techniques de composition permettant de travailler learner. Two kinds of knowledge are explored here: practical avec les contraintes technologiques des puces sonores and propositional. In the paper, chipmusic is presented as sur les plateformes de chipmusic. Nous analysons ensuite an electronic music subgenre characteristic of 8-bit sound l’impact du piratage de hardware sur la chipmusic. Nous aesthetics, sharing common ideologies with its predeces- nous intéressons enfin à l’hystérésis en tant que pratique sor, the demoscene, a hobbyist computer subculture that métaphorique du hacking, le bouleversement des conven- emerged in the 1980s. I explore hacker ethos and aims, as tions, des processus et des pratiques de la scène chipmusic, well as the ways in which these were demonstrated in the qui transforme son champ. demoscene, and how they were transmitted as values in the chipscene. The paper applies an analytical framework Mots-clés : Chipmusic / créativité / culture numérique influenced by Bourdieu’s theories of habitus, doxa, and / musiques électroniques / ethnographie hysteresis. Through this analytical perspective, I analyse the ethnographic findings from fieldwork in the chipscene that explore the creative dimensions of limitations. First, I discuss software hacks and composing techniques that were Article 16 précédée – la scène démo née dans les années 1980. Nous Knowledge of limitations: hacking practices and creativity ideologies in chipmusic Article impact of hardware hacking on chipmusic. Finally, I focus adopted to manipulate technological constraints of sound chips in chipmusic-making platforms. Second, I explore the 81 Marilou Polymeropoulou 82 In October 2012 while conducting fieldwork in Manchester, a local chipmusician, Sk8bit, was introduced to me. Meeting my ethnographic role as an unfamiliar stranger I explained to him that I was interested to learn more about chipmusic as my knowledge was rather limited. His response was immediate: “you know it’s all about limitations, don’t you?” assuming I have some pre-existing knowledge on the social conventions in chipmusic-making that places limitations at the center of its creative process of making. Sk8bit re-iterated ideas that were previously communicated to me by other chipmusicians across the globe, as for example, the idea of having total control over machines and the role of technological limitations in facilitating this. He analysed aspects of practical knowledge in the chipscene, the “know-hows”, explaining, for instance, how chipmusic composition is usually done on very few audio channels and this limitation urges one to be more “creative”, using tweaks and hacks to work around technological constraints that help develop new compositional methods by making the most of the available resources. This was a familiar narrative in the chipscene, but there were certain conflicts and discrepancies that I encountered throughout the years, as, for example, the emergence of fakebit as a genre that characterises chiptunes made on contemporary computers rather than the original means of production of chipmusic. While in the field, my research interest was quickly fixed on the idea of developing knowledge through hacking limitations, as well as the ways in which social conventions and cultural practices influence and imbue ideologies on creativity. Previous work on hacking in social sciences and humanities argues that to hack is to differ and to create opportunities of new things appearing in any production of knowledge where information can be collected (Wark, 2004: 3-4). One of the primary aims of hacking is to change the technological determinism that characterises pre-programmed machinery, enabling it to act in specific ways (Jordan, 2008). In addition, a hack is seen as unraveling ethical dimensions that extend to a product’s free distribution as a political stance against the capitalist status quo. The process of hacking relies on empirical engagement (Jordan, 2008)—it is a hands-on, trial and error process. A hack is even reified and attributed mystical properties, particularly in the case where the hacker has limited prior technical knowledge about the platform they are altering. Furthermore, the hacker work ethic is valued on the premise of creativity and how imaginatively one can use their own abilities by making surprising, unexpected contributions in the making process (Himanen, 2001). Although the act of hacking is a political, revolutionary act against the predetermined roles and functions of technology, its process is rather meticulous and allows exploration but within limits—there are safeguards in place for the safety of the makers. For example, Nicolas Collins’ book Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking (2006) offers an extensive list of hacking rules that any prospective maker should follow to ensure a successful and safe outcome. In all, hacking and hacker practices generally aim at creating something new by exploiting a pre-existing technological entity and manipulating its limitations. Within this process, new knowledge is developed—knowledge that is to some extent unrevealed to the everyday users of these technologies, laying hidden underneath the capacities of the software and hardware of the technological devices. This knowledge Knowledge of limitations: hacking practices and creativity ideologies in chipmusic 1 the concept of play is central (McAlpine, 2017). In this way, hacking offers new learning tools in music-making and this process of developing, discovering, and sharing knowledge creates communities of experts that underpin a do-it-together ideology, as Richards finds. Chipmusic falls at the crossroad of computer culture and electronic music, and hacker practices are central both in its creative ideologies and music-making practices. In this paper, I employ the aforementioned theoretical framework to explore hacking practices in chipmusic with the scope to construe propositional and practical knowledge that is produced by chipmusicians and shared across the chipscene network. This is the overt aim here; there is, however, a hidden aim, that is secondary but fundamental in understanding the impact of this shared chipmusic-related knowledge that is linked to hacker culture: to analyse the social dimension of chipmusic practices and the ways in which they inform creative and aesthetic ideologies. This is done by implementing Bourdieu’s analytical perspective (Bourdieu, 1977; 1992) that is emphasised by the exploration of the field of chipmusic, its doxa—a term that Bourdieu distinguishes from simple opinion, underlying that it encompasses the social conventions and cultural practices in a field—as well as the hysteresis effect that disrupts doxa and causes a field to change. On a level, the fundamental question in this paper is epistemological: how does hacking assist in the production of knowledge in chipmusic and what does that knowledge consist of? 1 Article 16 is more about unraveling the unseen potential of a platform, and ultimately, sharing this knowledge with other creators, as I will demonstrate later in this paper. In the field of electronic music, thinking of music hacking as a legitimised creative process is relatively common, both in musical practices and scholarly literature. Hacking has been studied both as a method of experimentation and sound exploration and a culture bearing its own norms and values. Kelly (2009) argues that the process of hacking media forces them to expand beyond their original functions and their point of rupture. This creative practice gives rise to new sounds to work with as well as new ways to perform by forcing media into failure and by manipulating any mediating technologies (Kelly, 2009: 6). In addition to its creative aspect, there is a societal dimension to hacking, in which its social organisation unravels. As previously argued, hacking is a political stance and it has been analysed as such, as for example in McKenzie Wark’s A Hacker Manifesto (2004) in which in which its culture is interpreted within a Marxist perspective, the author considering that its class ethos goes against the ruling class’s norms and values as well as market expectations. Further to this, Richards (2013) discusses the idea of community-building through hacking in electronic music and the ways in which shared experiences enrich the development of collective knowledge. Anyone from any educational, social, and cultural background can become a hacker, and there is a learning curve to it facilitated through trial and error. This suggests that hacking is closely connected to improvisation practices, which in music, can be seen as a lab of learning (Canonne, 2012: 7). Hacking offers an educational, improvisational experience, in which 1 Due to the scope and limitations of this paper, I will not indulge in a philosophical analysis of epistemic knowledge. 83 Marilou Polymeropoulou 84 Hardware limitations and software-hacking solutions in the creative process of the demoscene Chipmusic is a kind of electronic music characteristic of 8-bit computer sound aesthetics that has its roots in the demoscene, a computer hobbyist subculture that emerged during the 1980s. A key feature of the demoscene was the sharing of knowledge via various communication channels: locally-based groups, internet-mediated Bulletin Board Systems (BBS, the predecessors of online communities), and international gatherings called demoparties. In the 1980s early home computers, also called microcomputers, such as the Atari ST, Amiga, and Commodore 64 became an affordable commodity that offered users the opportunity to spend leisure time and develop new skills by playing videogames and learning how to create programs respectively. The computer revolution that followed was an emergent market for computer programs and videogames. In this time, the hacker ethic was formed and communicated in ways that influenced the ideologies in the demoscene. Certain hacker groups cracked commercial releases and removed the limitations of copy protection from computer software and videogames, and distributed them freely after tagging it, by means of adding a short introductory audiovisual sequence at the crack or the program itself, where the hacker team name and date of cracking were made known, thus giving the hacker group street credibility (Tasajärvi, 2004: 12). The message was clear: “we did this first, you couldn’t do it, so we’re cool”. By the mid-1980s these sequences which were short introductions, were released as separate productions. They were called demos and were short audiovisual clips in the form of executable programs aiming at demonstrating the skills of the coder and the creative use of the computer (Reunanen, 2010: 46-47). In line with Himanen’s and Jordan’s arguments, these creative products that emerged from the manipulation of legal software limitations reflected the free and open source hacker work ethic in which creativity is valued on the basis of how imaginatively one’s own abilities were used towards an impressive contribution. Early music-making in microcomputers was done by means of coding audio sequences—based on the perceived and hidden affordances of the computer’s sound chip— that could not be played-back until they were compiled in a programme (Polymeropoulou, 2015). 2 As gwEm put it: “In the early 1980s all the original chiptuners (Rob Hubbard, etc.) wrote their music directly as a program without a tracker or any music software at all. You would need to write the music without listening to it a lot of the time. You would write some music, and then to hear what you did you 2 For example, as Newman (2017) finds, the ability of the SID chip in the Commodore 64 to replay samples was a hidden affordance that was not an intended feature, rather, it was possible through the exploitation of a bug of the SID chip. process easier, but the first ones were still very limited and barely better than hand coding. At least you could listen to the music without compiling the code first (!)” (gwEm, personal communication, 2012) 16 1 Traditionally, music had to be coded in Assembly language; for example the Sound Interface Device (SID) chip of the Commodore 64 (C64) could be manipulated through 29 8-bit registers (Newman, 2017). Videogame music composers of the time were proficient in coding music. Towards the end of the 1980s, software that allowed to manipulate the sound chips in real time emerged. The first tracker, as this software came to be called, was Soundtracker (1987) created by Karsten Obarski for the Commodore Amiga. Trackers were used both for composition and playback of music. This meant that anyone with access to a tracker and the tracker file of a chiptune could hack into the code, edit the tune, and create new samples by re-appropriating another’s code—this was mainly done on the Amiga since the MOD file format was more standardised (Carlsson, 2008). This technique was used in the demoscene to create one’s sound palette, using, manipulating, and appropriating sound samples from other videogame composers or recording artists. Following this, a demo could be shared in the digital and/or physical demoscene network. In this way, sampling and free distribution of creative works were prominent practices that embedded hacker ethic: re-using previous material, supporting open source software distribution, and passing on free, accessible, and modifiable knowledge. Knowledge of limitations: hacking practices and creativity ideologies in chipmusic written by these musicians to help making the composing The initial aim of demosceners was to find new, impressive ways of rendering graphics, while working around technological constraints such as file size—which was often limited to 4kb—and microcomputer affordances. Demoscene was meritocratic (Carlsson, 2009) and creators were rewarded based on the quality of their work.Their social capital in the demoscene was not influenced by their socio-economic background, it was solely based on their work profile, through which credibility was gained. Meritocracy in the demoscene gave rise to structural inequalities. Hardworking demosceners who produced quality work were labelled as “elite” (also written L33T), whereas demosceners who copied others’ work were called “lamers”. This class division signified when cultural capital was at stake. Elite and lamers’ actions were distinguishably characteristic of the doxa of the demoscene field, that is, the unwritten rules of the game and the underlying practices in the field that go without saying. For example, an elite demoscener created their own samples, coded demos that were characteristic of algorithmic elegance as Menotti Gonring (2009) has suggested—this elegance was underpinned by the efficacy of the subjacent code of the demo. In contrast, a lamer would borrow other demosceners’ samples and often plagiarise them—the urge for avoiding this was voiced especially in the Amiga scene where creators would tag their MOD files with the phrase “Don’t steal my samples” (Carlsson, 2008) and this showed how ownership values had penetrated the demoscene both to protect the social status of the individual and the “legal” owner, despite the paradox that even original samples could be deconstructed samples of another’s work. Article would need to compile your program. […] Later trackers were 85 Marilou Polymeropoulou Demosceners that focused on developing the sound aspects of demos, that were already called chiptunes, were the instigators of the chipscene. In a sense, chipmusic was an outcome of a hysteresis effect of the demoscene field. Demosceners that focused solely on music-making changed the field towards a new direction that later became a sub-field within the dominant field of the demoscene: the chipscene. Chipscene doxa, however, was founded upon the norms and values of the demoscene as the demosceners’ habitus did not change overnight. This resulted in the formation of the creative ideology that encompassed chipmusic-making. Propositional knowledge embedding hacker ethic and practices was transferred into the chipmusic-making creative process, and even expanded towards the evolution of hardware hacking. Composing hacks and techniques: manipulating technological constrains in chipmusic 86 In the history of 20th century music, control was a key concept. Some composers wanted to break the musical conventions and rules that had been going on for centuries. Edgar Varèse famously said “I dream of instruments obedient to my thought and which with their contribution of a whole new world of unsuspected sounds, will lend themselves to the exigencies of my inner rhythm.” This world of unsuspected sounds is somewhat explored by chipmusicians and their exigencies of inner rhythm and timbre. Early chipmusicians employed the same technological devices as the demosceners, which meant that they were already aware of sound chip affordances. They had already inherited knowledge from the demoscene on how to manipulate the limitations of the sound chips. With the emergence of the demoscene and the developments in Internet mediated communication, sharing knowledge through online chipmusic communities such as Micromusic.net and 8bitcollective.org was easier and quicker. Online communities enabled users to learn about chipmusic-making platforms and sound chip limitations, and also functioned as chipmusic places, allowing chipmusicians around the world to upload chiptunes, listen to others’ compositions, communicate with others instantly or in a discussion forum. Online communities were the places on which chipmusic culture sat; in this way, these online places became the digital hubs of chipmusic activity. Chipmusicians applied previous knowledge to their creative practices and expanded hacker practices to new platforms that were adopted in the chipscene such as the Nintendo NES and Game Boy. The aforementioned platforms were rather different to microcomputers in the sense that they were solely used for playing videogames. Composing music for these platforms can be done internally or externally to the actual hardware. First, direct composition on the platform can be realised by using specialised tracker software cartridges such as Nanoloop and Little Sound DJ that were developed by Oliver 1 Soundchip/kind Channels DAC resolution Atari VCS/2600, videogame console 8-bit TIA (video and audio), PSG 2 1-bit Atari 400/800, home computer 8-bit Pokey, PSG 4 8-bit (combined 16-bit) Atari ST, home computer 16-bit YM2149, PSG 3 8-bit (combined 16-bit) Commodore Amiga 1000/500, home computer 16-bit Paula, PCM 4 8-bit Commodore 64, home computer 8-bit SID, PSG 3 8-bit Nintendo NES/Famicom, videogame console 8-bit RP2A03, CPU integrated 5 4-bit Nintendo Gameboy, videogame console 8-bit PAPU, CPU integrated 4 4-bit Table 1: The main chipmusic platforms and their sound chips. Wittchow and Johan Kotlinski respectively, two developers and musicians who hacked the Game Boy, manipulating its CPU-integrated PAPU chip, and turning the platform into a portable synth. Second, composition can be done indirectly, by using trackers such as the Famitracker on computers and then playing the completed chiptunes on the original hardware. In all cases, the sound chip is central in the making process, and all methods aim at manipulating its affordances. There are four kinds of technological constraints that chipmusicians attempt to expand, as Dittbrenner has found. These are divided in constraints internal to the sound chip, such as polyphony and timbre, and external to it, like processor speed rate and frame rate. Table 1 summarises the characteristics of microcomputers’ sound chips used in chipmusic-making. I distinguish between computer architecture (CPU) and audio resolution (bit depth of a digital signal)—when discussing “8-bit” in chipmusic, this could refer to either categories. For example, the Atari 400/800 series and its sound chip, Pokey, are based on 8-bit computer architecture and sound resolution. However, Knowledge of limitations: hacking practices and creativity ideologies in chipmusic 16 CPU resolution Article Platform/type 87 Marilou Polymeropoulou 88 the channels in Pokey can be combined for up to 16-bits of frequency resolution. This means that the Pokey has a wide frequency range (Tomczak, 2011: 93). More bit resolution does not suggest that music is of greater quality for chipmusicians—whereas audiophiles would argue that the quality of sound is proportional to sound resolution. Sound quality in chipmusic has a different notion: the sound chip’s performance is reified and in some cases, it is attributed mystical aspects. For example, with the SID chip, every performance of the same song can sound differently due to the technological peculiarity of the chip (Kummen, 2018: 14). Although there have been different versions of the SID chip, most chipmusicians prefer the original 6581 chip due to the quirkiness of the hardware: to control the cut-off frequency, field-effect transistors (FET) were used as voltage-controlled resistors. However, the FETs varied in resistance, resulting in the variable behaviour of the filter cut-off (McAlpine, 2019: 80). This is one aspect of the SID that makes it special for chipmusicians. This argument regarding sound quality became more prominent following a hysteresis effect in the chipscene: the emergence of computer-based sound chip simulation software that allowed chiptune composition on any home computer, thus bypassing the manipulation of technological limitations as the sound chip was not present in music composition nor playback. Different sound chip technologies therefore affect sound properties such as timbre and this can develop social implications in the chipscene. As noted on table 1, there are two types of sound chips: Programmable Sound Generators (PSG) and Pulse-Code Modulation (PCM). PSG produce sound waves (square, triangle, sine) and noise, whereas sound chips based on PCM reproduce digital samples. In the case of the Nintendo videogame platforms the sound chip is integrated in the Central Processing Unit. All these different technical specifications result in variations of timbre. The Amiga sound chip Paula, for example, does not have any on-board oscillators. All sounds are digitally produced in four channels with the aid of the CPU with 8-bit resolution. The use of samples in Paula distinguish its sound but its aesthetics are closer to synthesizers. In the demoscene, sampling was originally a norm in the Amiga scene,Ò as previously explained. Following cases of lamers who stole samples, the sampling technique was devalued. As chipmusic ideology transformed, purist evaluative notions affected chipmusic-making ideologies. For example, for purist chipmusicians, PCM is inferior to PSG as only in the latter one can sounds be created from scratch. While in the field, I found certain Amiga-based composers rejected the “chipmusician” label as their composing practices deviated from the purist perspective that imbued chipmusic doxa. As Tempest explained: T: I’m not really familiar with the sound synthesis formats on Amiga (so-called real chiptunes)—I’m mostly fakebit, remember? MP: Where do your samples come from? T: I’ve used a lot of drum samples that originate from the Commodore 64. So they are sampled versions of chip-generated sounds. I think it’s just a big grey area. (Synchronous discussion online with Tempest, 2013) Tempest utilised samples when composing chiptunes on Amiga and sampling often was not considered a legitimate practice 3 See, for example, the comments on the release of Fanta in Space: https://csdb.dk/release/?id=72563, accessed 14 July 2019. Knowledge of limitations: hacking practices and creativity ideologies in chipmusic 1 a single SID channel: he created an arpeggiated chord, cycling around two more more notes at 50Hz, setting them on fast tempo to create a chordal effect. The arpeggiated chord has become a central compositional technique in chipmusic (McAlpine, 2019: 100) and can be found in various chiptunes, see for example, Chipzel’s Breathless (main melodic pattern), AlexOgre’s Midnight Magic (intro), and Omodaka’s Plum song (syncopated chords played throughout). As Carlsson explains, arpeggiated chords provide rich harmonic structure in chiptunes, which can be achieved by employing one channel only, allowing other channels to be occupied by bass lines, percussion, and main melodies (Carlsson, 2010: 18). Hence, arpeggiated chords became a norm in chipmusic-making, primarily as they overcome imposed technological constraints. This is a soft hack that has significant influence on the musical style of chipmusic. Another compositional technique was developed by Hubbard, who coded drumlike sounds within the three chordal composition channels of the Commodore 64, thus creating the sensation that a fourth, implied percussion channel was present (see, for example, his music for the game Monty on the run). There have been further attempts to exploit the affordances of the sound chips. The Human Coding Machine and SounDemoN (Fanta team) pushed the SID chip beyond its limitations as demonstrated in X’2008 demoparty, achieving six channels on the C64: four channels of 8-bit samples (digital playback), two channels of SID synth sound, allowing the user to filter both SID channels and samples (see the relevant demo Fanta in space). The challenges posed by technology were unavoidably Article 16 as it hindered creativity, implying that re-using and adapting others’ samples could lead to plagiarism. This evaluative perspective has its roots in the demoscene. Sampling, according to purists, did not allow the creator to compose everything from scratch; instead, the creator relied on re-using ready-made material. Fanta, a demogroup, although they pushed the C64 to the extent they doubled the available channels for music composition, were criticised by certain demosceners as two channels were for samples—some comments can still be retrieved on the C64 scene database. 3 In the chipscene, similarly, sampling is not considered as an appropriate composing technique by some purists. Therefore, technological constraints can influence evaluative ideas that set chipmusic doxa, and in effect, the boundaries of chipmusic as a musical genre. The techniques of manipulation of the number of channels available for composition were largely influenced by videogame composers’ techniques. As table 1 shows, the number of channels in platforms varies from two to five. Early videogame music composers, such as Martin Galway and Rob Hubbard, were the first to explore the affordances of the sound chips, and their software hacks were adopted and often adapted by other music composers as composing techniques in the demoscene and the chipscene. Galway, who was inspired by Jean-Michel Jarre’s arpeggiators that utilised a series of notes played as chords, transferred this musical trope in the Commodore 64 on 89 Marilou Polymeropoulou 90 central in the early days of chipmusic-making out of necessity. As the demoscene and the chipscene developed, exploiting technological limitations became a reified process through which composers developed new knowledge by employing hacking skills and ideology. Thus, new compositional quirks and techniques became legitimised innovative ways to expand creativity. This technique was incorporated in the chipscene doxa as it does not oppose the ideological values of creativity. When using samples, as long as the original hardware console is utilised, this is acceptable by purist chipmusicians, which is not necessarily the case in the demoscene. Knowledge of compositional techniques have also been implemented in chipmusic to enable the manipulation of technological constraints. There are different techniques to tweak the sound chip to its fullest potential and to enrich the musical dimensions of a chiptune, for example, using pitchbend, portamento (see, for example, Chipzel’s Something beautiful which is characteristic of these techniques), vibrato (for example, Ultrasyd’s Chipdancers) and volume envelopes, which are used to imitate dynamics. This knowledge is shared with the chipscene, as hacker ethic would demand. There are various detailed educational guides on how to make chiptunes on the internet via online communities, and although this knowledge is open, it is expected that prospective chipmusicians will experiment with these techniques to achieve their desired outcome. These techniques have become stylistic tropes in chipmusic, creating a rich compositional palette that is imbued by the hacker ethic. One of the most commonly-used techniques in chiptune-making is looping. Initially, looping was used by videogame composers as a practical means to work around technological constraints. Looping involves the repetition of blocks of music. This creates various layers of rhythmic and musical patterns that are juxtaposed in a chiptune. Tempest finds that looping can sometimes challenge the flow of a chiptune: MP: Are there any musical flaws related to melody-making? T: Yeah, and many times to the structure of the tune. Because music made on trackers tends to be “blocky”. You polish and polish a 4 bar section. Then another one. And another. Then you try to connect these blocks. Continuity perhaps? MP: So in first place there’s a more vertical thinking, and then, horizontal. T: Yes! Good way to put it. (synchronous online communication, 2013) One of the fundamental characteristics of tracked music is that it is a vertical composition. Tempest referred to the composing process as a series of connections between “blocks” of music, which is a common concept in DJ culture discours when describing sampling techniques and the building of new musical formations. Image 1 depicts in BZE tracker one of Tempest’s chiptunes, Acidjazzed Evening. This is a four-channel chiptune (modfile tracks 0-3). Every note is written in hexadecimals and represents a sound frequency translated to pitch. The line that cuts across the channels in the middle shows which lines are played at the same time–it follows tracked music in a similar manner that the playhead does in Digital Audio Workstations (DAWs). However, in DAWs the playhead demonstrates playback in a linear, horizontal way, whereas in trackers it Figure 1: Screenshot of BZE tracker playing Tempest’s “Acidjazzed Evening” (2000). is exhibited vertically. The vertical layout of trackers often has an effect on how chipmusicians compose chiptunes. For example, one will notice that chiptunes sound “blocky”, as Tempest described, i.e. successions of 4-bar musical structures that the in-between connections are significant to support the flow of the melody. This compositional technique bears some similarities to a fugue: often chipmusic composition is contrapuntal, introducing an imitation at the beginning, which is not necessarily transposed to different pitches, advancing to a development, and finishing with the initial imitation. AcidJazzed evening is an alternation of three main music blocks; three thematic patterns. Block A is the primary melody and dominates the composition. The sequence is A/B/A/B/C/A/A-B/A. Block A uses the same rhythmic and harmonic structure with certain melodic variations. Block B functions as an ascending bridge, and C as an outro. Towards the end of the Marilou Polymeropoulou 92 chiptune, a mashed A/B section appears, utilising harmonic structures, rhythm, and melodies from both sections. This is also found in the finale, which introduces a new harmonic structure as a variation of the main two blocks. Although music blocks are apparent in this chiptune, Tempest’s melody flows throughout the composition. The use of these manipulative techniques has an effect on chipmusic sound as well as the aesthetics of chipmusic. From a theoretical perspective, chorded arpeggios, music blocks, and looping as stylistic characteristics resonate with Tagg’s concept of “musemes” that he dubbed as “minimal units of expressions” in popular music (1982: 45) as well as Middleton’s “musematic” repetition (1990: 269-270). Musematic repetition is the repetition of small sound units that in popular music are usually in the form of riffs. For Middleton, the purpose of riffs is to balance “the temporal flow, challenge any ‘narrative’ functionality attaching to chord patterns and verse sequences, and ‘open up’ the syntactic field for rhythmic elements…to dominate” (1983: 253). By examining blocks and arpeggios as musemes and looping as musematic repetition, one can unravel the sound palette of chipmusic. This can be seen in Acidjazzed evening—the main melody, which is the primary riff, balances well against the structural, “blocky” movement, creating melodic flow. Further to this point, chipmusic timbre is often characterised as “raw” by chipmusicians. In chipmusic discourse, rawness functions as an opposition to polished sounds that characterise commercial popular music productions—the quality of sound that audiophiles would argue for. Rawness is an intrinsic value of chipmusic sound, another reified attribute of its sound. Rawness offers flexibility, options, freedom—all of which are in line with the hacker ethic and ideology. Rawness allows hackability as it is a work in progress. From a post-structural point of view, to quote Levi-Strauss’s argument on the raw and the cooked, chipmusicians are “cooks” in a metaphorical sense, ensuring that raw sounds are well-prepared before their release. The “cooking” involves the manipulation of technological constraints, the process of software and hardware hacking. If anything, rawness characterises chiptune timbre and by association evokes positive emotions to chiptune enthusiasts. This suggests that rawness of sound is appealing in the chipscene; one characteristic that attracts the audience and also that enables the listener to recognise that a certain composition is a chiptune. Beyond soft hacking there is also hardware hacking in the chipscene. Hardware hacking aims at expanding the abilities of the platforms and enhancing their performativity. Hardware hacking in the chipscene can be realised by means of modding and circuit-bending. Circuit-bending is a form of hardware hacking and repurposing of electronics, turning them into musical instruments. It is primarily performed on the circuit board of a platform by short-circuiting and/or adding electronic parts, and hence, physical contact is central in its practice. The circuit-bending scene and the chipscene to some extent shared an audience for the first part of the 2000s, particularly in the New York area, where two large festivals were organised: Bent Festival and Blip Festival. These meetings provided the time and place for creators and makers to collaborate, learn, and expand their creative outlooks. Modding—not to be confused with the Amiga mod scene—refers to the practice of modifying a console by altering components Figure 2: A modded Game Boy (backlit screen, tempo potentiometer and on/off switch). on its circuit board. For example, figure 2 depicts a modded Game Boy that has a backlit screen, digital output, a potentiometer to alter time signature as well as an on/off switch for this feature. The added potentiometer and the on/off switch allow the user to alter tempo manually when using LSDJ. This added function can also be executed on LSDJ, but the physical potentiometer is more accessible when performing live. In addition to this mod, a back-lit screen has been added to the Game Boy. This is particularly useful when performing in the dark, for example, in clubs, bars and streets at night. These mods aim at rendering the Game Boy in a portable musical instrument to be used on stage. Modding assumes some knowledge of how the electronic circuit-board works, and it is less exploratory than circuit-bending, which relies more on chance and trial-and-error. Hardware hacking also extends beyond modding. One example is the gAtari, created by cTrix. For this, he used an Atari 2600, which is one of the most limiting platforms as it is only capable of 31 pitches and two channels, running Paul Slocum’s Synthcart (sequencer software), attached to Boss effect pedals and a fretboard to be played as a guitar. Another example is Jeri Ellsworth’s C64 bass keytar, which she presented at Maker Faire. The guitar body is a C64 and a bass neck has been attached to it. Jeri added piezo sensors to act Knowledge of limitations: hacking practices and creativity ideologies in chipmusic 1 Article 16 93 Marilou Polymeropoulou as pickups amplified via a Field Programmable Gate Array (FPGA) which connected to the SID chip. This musical instrument can be used both as a keytar, pressing the C64’s keys, altering between four waveforms, and a bass guitar, plucking the strings whose sound is filtered through the SID chip. In all, compositional hacks and techniques aim at bypassing technological limitations but most importantly, at offering new and creative ways for the production of musical knowledge in chipmusic, exploiting therenre’s limitations of the genre. As a result, these techniques influence the sound aesthetics in chipmusic, thus informing its doxa. Hysteresis, doxa, and the ideological framework of hacking in the chipscene 94 Considering that the chipscene emerged in the late 1980s/early 1990s, in its thirty years of existence, there have been different developments that influenced doxa and chipmusic-related knowledge in the field. There are various creative ideologies that underpin the chipscene and these can be seen as three distinguished generational classes: purists, artists, and chipsters. It should be noted that the three generational classes are not defined by economic status, age, or experience. These classes are the repositories of chipmusic-making ideologies that are entirely subjective based on the internal perspective of each generation. For example, purists reckon they are the closest to the ideal, sublime creation of chipmusic, and that any lesser creations utilising samples or simulated sound chips, are of lesser quality. Artists see themselves as the instigators of the mobile revolution and the popularisation of chipmusic, thus expanding to popular music audiences. Finally, the chipsters focus on chipmusic aesthetics rather than reifying hardware platforms. In this section, I aim at analysing the ways in which hacking practices are nuanced in the three generational classes, influencing their respective ideologies on creativity. It should be noted that generational class ideologies are fluid with regards to the participation of chipmusicians as one can adhere to any ideology they wish and move freely between the different classes. This suggests that a chipmusician can begin as a purist but transcend in the second generation and vice versa. Previously in this paper I analysed how demosceners, videogame music composers, and chipmusicians have inspired the chiptune practices. The first generation of chipmusicians, the purists, is linked ideologically to the demoscene (Carlsson, 2008; Nova, 2014; Pasdzierny, 2012; Polymeropoulou, 2015; and Tomczak, 2011). The shared hacker ethic between first generation chipmusicians and demosceners lies in the idea of free distribution of one’s creative work as well as the practice of manipulation and exploitation of technological limitations to expand creativity; further to this, it necessarily follows that the discovery is shared with the scene. However, there were certain dissimilarities between both scenes. For example, demosceners often participated in competitions with their work and originality was a Knowledge of limitations: hacking practices and creativity ideologies in chipmusic 1 requires the manipulation of technological limitations and the compositional techniques that aim at working around these limitations. On the other hand, the use of new technology to compose chipmusic gives rise to a new aesthetic. However, the habitus and the position in the field remains the same for purists, and as a result, the new aesthetic is a mismatch to the structure of the field. The artists, the second generational class of chipmusicians emerged after the 2000s following the development of tracker software for the Game Boy and appeared as the first hysteresis in the chipscene, changing rapidly the field towards a different direction to the habitus of the first generational class. Until then, chipmusic-making could not be done on the move as microcomputers were heavy to carry and needed power to work. The use of the handheld Game Boy was revolutionary in the chipscene as it enabled mobility. Thus, chipmusicians could compose music on-the-go with the battery-operated highly portable Game Boy, and this also gave them more expressive freedom in performances. Historically, the first two generations associated with different technological eras and, as a result, were familiar with different platforms. This made the second generation more attuned to the social conventions of handheld gaming which was almost alien to the first generation of chipmusicians, who were already involved in the demoscene by the mid-1980s. This historical comment serves to explain the developed aesthetic and ideology of the second generation of chipmusicians that helped underpin the habitus in the chipscene, changing the structures of the artistic field. The second generation’s habitus, then, changed in response to new expansions in the practices of chipmusic that worked around Article 16 common value that suggested elite practices, i.e. not borrowing others’ samples or asking for basic coding advice (Reunanen and Silvast, 2009: 298). In contrast, in the chipscene sharing advice and learning by copying is a social convention that informs chipmusic habitus and does not have any ramifications regarding power dynamics in the field. However, copying creative work without attributing the original creator was not acceptable neither in the demoscene nor the chipscene. Acts of plagiarism were denounced and publicised in online communities, as for example the Hall of Shame in MOD archives, Micromusic.net and 8bitcollective.org. The logic of practice in the chipscene, therefore, excludes acts of plagiarism, and any such attempts are publicly criticised, and perpetrators are alienated. Chipmusic creativity in the first generational class is entrenched in cultural understandings of authenticity that are deeply rooted in demoscene doxa. Authenticity here refers to the use of original hardware in music-making that has an effect on the value of the produced chiptune. The original hardware is of great significance for chipmusicians as it reflects the value of the technology as well as recognising the skills of its users. For purists, a chiptune composed on a modern computer lacks creativity as the absence of technological limitations renders the compositional practice mundane. Composing on the original hardware bears sacred meanings, to resonate Durkheim’s concepts, with the platform becoming a totem, a symbol of the divine process of music-making as well as one that reflects the values of the society. Thus, for the first generational class of chipmusicians, creativity is weighted by hacking principles, found at the core of the chipscene’s doxa. In this sense, the process of music-making 95 Marilou Polymeropoulou 96 the limitation of physical stability, offering greater mobility. This similarly changed performances in the chipscene. Further to this, creative practices such as music production altered thescene’s social conventions. In contrast to the demoscene, chipmusicians do not participate in competitions. Instead, they upload their music online. At the beginning of the chipscene, all music was uploaded on online communities such as micromusic.net, 8bitcollective, chipmusic.org, and collective. Chiptunes could be downloaded for free and there was space for exchange of comments on the music. In this sense, there was an open evaluation and discussion about the creative output, similarly to the demoscene. As the internet gradually became an everyday market and as a response to music plagiarism in the chipscene (see previous section), chipmusicians uploaded their chiptunes on online shops like Bandcamp, where the audience can download them for free or at a price. Commodifying chipmusic brought another hysteresis effect in the chipscene as it clashes with the hacker ethic shared by first and second generation of chipmusicians. This practice was seen by purists as a sell out, moving away from the intended chipmusic spirit of community and the free distribution of creativity. Further changes in the chipscene doxa occurred with the emergence of the third generational class of chipmusicians, the chipsters. This change signified a technological change; a shift towards modern technology that replaces the hardware but not the sound properties of chiptune. With the popularisation of chipmusic, computer software that emulated the sound chips of the original microcomputers and videogame consoles was developed. Chipmusic became a method of composition allowing composers to add the 8-bit aesthetic to their music. Sound chip emulators allowed computer users to compose chiptune without the original devices. The absence of technological manipulation contrasted the concept of “algorithmic beauty” situated at the core of the purist habitus. Therefore, any chiptune created in un-limited ways, is often devalued by the first generation of chipmusicians. Chipmusicians that did not conform to the initial doxa of the chipscene were criticised; fakebit emerged as a new purist term to describe music made on sound chip emulators. This derogatory term aimed at re-instating orthodoxy with regards to what is original, authentic, true chipmusic and what is not—a fake—and ensuring that the chipmusic genre is adequately policed. The third generation of chipmusicians, however, embraced and re-appropriated the term, continuing composing chipmusic in sound chip emulators as well as other musical instruments, creating new aesthetics in chiptunes. Another practice that differentiated the chipscene generations is performance. Most social gatherings of the chipscene were parties during which chipmusicians performed at a stage. Here, the logic of practice suggested that the gear would be set up on a table which would be placed centrally on a stage. The table would be the only physical barrier between the performers and the audience (see image 3). Certain times, chipmusicians would carry their platforms with them, and this was not challenging if they used Game Boys. However, when carrying C64s, Ataris, and any other early home computers, the weight was significant—as Figure 3: Desert Planet performing at Einbaas 9 (April 2012). well as the complications when travelling. 4 The performing style resembles a gig setting where all eyes of the audience are on the performer. As second generation of chipmusicians preferred portable technology, their performances were more dynamic, having freedom of movement and expression, often 4 A brief anecdotal story for the reader: In 2011, I happened to travel from Valencia to London with gwEm, who carried two Ataris. At the airport, when scanning his luggages, he was stopped and was asked to provide an explanation for the content of the luggages. Our Spanish was as limited as the officers’ English, but we heard a word resembling “terrorist” and from the non-linguistic context, we understood that we were stopped due to the electronics gwEm carried. Fortunately, the misunderstanding was quickly resolved, and we were allowed to continue. interacting with the audience. Such performances are more dramaturgical, exposing the performative chipmusic persona on the stage, which may be disguised, as Desert Planet are in the picture above, or wear a costume, as in the case of Omodaka, or even, wear nothing at all, as happened in many of Meneo’s performances. Due to its arbitrariness and diversity, The chipscene sees many changes in the structures of the artistic field. Some of these changes are time-dependent as they are synchronous to technological events that occur at a specific historical time, as in the case of the emergence of handheld gaming consoles. These hysteresis effects are disruptions to chipscene doxa, which is Knowledge of limitations: hacking practices and creativity ideologies in chipmusic 1 Article 16 97 Marilou Polymeropoulou constantly reformatted and updated. With each hysteresis, it appears that a new bifurcation is created, spreading out chipmusic to a vast network of “chip sound”. On the one hand, observing the changes and the development of new knowledge is valuable to the history of chipmusic as well as the development of electronic music, both in theory and practice. On the other, the chipscene offers insights into the rich discursive patterns of a transnational and online society of music practitioners; deciphering these meanings helps shed light on digital culture formations, maintenance, communication, and change. In all, hacking is the enabler in the chipscene and its practices, a method and ideology that clearly marks territories of belonging. Conclusions The knowledge of limitations in chipmusic encompasses different dimensions of how hacking practices affect creative ideologies. More specifically, I emphasised software hacking and tweaking of technological constraints, including hacks and techniques to explore sound chip affordances; hardware hacking through modding and circuit-bending; and ideological hacking in the form of hysteresis, to use Bourdieu’s Bibliography Bourdieu Pierre (1977), Outline of a Theory of Practice, Cambridge, Cambridge University Press. — (1992), The Logic of Practice, London, Polity Press. 98 Canonne Clément (2012), “Improvisation collective libre et processus de création musicale : analytical term, when examining disruptions in the chipscene habitus. This knowledge gained includes practical knowledge, i.e. how to compose chipmusic as well as propositional knowledge, i.e. what is chipmusic. It has been shown that both processes—creating and defining—are socially constructed and informed by the different social conventions and cultural practices adopted in the different chipmusic generational classes. It could be argued that the three generational classes are too deterministic; however, in practice, I have found that following the emergence of each generation, there is social mobility, and in the case of new individuals in the chipscene, there is a choice in which ideological category to belong. In addition, the creative ideologies in these generations may seem anachronistic to some individuals, who reject entirely not only the values, but also, membership in the chipscene. There are, for example, composers who do not identify as chipmusicians, but whose music is characteristic of the chiptune sound, that join electronic music assemblages and networks, shifting towards mainstream popular music worlds. Chipmusic and the chipscene offer a fruitful fieldsite of a digital culture to be explored, with several opportunities for further research with regards to its compositional techniques and performance. création et créativité au prisme de la coordination”, Revue de Musicologie, vol. 98, no 2. Carlsson Anders (2008), “Chip music: low-tech data music sharing”, in Collins Karen (ed.), From Pac-Man to Pop Music: Interactive Audio in Games and New Media, Aldershot, Ashgate, p. 153162. Carlsson Anders (2009), “The Forgotten Pioneers of Creative Hacking and Social Networking– Introducing the Demoscene”, in Cubitt Sean & Thomas Paul (eds), Re:live Media Art Histories 2009 conference proceedings, p. 16-20. — (2010), “Hex, Shrugs, and Bleep Bloop”, Chipflip blog, 18/1/2010. http://chipflip.wordpress. com/2010/01/18/the-8bc-scandal- Applications, London, Springer, p. 77-97. them tick?”, Master thesis, Aalto University. Collins Karen (2008), “In the Loop: Creativity and Constraint in 8-bit Video Game Audio”, Twentiethcentury music, vol. 4, no 2, p. 209227. McKenzie Wark Kenneth (2004), A Hacker Manifesto, Cambridge, Harvard University Press. Reunanen Markku & Silvast Antti (2009), “Demoscene platforms: a case study on the adoption of home computers”, in Impagliazzo John, Järvi Timo & Paju Petri (eds.), History of Nordic computing 2, Berlin, Springer, p. 289-301. Dittbrenner Nils (2007), Soundchip-Musik. Computer- und Videospielmusik von 1977-1994, Osnabrück, Electronic Publishing Osnabrück. Driscoll Kevin & Diaz Joshua (2009), “Endless loop: A brief history of chiptunes”, Transformative Works and Cultures, vol. 2. http://dx.doi. org/10.3983/twc.2009.0096. 16 1 Himanen Pekka (2001), The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age, New York, Random House Inc. Jorda Tim (2008), Hacking, Cambridge and Malden, Polity Press. Kelly Caleb (2009), Cracked Media: The Sound of Malfunction, Cambridge, MIT Press. Kummen Vegard (2018), “The Discourse and Culture of Chip Music: Studying the Methods and Values of the Chipscene”, Master thesis, University of Agder. McAlpine Kenneth B. (2019), Bits and Pieces: A History of Chiptunes, Oxford, Oxford University Press. — (2017), “Shake and Create: Reappropriating Video Game Technologies for the Enactive Learning of Music”, in Minhua Ma & Oikonomou, Andreas (eds.), Serious Games and Edutainment Middleton Richard (1983), “‘Play it again Sam’: some notes on the productivity of repetition in popular music”, Popular music, vol. 3, p. 235-270. — (1990), Studying popular music, Milton Keynes, Open University Press. Newman James (2017), “Driving the SID chip: Assembly Language, Composition, and Sound Design for the C64”, Game, vol. 1, no 6. Nova Nicolas (2014), 8-bit Reggae: collision and creolization, Paris, Volumique. Pasdzierny Matthias (2012), “Geeks on stage? Investigations in the world of (live) chipmusic”, in Moormann Peter (ed.), Music and game. Perspectives on a popular alliance, Wiesbaden, Springer VS, p. 171-190. Richards John (2013), “Beyond DIY in Electronic Music”, Organised Sound, vol. 18, no 3, p. 274-281. — (2017), “DIY and Maker Communities in Electronic Music”, in Collins Nick & D’escrivan Julio (eds), The Cambridge Companion to Electronic Music, Cambridge, Cambridge University Press, p. 238257. Tagg Philipp (1982), “Analysing popular music: theory, method and practice”, Popular music, vol. 2, p. 37-67. Tasajärvi Lassi (ed.) (2004), Demoscene: the art of real-time, Helsinki, Even Lake Studios & katastro.fi. Tomczak Sebastian (2011), “On the development of an interface framework in chipmusic: theoretical context, case studies and creative outcomes”, Ph.D. Dissertation, Elder Conservatorium of Music, University of Adelaide. Polymeropoulou Marilou (2015), Networked Creativity: Ethnographic Perspectives on Chipmusic and the Chipscene, Doctoral dissertation, University of Oxford. — (2019), “Digital Music Creativity: Chipmusic in/from Greece”, in Tragaki Dafni (ed.), Made in Greece: Studies in Popular Music, London, Routledge, p. 113-124. Reunanen Markku (2010), “Computer demos–what makes Article Collins Nicolas (2006), Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking, London, Routledge. Menotti Gonring Gabriel (2009), “Executable Cinema: demos, screensavers and videogames as audiovisual formats”, in Cubitt Sean & Thomas Paul (eds), Re:live Media Art Histories 2009 conference proceedings, p. 109-113. Knowledge of limitations: hacking practices and creativity ideologies in chipmusic hex-shrugs-and-bleepbloop/ (accessed 14 July 2019). 99 Keywords: Pirate radio / playlists / netart / hacking L’art du piratage à l’ère de la playlist Par David Christoffel Résumé : S’il y a des exemples historiques de radios pirates dont la programmation musicale n’avait rien de transgressive, il peut y avoir beaucoup d’exemples de musiques aux accents subversifs promues sur des radios officielles. Mais si radios pirates et musiques contre-officielles s’interpénètrent de manière irrégulière, qu’en est-il des « playlists » ? En s’appuyant sur des exemples récents 16 où l’imaginaire pirate a été mobilisé au cours d’émissions légales (Radio Campus Clermont-Ferrand/Radio Galère, 1 Radio Klaxon et, plus en détail, les œuvres du collectif PI-node), cette étude cherche à réfléchir à l’éditorialisation spécifique de la musique en playlists en contexte de piraterie radiophonique, à partir d’Un manifeste hacker de McKenzie Wark. Mots-clés : radio pirate / playlists / netart / hacking Abstract: While there are historical examples of pirate radios airing nontransgressive musical programs, there are also many examples of subversive music promoted on official radio stations. But if pirate radios and counter-official music irregularly interpenetrate, what about “playlists”? Summoning recent examples in which the ideas and imagery associated with pirate radios were mobilized during legal broadcasts (Radio Campus Clermont-Ferrand / Radio Galère, Radio Klaxon and, in more detail, the works of the collective PI-node), this study seeks to reflect on the specific editorialization of music in playlists within the L’histoire des radios pirates, que les autorités sont venues interdire pour avoir émis sans autorisation, ne doit pas réduire les radios pirates à la seule transgression de la légalité. L’adjectif « pirate » oblige à un ajustement définitionnel d’urgence. Au sens strictement juridique, une radio est définie comme « pirate » quand elle émet sur une longueur d’onde qui ne lui a pas été attribuée (Lesueur, 2011). Mais une autre acception, venue de l’Union internationale des télécommunications, désigne comme « pirate » une « radio-amateur » qui diffuse d’autres éléments que son immatriculation, sa position géographique ou toute information concernant la qualité de la transmission. D’où la proposition de relever ici, à côté d’une seule question de diffusion, une affaire de contenu. L’une est de toute façon imbriquée dans l’autre, dans la mesure où l’on n’émet pas illégalement pour diffuser des contenus qui pourraient être entendus sur les radios légales. Même si on peut toujours, sans excéder les cadres légaux, troller les horizons d’attentes. Mais on suppose alors que les manières légales d’agencer les contenus produisent des normes de fabrication reconnaissables à l’oreille pour facilement repérer ceux qui n’y répondent pas. D’où la perspective de chercher dans quelles conditions une playlist – ou un flux de données musicales – peut s’entendre comme « pirate ». L’art du piratage à l’ère de la playlist Manifesto in mind. Article Article context of radio piracy, with McKenzie Wark’s A Hacker 101 David Christoffel La question du contenu pirate L’émission d’un signal radio sans autorisation et la transgression musicale sont, dès les débuts de la radio, deux valeurs distinctes. Mais si l’association de l’une et l’autre doit être arbitrée au cas par cas, c’est tout de même la preuve qu’il reste délicat d’imaginer l’une sans l’autre. Ainsi, en 1923, la « Direction de la Télégraphie sans fil » cherchait à repérer qui était responsable dudit « poste zéro », une radiodiffusion illégale dont le propos restait bon enfant et le contenu musical tout à fait convenable. On pouvait ainsi lire dans le journal L’Œuvre : « On les entend parler, chanter et jouer de la musique, nous dit-on, aux heures que vous indiquez, et l’on ne serait pas surpris si, un beau soir, ils lançaient soudain dans l’espace… un air de leur façon, qui pourrait – sait-on jamais ? – n’être pas tout à fait orthodoxe 1… » L’idée qu’on ne saurait émettre sans autorisation pour diffuser de la musique « orthodoxe » paraît si incongrue à la presse de l’époque, qu’il faut dépêcher une hiérarchie entre l’infraction constatée et ce qui serait une malfaçon plus standard. C’est ainsi qu’apparaît l’hypothèse selon laquelle ces « sans filistes » ne sont jamais que des « farceurs » et, à ce titre, ne sont pas complètement des malfaiteurs. Même si le terme « pirate » n’est pas encore employé, l’axiologie sous-jacente est assez claire : diffuser de la musique « orthodoxe » de 102 1 L’Œuvre, 20 mars 1923. manière illégale est moins pirate que de la musique qui mettrait à mal les bonnes mœurs. Mais présenté dans ces termes, si l’importance de la transgression dépend du répertoire diffusé, la manière de le diffuser n’a donc aucune incidence sur la force de transgression de la musique choisie. À l’inverse, Radio Caroline diffusant les Beach Boys est un exemple emblématique d’une radio pirate dédiée à la promotion d’une musique qui, alors, n’accédait pas aux ondes officielles. Aujourd’hui, une radio qui diffuse les Beach Boys n’est pas pour autant une radio pirate. Mais si les œuvres des Beach Boys sont maintenant assez patrimoniales pour les traverser, les frontières établies par les normes de fabrication de la radio légale perdurent. De manière tout à fait significative, l’opposition entre les pirates et les légalistes est reconduite dans une opposition entre amateurs et professionnels de radio déjà présente dans le récit historique sur Radio Caroline. On peut lire Robert Chapman (2012) et voir comme il pointe le reproche d’illégalité comme encapsulé dans un discrédit jeté sur l’amateurisme : « Early criticism of Luxembourg and Normandie focused on their amateurism, (relative of course to the BBC’s notion of professionalism), and the irregularity of their broadcast, while takers of the moral high ground indicated that there was something distaseful, if not about advertising on the wireless per se, then about the kind of shoddy palliatives being promoted. » Une cinquantaine d’années plus tard, l’ethos pirate a pu évoluer, mûrir et, plus encore, se démultiplier. C’est pourquoi il ne saurait être question d’en faire une histoire progressive ou seulement unitaire. Nous allons chercher à viser comment, aujourd’hui, 16 1 À titre d’éducation aux médias, 13 enfants ont participé à une colonie « Radio pirate » qui émettait sur 107.7 au cours du week-end du deuxième tour de l’élection présidentielle. Les animateurs (qui venaient de Radio Galère et Radio Campus ClermontFerrand) leur demandaient : « C’est quoi être pirate en 2017 2 ? » Les enfants répondaient : « taguer sur un mur, ne pas payer dans un magasin », autant d’exemples spontanés qui restent sur un critère d’illégalité. Jusque-là, les enfants ne cherchaient pas dans les actes de piraterie, telle ou telle motivation politique ou quelque grande cause (comme la réparation d’injustices majeures, par exemple), mais semblaient indexer un répertoire d’actions plaisantes pour leur dimension pittoresque. Mais quand les animateurs de la colonie leur demandaient quelles sont les armes d’un pirate aujourd’hui, ils répondaient des ordinateurs ou des armes blanches, en 2 http://www.campus-clermont.net/onair/podcast/ player/?date=2017-05-07&time=21#campus_player (consulté le 8 novembre 2017) L’art du piratage à l’ère de la playlist Le piratage comme détournement poétique reconnaissant que le mot « pirate » peut être adapté aussi bien pour désigner quelqu’un comme Edward Snowden qu’un personnage de fiction comme Jack Sparrow. Même si la montée en généralité peut présenter des risques pour la consistance de la définition : à force de collectionner les définitions enfantines, on observe un flottement dans l’idée qu’on se fait. Comme dit Hugo : « Avant, pirate, c’était plutôt vraiment être sur un bateau, voler, avoir des trésors, maintenant, c’est plutôt enfreindre des lois. Donc la notion a changé autour du temps. » Et puis, une participante faisait remarquer qu’ils squattaient certes la fréquence 107.7 (radio dévolue à l’info trafic), mais sur une zone du territoire où il n’y avait pas d’autoroute et où il n’y avait pratiquement aucune chance pour que la radio autoroutière s’aperçoive, par conséquent, que sa fréquence a été prise. L’idée d’une radio pirate qui supplante des radios officielles est alors elle-même supplantée par une réalité de l’émission pirate : pour que la transmission puisse passer, il est toujours plus simple de se mettre sur des zones inoccupées de la bande FM (d’où l’attraction vers le bout de la bande). Mais c’est là que les flottements de sens appellent une remobilisation des enjeux qui nous amènent à considérer un programme radiophonique comme pirate, même si son canal de diffusion n’est pas complètement illégal. Le désalignement des critères a donc des répercussions sous les différents angles désalignés. Nous pouvons relever comment un contenu musical peut devenir pirate par son mode de diffusion plus que dans sa forme, son style ou son esthétique. Réciproquement, il nous reste à envisager dans quelle mesure un flux audio « hacké » peut se résoudre à des Article se déploie radiophoniquement l’imaginaire pirate, dans des contextes de diffusion qui ne défient pas les cadres légaux de l’édition. De sorte que le topos du pirate en amateur demande une réappropriation volontaire et, pour savoir ce qu’on fait et mieux jouer avec, une redéfinition du terme. 103 David Christoffel modes propriétaires, voire à la mobilisation de musiques qui répondent à des logiques de marque. D’où le réglage de la notion de « hacking » sur une notion de propriété, par McKenzie Wark dans Un manifeste Hacker : « Sous la sanction de la loi, le hack devient une propriété définie, et la classe Hacker émerge, comme émergent toutes les classes, d’une relation à une forme de propriété. De même que la terre et le capital, en tant que formes de propriété, la propriété intellectuelle impose une relation de rareté. Elle attribue un droit de propriété à un détenteur aux dépens des non-détenteurs, à une classe de possédants aux dépens des dépossédés. » (McKenzie Wark, 2007 : § 79) McKenzie Wark définit le hacking en opposition dynamique au vectoralisme et replace le piratage dans une lutte de classes. Dans l’histoire des théories de l’information, cette manière de définir politiquement le hacking renforce la lisibilité de l’interaction entre le contenu d’un message et son mode de diffusion, en donnant une importance renouvelée à la question « qui diffuse ? ». Cela met à jour les classes et leurs intérêts respectifs à diffuser ceci ou cela, tout en mettant les questions de facture des œuvres sur un autre niveau. À ce stade, le hacking ne se définit pas tant par le fait d’équiper des flux radiophoniques plus ou moins légalement, que d’outiller un nouvel horizon d’écoute : « Quel que soit le code que nous hackons, serait-il langage poétique, mathématique ou musique, courbes ou couleurs, nous sommes les extracteurs des nouveaux mondes. Que nous nous présentions comme des chercheurs ou des écrivains, des artistes ou des biologistes, des chimistes ou des musiciens, des philosophes ou des programmateurs, chacune de ces subjectivités n’est rien d’autre qu’un fragment de classe qui advient peu à peu, consciente d’elle-même. » 104 (McKenzie Wark, 2007 : § 02) Ce qui relance le débat définitionnel : faut-il chercher une dimension hacking là où la diffusion radiophonique est prise dans un rapport de lutte ? Ou bien faut-il que l’information relève des enjeux de classes pour qu’il puisse être question de piratage ? McKenzie Wark parle bien des hackers comme d’une classe, mais une classe créative qui résiste aux préemptions vectoralistes, qui déborde les explications qui les assigneraient à une fonction fixe. C’est cette articulation spécifique qui permet de penser la piraterie radiophonique non plus au seul niveau des moyens donnés à sa diffusion, mais aussi dans la manière d’agencer les contenus. Tout laisse à penser que les acteurs des radios pirates actuelles se définissent bien davantage par les rapports de lutte que leurs initiatives radiophoniques peuvent créer que dans leurs stratégies de diffusion. Si ces stratégies peuvent elles-mêmes créer un rapport de lutte, c’est par la dynamique critique dont la portée est plus ou moins liée au dispositif médiatique mobilisé par les acteurs. La musique notamment, prend un poids éditorial plus ou moins réactif à quelque fait de piraterie. En 2016, au cours des mobilisations contre la loi Travail, quelques émetteurs pirates se sont mis en place. Radio Croco (installée à la Maison du peuple de Rennes) ou Radio Cayenne à Nantes, qui ont démarré en occupant temporairement une fréquence, pour pouvoir transmettre en direct les événements, sans censure ni dépendance. Ce sont des radios qui, après une période de piratage d’une fréquence FM sont devenues des webradios, comme Radio Debout ou Jungala radio (qui diffusait des interviews de migrants de la jungle de Calais). Le passage de la FM à la webradio semble alors perçu par les acteurs comme un recul relatif de L’art du piratage à l’ère de la playlist 16 la notion du piratage. L’idée d’être pirate demeure consistante, mais n’est plus tellement liée au fait d’émettre illégalement. Le passage de la FM au web dédramatise la subversion de la piraterie radiophonique et, paradoxalement, la bande FM serait donc moins piratée depuis que les générations spontanées d’expressions radiophoniques transgressives susceptibles de se définir comme « pirates », trouvent dans le Web des accès tellement légaux qu’ils semblent évaporer la question de l’autorisation, de la validation administrative de la demande de fréquences normalement préalable à toute diffusion radio hertzienne ( jusqu’à parfois utiliser des plateformes de mise en ligne tout à fait propriétaires) et ne pourraient plus être appelées « pirate » qu’à titre folklorique. Pour qualifier ces piratages, on lit par exemple sur reporterre.net que « ces expériences radiophoniques manifestent le besoin de se réapproprier les ondes et la parole 3 ». Il y a même une analogie établie entre ces initiatives et la situation des années 1970 où la multiplication des journaux régionaux et des radios pirates devaient compenser le déficit d’expression citoyenne présente sur les médias officiels. Mais qu’est-ce que cela induit sur le plan musical ? Le piratage d’une 3 https://reporterre.net/Les-radios-pirates-sont-deretour-avec-les-luttes (consulté le 8 novembre 2017) Article 1 105 David Christoffel 106 fréquence n’implique pas nécessairement un rapport pirate au répertoire musical diffusé. Même si, souvent, la diffusion de musique est d’office assorti d’un questionnement politique sur le choix des œuvres diffusées. Par exemple, Radio Klaxon se promeut sur Twitter (@Klaxon_Radio) comme « la radio pirate faite par des pirates qui n’ont jamais fait de radio ». Le caractère pirate revient à braver les compétences journalistiques. Autrement dit, l’incompétence assumée vaut comme un gage d’authenticité, en opposition à la compétence institutionnelle ainsi assimilée à un filtrage de la parole. Il y a l’affirmation – incantatoire, mais efficiente – d’ouvrir, de collectiviser, de partager et, pour tout cela, de déprivatiser les fonctions éditoriales. Cette affirmation peut être entendue comme une volonté de décider ce qui vaut d’être diffusé, de redistribuer les processus de légitimation. Ainsi, dans un double mouvement d’élargissement du spectre des genres et de mise à égalité (« art oratoire, contes, odes, sagas, élégies épistolaires, raps, slams, fables… »), les « Poetik games » projettent le temps de parole radiophonique dans une redistribution des rôles d’autant plus ouverte que les modalités n’en sont surtout 16 1 Si elle se définit par la culture pirate des morceaux qu’elle assemble, l’idée d’une « playlist pirate » risque de buter sur un paradoxe sorite : si je mets une œuvre de Céline Dion (musique non-pirate) dans une playlist pirate, il s’agit encore d’une playlist pirate ; si j’ajoute une chanson de Michel Sardou (deuxième musique non-pirate), il s’agit encore d’une playlist pirate… À partir de quel pourcentage de musiques hors de la culture pirate la playlist sort du domaine pirate ? S’il est si délicat de définir le caractère « pirate » uniquement par l’appartenance à la culture pirate, il est plus décisif encore de chercher comment une playlist peut être « pirate » en assemblant des œuvres qui ne le sont pas. La question est porteuse d’un retournement intéressant : là où une playlist est classiquement sous-tendue par l’idée que tous les éléments qui en font partie sont dignes d’une attention séparée, une playlist pourrait être dite « pirate » quand elle présente une posture par exemple désinvolte à l’endroit de qui compose quoi. Il peut alors y avoir différents procédés de détachement à l’égard des marques de propriété des L’art du piratage à l’ère de la playlist Les webradios « de playlist » œuvres. Cela peut être l’idée d’une Radio Mozart qui annonce que l’écoute des œuvres de Mozart peut apporter une satisfaction consistante au point de saper la promesse de réflexivité musicale que la diffusion radio, quand elle est éditorialisée, peut entretenir. En revanche, si on prend l’exemple de Radio Michel, le principe curationnel rompt avec l’idée qu’une radio de playlist défend un répertoire. L’intelligence d’une sélection des œuvres est remplacée par un hasard onomastique : Julien Baldacchino et Mélanie Le Beller ont fondé Radio Michel pour ne diffuser que des artistes qui s’appellent Michel, Michèle, Michael, ainsi que des chansons qui comprennent le mot « M ichel » dans le titre. Cela peut passer pour une parodie de playlist thématique. Questions de codes En juillet 2013, Deutschlandradio Kultur, Musikprotokoll et ClubTransmediale ont lancé l’appel à projet Ubiquitous Art and Sound, qui porte sur le futur de la création radiophonique à l’heure de l’avènement des médias numériques de télécommunication. Cet appel a été remporté par le collectif π-Node, autour d’Erik Minkkinen du placard headphone festival 4 , qui présente le projet en animant pendant 240 heures continues, une station radio pirate à Berlin, doublé d’un 4 Il faut citer aussi : Carl.Y du festival nomusic.org, Alejo Duque, RYBN.ORG, Nicolas Montgermont du collectif Art of Failure, Jean-François Blanquet et Yann Leguay du Tétraèdre, Phillipe-Emmanuel Sorlin, Benjamin Cadon de Labomédia et Julien Clauss, organisateur du festival Modulation. Article pas formalisées. Le seul point qui mérite d’être entouré étant que « c’est ouvert à tous ». Radio Klaxon s’intéresse à la musique par les rapports de classe avec, notamment, une émission sur les détournements de chansons coloniales. Le passage dans le régime numérique va performer les catégories de propriété musicale, à commencer par les noms des auteurs. 107 David Christoffel laboratoire de recherche temporaire autour des pratiques radiophoniques expérimentales. Voici trois exemples parmi les performances radiophoniques du collectif π-Node. L’Acousmonium hertzien L’Acousmonium Hertzien est une performance conçue spécifiquement pour l’architecture du CND (Centre National de la Danse, à Pantin), avec 10 émetteurs radios distribués spatialement, émettant sur une trentaine de radios fixes, et un certain 108 nombre de radios mobiles. Le public est invité à déambuler dans l’espace du CND en étant équipé de radios, pendant que les émissions radiophoniques se déplacent et se succèdent dans l’espace. Le CND est ici utilisé comme une partition temporelle et spatiale. User d’émetteurs radio comme de sources sonores est une forme de représentation du flux médiatique, qui plus est s’il est ramené à une fonction infra-éditoriale. En tant qu’il ne reprend de la radio que les outils d’émission, cet Acousmonium Hertzien ne semble pas tant pirate qu’une pièce comme Candle Piece for radios de George Brecht, dont 1 L’art du piratage à l’ère de la playlist entre les niveaux d’écoute, prêter à ses propres fragmentations des valeurs esthétiques hétérogènes, prendre plus ou moins de responsabilité dans le montage émotionnel qu’il projette à leur endroit. Qu’il la reconfigure, la rejoue ou la suppose, la retransmission fait spectacle et l’émetteur hertzien porte l’offre radiophonique comme une connotation en puissance. Si des éléments musicaux propriétaires devaient sortir de ces postes de radio, il n’en resterait pas moins des éléments d’un flux médiatique, pour ne pas dire une information, dans un processus de signification ramené au niveau le plus basique pour les besoins du vectoralisme lui-même. Ainsi, la thèse 29 du Manifeste hacker : « L’information, comme la terre et le capital, est devenue une forme de propriété monopolisée par une classe, une classe de vectoralistes, ainsi nommés parce qu’ils contrôlent les vecteurs au long desquels est abstraite l’information. » (McKenzie Wark, 2007 : § 29) Dès lors, même si ce n’est pas l’enjeu mis en avant par ses acteurs, les performances du collectif π-Node peuvent être perçues comme des actes de dépropriation avec des références à la musique, à travers des dispositifs avec des concepts technico-esthétiques très maîtrisés. Le Scanner Orchestra « Le SCANNER ORCHESTRA est une performance sonore qui utilise toutes sortes de scanners radio comme instruments, et où différentes techniques de « scanning » sont combinées pour créer une exploration du spectre électromagnétique environnant. Les limites techniques des différents scanners, la bande de fréquence qu’ils permettent Article 16 la partition prévoit des captations FM dans un lieu non-défini. Dans cette œuvre de Brecht, les flux sonores sont alors redistribués en toute indifférence aux marqueurs stylistiques. Détournées, les œuvres diffusées sont émises au-delà des cercles de captation de propriétés intellectuelles. À l’inverse, l’Acousmonium Hertzien de π-Node se veut une improvisation collective déployée par des émetteurs dans une architecture spécifique… L’effet de dépossession n’est plus dans le détournement de flux radio préexistants, mais dans un dispositif hertzien placé en antagonisme aux catégories classiques de la production musicale (producteur, œuvres, droit, etc.). En construisant une architecture sensible d’ondes et de sons, elle déjoue l’émission radio comme média, pour la construire en architecture sensible d’ondes et de sons. Au lieu de pirater des flux prioritaires à la manière de George Brecht, l’Acousmonium Hertzien de π-Node affirme le signal radio comme un dispositif non-prioritaire. Dans un cas comme dans l’autre, l’écoute peut être portée à diffracter la consistance stylistique ou l’efficacité émotionnelle investie par quelque calcul stylistique potentiel. La force esthétique tient dans les signaux, les interférences, en poussant l’indifférence éditoriale jusqu’à traiter à égalité les sources radiophoniques et microphoniques. Dans la quadripartition « écouter / ouïr / entendre / comprendre » du Traité des objets musicaux de Schaeffer, on peut dire qu’il n’y a donc pas la même chose à comprendre entre les signaux radio de l’Acousmonium Hertzien et les flux de Candle Piece for radios, alors qu’il y a pratiquement la même chose à ouïr : un assemblage d’émetteurs radio. Dans un cas comme dans l’autre, l’auditeur peut hésiter d’écouter, forment les bases d’une partition musicale, interprétée par autant d’instruments d’écoutes radiophoniques. » 109 David Christoffel Cette performance est jouée à Graz 5 , au Styrian Center Herbst, et convoque tous les membres du collectif. Un scanner parcourt lentement le spectre radiophonique de 3.14 GHz à 1 Hz. Les musiciens, équipés de divers appareils d’écoute et d’émission, occupent différentes bandes de fréquence, et interviennent successivement, en opérant des moments alternés d’écoute d’événements typiques, de génération de feedbacks, et d’occupation sonore du spectre. π-Node joue sur les temporalités médiatiques : en mobilisant la radio comme le plus vieux des nouveaux médias, « en lui substituant un nouveau type d’architecture », le collectif avance ouvertement l’intention d’en « décupler les possibilités de création », de jouer l’hybridation entre radio hertzienne 110 5 Archives : http://www.p-node.org/graz (consulté le 8 novembre 2017) analogique et radio numérique pour penser hypermédias et, je cite : « transformer la radio en un gigantesque instrument modulaire rhizomatique. » Le Multistream Le web place la radio dans un nouvel âge, par la représentation du flux – la principale interface d’écoute du site π-Node : le Multistream. Parce qu’il passe d’un flux à un autre, le niveau de neutralité des éléments sonores diffusés est varié, irisé et, en quelque sorte, toujours repoussé de quelques crans à redéfinir d’une occurrence à l’autre. Dans le cadre du festival CTM, une définition est avancée qui, pour les besoins de l’hétérogénéité voulue par tous, exige des zones d’incongruité plus particulièrement notoires : interviews, et toutes sortes d’expérimentations radiophoniques en ligne, musicales, sonores des plus étranges. On peut y entendre des voix réciter des nombres à destination De l’invasion à la micro-FM des espions, des talk-shows nouvelle génération retranscrivant les conversations sur le tchat de la radio par une voix de synthèse, ou encore une mise en sons des honoraires et frais d’hébergement des participants de la Transmediale, document interne qui a fuité durant le festival 6. » 1 « Pierre Node : Le coût du programme, c’est juste savoir, voire fouiller sur le net, l’heure où passe une émission qui m’intéresse et si le créneau est libre sur la metaradio, je le mets sans demander rien à personne. Donc, ça peut être de la piraterie. Du coup, c’est de la metaplaylist aussi : c’est une playlist de gens qui font des playlists. On pourrait donc faire des canaux qui sont pirates 6 Marie Lechner, « Π-Node, la radio passe les bornes », Libération, 3 février 2014. http://next. liberation.fr/arts/2014/02/03/-node-la-radio-passeles-bornes_977516 (consulté le 8 novembre 2017) sans que les contenus que l’on met dedans le soient spécialement ? Article 16 Un certain nombre de concepts de radio sont ainsi nés de l’idée de systématiser un type de données : par exemple « Radio morse » qui propose une écoute de transmissions sonores, ou « Radiorloge » avec une écoute en continu du rayonnement électromagnétique du rack RNT qui diffuse la radio. Cette manière de définir la radio comme canal dédié à telles data, revient à liquider tout acte de composition radiophonique à l’assemblage de sources, suivant une logique de playlist alors élargie à tout ce qui peut faire stream. En charriant la distinction entre radio de flux et radio de stock, la radio renvoyée à son sens technique (de canal ou dispositif de retransmission d’un signal audio) organise une collusion plus ou moins volontaire entre la liberté d’expression héritée du mouvement historique des radios libres et la promotion d’une culture musicale « libre de droit ». Ainsi, « cannibal caniche radio » se définit comme une radio libre en étant une playlist de musiques libres de droit. La notion de piratage est appelée à un nouveau déplacement. En interrogeant un des fondateurs de π-Node (Erik Minkkinen) sur la dimension « pirate » de ses propres playlists, le passage de la FM au Multistream semble en même temps porter un changement de définition du piratage. Au départ, à propos des playlists « lapinkult », l’idée qu’il puisse s’agir d’émissions pirates tiendrait, selon le créateur, davantage d’une logique d’invasion (à collectionner les radios associatives susceptibles de diffuser son émission). Mais au moment de reconsidérer la metaradio comme metaplaylist (une playlist de playlists), il reconnaît que faire un flux à partir d’autres flux lui a rendu plus facile l’écoute des émissions qu’il n’aurait pas écoutées dans un rythme programmé. Si bien qu’il pirate les programmes des autres, en tant qu’il les rediffuse sans leur demander leur avis. C’est pourquoi nous avons voulu chercher comment le passage de la playlist à la playlist de playlists, vient induire un glissement de sens du mot « pirate », trahi par un contournement de la question : L’art du piratage à l’ère de la playlist « S’y mêlent des formats classiques, comme des Effectivement, dans les contenus de la metaradio, ce sont des contenus dont je n’ai aucun contrôle, c’est juste 111 David Christoffel les gens qui passent et je n’ai aucun contre-pouvoir. Je suis juste le stockeur, qui partage l’écoute. Dans tout cet univers de streaming, du légal ou du pas légal, sur des ondes ou avec un émetteur, on ne sait pas qui va écouter. C’est quantifiable, on sait combien il y en a qui écoutent un stream. Aujourd’hui, il y a beaucoup de légalité qui se transforme par rapport à ça. C’est presqu’un piège. » Il y a un rapport entre le piratage de données, leur détournement, et une sorte de modestie radicale qui permet de faire éclater Entretien avec Patrick ou Pauline Node 112 Cela faisait longtemps qu’on était tous impliqués dans des collectifs, sous forme assez petites (2-3 personnes) pour faire de la musique improvisée, expérimentale ou des installations nouveaux médias. Ensuite, plusieurs fois, on a essayé de se regrouper à plus nombreux. Donc, il y avait toujours la question comment est-ce qu’on peut être plus nombreux et comment on fait pour travailler de manière complètement horizontale, c’est-à-dire de pas avoir de poste assigné, de pas avoir de direction, pas avoir de hiérarchie, pas avoir d’organigramme. Il y a une chose que j’avais remarquée, c’est l’idée que, si tu veux avoir un projet extrêmement ambitieux, tout le monde va pouvoir spontanément trouver sa place dedans, parce que l’espèce de finalité que t’essayes d’atteindre est quasi-inatteignable. Je me souviens au début, dans π-node, il y le piège d’une comptabilité de l’audience, jusqu’à l’expérience de la micro-FM. Là où la playlist pourrait alors se définir comme « pirate », elle ne tient donc plus au niveau auquel est poussé le curseur d’illégalité de son dispositif de diffusion. Faute de pouvoir recevoir une consistance esthétique propre, la notion de playlist fait subir à l’horizon de la piraterie un retournement d’une allure irréversible : être pirate revient désormais à devenir serveur. avait la question de comment on change le monde. C’est comme ça qu’on commençait nos discussions. À partir du moment où tu donnes un objectif aussi grand, tout le monde va pouvoir ramener sa recherche, ramener son champ de travail de manière assez spontanée. L’autre question qui est arrivée au cours des années, c’est ce qu’on a appelé des espace-temps dans lesquels les gens viennent se regrouper assez spontanément pour travailler sur leur chose ou avoir des choses qui émergent du fait de travailler à côté, du fait d’avoir des rendus, des prototypes techniques. Après, dans π-node, quand on fait des interviews, on fait ça de manière anonyme : Patrick Node, Pauline Node… Comment vous pensez la notion de « hack » ou de « piratage » : est-ce qu’elle est plus essentielle dans les dispositifs techniques ou dans, par exemple, les différents canaux du multistream ? La plupart des gens du collectif travaille déjà avec la radio : soit sur la 1 Si on prend le multistream, est-ce qu’il y a des playlists qui te semblent plus pirates que d’autres ? L’art du piratage à l’ère de la playlist Les émetteurs classiques de radio, c’est 1 000 watts. Donc, t’as un rapport de 1/10.000.000.000. À l’heure actuelle, il y a la low power FM qui ressort bien aux États-Unis, limitée à 10 watts. Mais en France et en Europe, la nouvelle norme est catastrophique, t’as toujours rien le droit de faire en FM. La question de l’onde radio me semble très importante et je trouve qu’il y a une logique. Quelle est la différence entre une onde radio et un podcast, une webradio ou un stream ? C’est vraiment cette réalité physique dans l’espace. Là où on se définit plus comme « pirate » que comme « radio-amateur ». Les « radio-amateurs », ce sont des gens qui sont très intéressés par le respect de la légalité, avec des lobbys très puissants au-dessus, aux États-Unis. Et le gros champ de recherche des ondes radio, c’est qu’en fonction des ondes que tu utilises, tu vas pouvoir faire différentes choses. Bibliographie Chapman Robert (2012), Selling the Sixties. The Pirates and Pop Music Radio, Londres, Routledge. McKenzie Wark Kenneth (2007) [2006], Un Manifeste hacker, Paris, Criticalsecret. Article 16 FM, en radio libre, avec des émissions ou de la création radiophonique, soit en posant la question de la transmission, avec des œuvres qui prennent la matière de l’onde comme le matériau artistique. Quand on prend les années 80 et tout l’appel des radios libres, il y avait deux idées : la première, c’était effectivement que ce ne soit pas que des radios nationales qui occupent l’antenne, mais la deuxième idée, c’était d’avoir des fréquences libres. Par exemple, il y avait une fréquence qui pouvait être utilisée par tout le monde. Et ce critère-là, on l’a complètement oublié, il n’est plus du tout actuel. Alors qu’il y avait la vraie volonté de dire que ça appartient au bien commun, dans le sens large du terme. C’est un espace public qu’on s’est fait spolier. C’est pourquoi on assume le fait de venir l’occuper en se positionnant comme des gens qui émettent dessus. Le hacking a vraiment commencé comme ça : aujourd’hui, il y a la nouvelle norme européenne qui t’autorise à avoir des émetteurs FM mais qui te limite à une puissance 50 nanowatts. Grosso modo, même à 10 ou 15 centimètres à la ronde, ça ne va pas bien marcher. 113 Musi[ha]cking Ce que la musique fait au hacking (et inversement) Par Nicolas Nova (HEAD - Genève) et François Ribac (Université de Dijon) Résumé : Dans cet article nous nous intéressons aux convergences entre hacking et pratiques musicales (musicking). Pour cela, nous mobilisons des terrains et époques variés ainsi que la sociologie et l’histoire des sciences. L’analyse 1 de ces convergences nous amène d’abord à proposer une définition plus ouverte du hacking, où les amateurs ont toute leur place. Puis, nous montrons comment le hacking – au sens de la modification d’un système technique par une communauté d’usagers – peut nous aider à étudier la musique in situ et en action. Mots-clés : Hacking / musiques populaires / musicking / études de sciences / innovations sociales Abstract: In this article, we discuss the convergence between hacking and musical practices (musicking), summoning multiple areas and eras, as well as Science and technology studies. This analysis leads us to propose a Le terme de hack ou de « hacker culture » fait référence aux pratiques d’ingénierie se déroulant en dehors de la science ou de l’industrie. Celles-ci se traduisent à la fois par différentes formes de bidouillage d’objets techniques – ce qui peut impliquer tout autant la programmation que l’électronique – et le partage de connaissances ou de ressources matérielles par des communautés de hackers. Une première définition de ce terme correspond au fait de réaliser des hacks, c’està-dire de tirer parti de moyens techniques limités pour programmer, et plus largement créer, des objets ou des usages nouveaux. Historiquement, le terme apparaît à la fin des années cinquante autour d’un groupe de passionné·e·s appartenant au club de modélisme ferroviaire du MIT 1. Contrairement à certains de leurs collègues du TMRC 2 , ces premiers hackers s’intéressaient moins à la conception soignée de répliques de trains, qu’à l’édification du réseau électrique et de communication permettant de faire rouler les maquettes de véhicules. C’est en effet le bricolage de ces systèmes électroniques qui a nécessité la mise en place de hacks, c’est-à-dire de solutions efficaces, élégantes et innovantes pour faire fonctionner l’ensemble, à partir more open definition of hacking, in which amateurs have a broad role, and to show how hacking—the modification of a technical system by a community of users—can help us study music in action. Keywords: Hacking / popular music / musicking / STS / social innovations 1 MIT : Massachusetts Institute of Technology, centre de recherche et université, connu pour ses nombreuses contributions aux innovations du XXe et XIXe siècle. 2 TMRC signifie Tech Model Railroad Club et désigne ne association d’étudiants du MIT créé en 1946. Article 16 Le hacking et ses pratiques Musi[ha]cking Article 115 Nicolas Nova et François Ribac 116 d’une compréhension fine des moyens techniques à disposition (Levy, 1984). En transposant une telle démarche du train miniature à l’informatique, les hackers de l’époque se sont ensuite amusés à programmer un ancêtre du jeu de Pong sur l’énorme et intimidante machine à calculer IBM 704 (Levy, 2014 : 15), puis, entre autres explorations, ont développé le jeu vidéo SPACEWAR sur l’ordinateur PDP-1. C’est cette dimension du contournement, voire de l’exploitation de failles qui explique une autre connotation apparue ensuite du terme de hacking, couramment employée dans le domaine de la sécurité informatique. Cette seconde acception renvoie alors à la recherche intentionnelle de déverrouillage des protections logicielles et matérielles, en particulier dans le champ des télécommunications et de l’informatique. Un exemple couramment cité à cet égard est celui du hacker John Draper, dit « Captain Crunch », qui parvint en 1969 à passer des appels longue distance gratuitement en utilisant un sifflet possédant la même tonalité que le réseau téléphonique américain (Levy, 1984 : 199). Si l’objectif est différent, il s’agit plutôt de forcer un système que de s’en inspirer dans cette deuxième acception, la logique est similaire dans les deux cas puisqu’elle repose sur un intérêt profond à saisir le fonctionnement des objets techniques, et à l’exploiter afin de tester des usages nouveaux. Outre cette dimension de bidouillage créatif, la culture hacker correspond plus largement à un état d’esprit. Dans son enquête pionnière de 1984, le journaliste Steven Levy soulignait l’importance attachée à la liberté de l’information, à la méfiance envers l’autorité, et surtout au jugement méritocratique ancré dans une évaluation des pratiques – c’est-à-dire dans la réalisation des hacks eux-mêmes, et non dans des critères d’âge, d’origine sociale ou de diplôme. Poursuivant cette analyse dans le champ du travail, le philosophe finlandais Pekka Himanen (2001) opposait même « l’éthique hacker » à celle du capitalisme héritée du protestantisme et décrite par Max Weber (1904/2010) : l’engagement du hacker dans une activité repose sur un intérêt intrinsèque pour celle-ci, et non pour le fait d’en retirer une rétribution pécuniaire. Comme l’a montré Fred Turner (2008), des hackers – dans la première acceptation exposée plus haut – ainsi que certaines figures de la contre-culture nord-américaine des sixties, des ingénieurs, académiques et des acteurs institutionnels et industriels ont contribué à la conception et à la mise en œuvre de l’Internet, des médias numériques et à l’essor de la Silicon Valley. Cette rencontre, relayée par des ouvrages, des revues, des conférences, a très largement contribué à rendre l’informatique user-friendly et à imposer l’idée que des communautés pouvaient naître grâce à des réseaux de télécommunications et l’usage de PC (Personal Computer). Ce point est d’importance, le hacking ne renvoie pas uniquement au fait de modifier des systèmes techniques mais aussi au fait que ces pratiques prennent place dans des communautés de savoirs, d’échanges, de compétitions, communautés qui se retrouvent sur la toile, au grand jour ou dans les confins du Darknet (Stamboliyska, 2017). De nos jours, cette double composante – bidouillage et communauté organisée de hackers – se retrouve dans les deux pôles du hacking les plus couramment perçus : un hacking opposé aux pouvoirs et aux multinationales qui pénètre les systèmes pour mettre à jour des abus, par exemple celui des Anonymous, et un hacking cynique 1 Les lumières des STS et de David Edgerton Tel qu’il est couramment défini, le hacking consiste, d’une part, à forcer et/ou détourner des systèmes techniques et, d’autre part, à ce que ces pratiques fassent émerger 3 Un intérêt que l’on retrouve dans l’avènement de ces lieux de bricolage et d’apprentissage que sont les hackerspaces et autres fab labs. Relevons d’ailleurs que ces derniers sont aussi originaires du MIT, une université qui a toujours entretenu un rapport d’ouverture à ses cours, ses ateliers et ses machines. Promus par un chercheur du MIT Medialab, Neil Gershenfeld, les fab labs peuvent être lus comme une émanation récente de cette hacking culture. 4 L’acronyme STS (Science and Technology Studies) désigne un vaste corpus de travaux et de chercheur.e.s qui considèrent les sciences et les technologies comme des mondes sociaux. 5 Jacob et Stewart (2004) ont documenté la déclinaison instrumentale des théories newtoniennes en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Musi[ha]cking des communautés de hackers et dans certains cas d’usagers. Ce mouvement par lequel le monde social s’approprie des savoirs et des objets issus de l’industrie et/ou de la science a déjà été bien documenté dans les STS 4 dans des situations et des époques variées par les historiens des sciences (par exemple Jacob & Stewart, 2004 5) ou la sociologie des usages des télécommunications (Jaureguiberry & Proulx, 2011). De même, la sociologie de la traduction, que l’on appelle aussi la sociologie des réseaux, a abondamment documenté la différence souvent patente entre le script prévu par les concepteurs d’une technologie et ses usages effectifs lorsque celle-ci trouve un espace dans le monde social (Akrich, 1987 ; Akrich, Callon & Latour 2006). Sans qu’il soit question de présenter ce vaste corpus comme un tout homogène, une de ses constantes est de montrer que loin d’être dotée de propriétés propres, toute technologie donne lieu à des controverses, des transformations, des déclinaisons, des usages imprévus ; en bref que son destin et ses usages dépendent au moins autant de sa structure matérielle et des compétences et des objectifs de ses promoteurs que de ce que ses usagers en font (ou pas). Pour résumer ce premier point, une technologie n’existe pas en soi, elle ne prend sens que lorsqu’elle s’inscrit dans le monde social et des usages et, ce point est ici crucial, elle est presque toujours détournée, transformée, récupérée, appropriée. Mieux, ses Article 16 et menaçant, qui fracture des sites et des ordinateurs pour rançonner particuliers et entreprises. Entre ces deux polarités, toutes sortes de communautés forcent ou réaménagent des systèmes techniques, produisent des effets non prévus dans les scripts originaux des concepteurs et contribuent à de nouveaux usages. On l’aura compris, si le terme de hack, et la culture hacker, ont pendant longtemps fait référence exclusivement à la culture informatique, celle-ci a prospéré dans d’autres domaines. En premier lieu dans le champ des réseaux, comme on vient de l’évoquer, mais aussi dans toutes sortes d’activités et de sphères sociales : la vie de tous les jours (« life hack »), le bricolage et le DIY individuels ou collectifs 3 , le monde professionnel (« corporate hacking ») et bien entendu la musique, comme nous le verrons plus loin. 117 Nicolas Nova et François Ribac 118 usages imprévus sont souvent une dimension consubstantielle de la diffusion des objets techniques. De ce point de vue, le hacking rend visible et décline, à l’âge électronique puis informatique, une composante essentielle, quasi ontologique, et antérieure aux sixties, de toute société. Pour comprendre la fluidité des technologies, l’infinie variété de leurs déclinaisons et de leurs usages, les travaux de l’historien David Edgerton méritent également d’être mobilisés. S’appuyant sur une abondance de terrains, de pays et d’époques, Edgerton (2011) critique la façon dont l’histoire des technologies décrit souvent un enchaînement, uniforme et irréversible, de révolutions technologiques liées à des énergies : charbon, machine à vapeur, électricité, pétrole, numérique etc. A contrario, il montre comment les usages d’une même technologie varient non seulement dans le temps mais aussi selon les pays et les situations sociales. Ainsi, dans la région Suame Magazine au Ghana, une des zones les plus industrialisées d’Afrique, des biens (machines-outils, voitures, électroménager, etc.) considérés comme obsolètes dans le monde occidental sont réparés, entretenus et fonctionnent parfaitement durant des décennies. Les mécaniciens ghanéens forgent des savoir-faire techniques qui leur permettent de contourner les chaînes de compétences (mode d’emploi, ingénieurs etc.) dont ils ne peuvent pas disposer pour des raisons économiques. En d’autres termes, les mécaniciens ghanéens hackent des techniques et des objets. Outre cet éclairage décentré du seul monde occidental (là-dessus voir Chakrabarty, 2000), Edgerton s’inspire de l’écrivain Patrick Chamoiseau (1992) pour parler de technologies créoles. Ce terme désigne pour lui des systèmes ou objets qui, transplantés des pays riches vers les pauvres, trouvent d’autres fonctionnalités. Et de montrer ainsi comment les bicyclettes, instruments sportifs et de loisirs à l’origine (Oudshoorn & Pinch, 2003), devinrent des moyens de transports majeurs en Asie dans les années 1930-1950 puis comment les « bicyclettes asiatiques » se sont à nouveau hybridées pour donner naissance au pousse-pousse. De plus, cette importance de ce que l’on pourrait appeler la circulation horizontale des savoirs et des objets est également vraie pour Edgerton dans un même espace. Par une série d’exemples allant de la composition de l’armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale (où les chevaux étaient bien plus nombreux que les chars et furent tout autant décisifs lors des combats) au parc automobile à Chicago dans les années 1920 (qui comptait nombre de voitures électriques), l’historien anglais montre que de nombreuses technologies voisinent alors que l’on insiste habituellement sur une seule technologie (ou énergie) et à qui l’on attribue un rôle moteur. L’hybridation de la bicyclette, et plus largement cette conception de technologies créoles, peuvent être comprises comme des formes de hack au même titre que les détournements d’objets techniques ou les contournements de systèmes informatiques. Dernier point capital chez Edgerton, pour qu’une innovation technologique trouve son public et se pérennise, il est absolument nécessaire que sa part de nouveauté soit réduite. Autrement dit et à rebours d’une conception où les révolutions technologiques changent radicalement la donne, les transformations notables de pratiques et l’apparition de « nouveaux objets » s’appuient beaucoup plus sur des déplacements voire même des changements à la marge que sur 1 Musi[ha]cking différentes que celles qui mobilisent les hackers dédiés au bien commun ou hostiles. À partir de ces points, il nous semble que la compréhension du hacking est plus nuancée, plus panoramique aussi et qu’elle s’appuie sur une approche de la technologie également plus équilibrée. Ce que la musique fait au hacking Quid du hacking musical ? Intéressonsnous d’abord à des styles musicaux où les façons de faire semblent similaires aux composantes « classiques » du hacking qui ont été proposées plus haut ; le fait qu’une communauté d’usagers force des systèmes et/ ou détourne des objets et partage ses découvertes. Le circuit bending (figure 1) qui consiste à faire circuler du courant de façon imprévue Figure 1 : Circuit bending : deux tournevis reliés par un fil électrique permettent de faire circuler du courant de façon aléatoire dans les circuits intégrés et de découvrir des sons inédits. Photographie François Ribac. Article 16 des bouleversements. Si ce dernier point a bien été appréhendé par les STS, qui ont souvent mis l’accent sur les continuités dans les innovations (par exemple Pinch & Trocco, 2002 sur le moog), Edgerton nous montre que ces continuités « fonctionnent » également dans un espace et une temporalité identiques. Qu’est-ce que les STS et la contribution d’Edgerton, encore trop méconnue dans le monde francophone, nous apprennent sur le hacking ? Premièrement, et nous l’avons déjà dit plus haut, ces travaux permettent de situer le hacking dans une généalogie de pratiques bien antérieures aux années soixante. Deuxièmement, les nombreux terrains mobilisés par Edgerton nous apprennent que le détournement, le contournement, les nouveaux usages s’appliquent à de nombreux objets, types de systèmes et qu’ils sont déclinés dans des territoires et configurations sociales très différentes et, ce point est fondamental, pour des raisons 119 Nicolas Nova et François Ribac 120 dans des circuits intégrés de machines (par exemple des jouets) afin de faire surgir de nouvelles sonorités trouve aisément sa place dans cette première catégorie. On pourrait également mentionner la musique noise où fréquemment les usagers détournent et assemblent toutes sortes de générateurs de sons (cf. le texte de Sarah Benhaïm dans ce même numéro), la vaporwave (où l’on sample et ralentit des tubes de pop) ou encore le lo-fi, cette forme de rock (ou de pop) qui privilégie des formes peu coûteuses et souvent domestiques d’enregistrement et de diffusion de sa musique. On pourrait également évoquer certaines composantes de la musique improvisée où les musicien·ne·s bricolent leurs instruments avec des objets, choses, détritus initialement non destinés aux usages qu’ils·elles en font (cf. le texte de Clément Canonne dans ce même numéro) ou encore les « usages limites » d’instruments de musique que l’on trouve dans la musique de compositeurs contemporains tels que Helmut Lachenmann ou Giacinto Scelsi. On remarquera que cette liste fait voisiner des styles et des pratiques qui, au-delà de leurs formes de production et des réseaux au sein desquels ils prennent place, ont en commun de faire du détournement des objets un acte volontaire, « radical » diraient même certain·e·s protagonistes de ces mondes. Conséquemment, ceux et celles-ci insistent sur la dimension éthique de leurs pratiques, leur indifférence à la commercialisation et le désir de ne pas être manipulé etc. Le point commun avec certaines formes progressistes de hacking est patent. Le reggae 8-bit, une technique créole Justement, le cas du reggae 8-bit – un micro-genre musical qui consiste à produire et jouer du reggae-dub avec des consoles de jeu vidéo ou des ordinateurs munis de processeurs 8-bit – illustre ce lien entre musique, pratiques hackers, et la notion de techniques créoles proposée par David Edgerton. L’un d’entre nous a ainsi décrit ailleurs ces pratiques par le biais d’une enquête de terrain en Europe, montrant comment des consoles de jeu vidéo japonaises et des ordinateurs nord-américains avaient été détournés à cet effet (Nova, 2014 et 2017). Pratiquée tant par des musicien·ne·s de la scène dite « chiptune », qui emploient des machines « low-tech » telles que la Game Boy (Nintendo), l’Amiga (Commodore), ou le C64 (Commodore) disponibles dans les années 1980, que par des producteurs de musique électronique à l’affut de sonorités et de terrains d’expérimentations nouveaux, l’appellation « reggae 8-bit » renvoie en fait à des pratiques musicales multiples. Une majorité d’artistes se limite à prélever des échantillons sonores ou à utiliser ces ordinateurs et consoles momentanément dans leurs compositions ; par exemple pour affubler des riddims reggae 6 classiques de samples tout aussi connus dans la culture vidéoludique. D’autres poussent leur passion plus loin et créent leurs propres instruments à partir de ces machines des années 1980. C’est chez ceux-ci et celles-ci que l’on peut trouver des pratiques proches du hacking et qui débouchent sur une technique créole. 6 Le terme riddim, déformation de l’anglais rhythm (« rythme ») provient du patois jamaïcain ; il désigne la structure reprise de morceau en morceau (« versions ») dans le reggae. particuliers et identifiables du jeu vidéo des années 1980. Or, ni cet ordinateur, ni ce composant ne sont encore fabriqués actuellement – malgré l’existence de copies de mauvaise qualite – ce qui implique donc de surveiller les plateformes de vente en ligne d’objets de seconde main, d’acheter régulièrement des C64 pour en extraire les microprocesseurs sonores, et récupérer les coques en plastique. Lesquels éléments sont réutilisés ensuite, hybridés avec des composants plus récents pour produire la MIDIbox SID synthétiseur. La création de cet objet hybride – c’est à dire les hacks nécessaires à sa production – rappelle la notion de technique créole proposée par Edgerton : « la diffusion de techniques singulières souvent dérivées Musi[ha]cking Prenons ici l’exemple de la MIDIbox SID synthesizer « conçue » par les fondateurs de Jahtari (voir Nova, 2014 pour plus de détails). À côté de ses activités de production, ce label allemand propose aux musicien·ne·s intéressé·e·s un synthétiseur spécialement dédié au reggae 8-bit. Il s’agit d’un appareil sommaire, monté à la demande exclusivement pour les amis et les proches et dont ils ont fixé le prix de vente à 1 150 euros. Celui-ci est formé de deux blocs de synthèse sonore, munis d’une interface de contrôle (boutons, potentiomètres, indicateurs visuels) insérés dans une coque d’origine de Commodore C64. Chacun des blocs synthétiseurs comprend quant à lui le microprocesseur sonore d’un ancien C64, le « SID » (Sound Interface Device) qui permet de générer les sons si 16 Article 1 Figure 2 : MIDIbox SID synthesizer (Jahtari, 2014). 121 Nicolas Nova et François Ribac de “vieilles techniques” et renvoyant à des “dérivés locaux de quelque chose originaire d’ailleurs” » (Edgerton, 2011 : 120). Comme décrit ailleurs (Nova, 2017), la MIDIbox SID peut être décrite comme une « dérivée de vieilles techniques » avec ses processeurs sonores SID « low tech » et leurs sonorités identifiables qui renvoient à une culture bien spécifique. De même, la transposition spatiale et temporelle soulignée par Edgerton est aussi présente. Les bricoleur·euse·s de Jahtari étant des « Allemands de l’Est », comme ils se plaisent à le rappeler, qui modifient et combinent des technologies nord-américaines low-tech (les SID, le C64) et sud-asiatiques (fournisseurs de composants électroniques high-tech actuels) pour faire évoluer un genre musical caribéen lui-même hybride. Bifurcations sans savoirs techniques : l’exemple du microphone 122 La deuxième façon d’envisager le hacking dans les mondes musicaux concerne des processus au cours desquels des usages, des outils, des instruments et des systèmes en viennent à être fracturés et/ou décalés, mais sans que le registre du détournement soit forcément mis en avant par les acteurs. À bien y regarder/écouter, bien des objets et pratiques aujourd’hui naturalisées sont pourtant bien le résultat d’une combinaison de hacks. Considérons par exemple l’usage en scène des microphones. Développés dans le cadre des recherches sur l’électrification du signal menées par les firmes téléphoniques dans les années 1920 (Gelatt, 1977 ; Millard, 1995 ; Adams & Butler, 1999 ; Taylor, Katz & Grajeda, 2012), les micros étaient originellement utilisés pour recueillir le signal dans les studios d’enregistrement et dans les radios, en particulier aux USA. Si le son recueilli était bien amplifié électriquement pour être gravé sur un support lors des séances d’enregistrement ou « broadcasté » lors des émissions de radio, ni les ingénieurs en télécommunications, ni les opérateurs des studios n’avaient destiné les microphones à un usage scénique ; amplifier signifiait augmenter électriquement le niveau du signal au sein du réseau de circulation du son pour mieux le capter « tel quel », pas augmenter son volume afin qu’il soit diffusé plus fort lors de performances publiques. Ainsi, lorsque des interprètes se produisaient devant un public lors d’une émission de radio, une situation que Hollywood a documenté dans de nombreux films 7 les voix ou les instruments étaient « seulement » captés par un micro pour l’envoyer « dans les tuyaux » mais pas amplifiés dans une sonorisation ad hoc à destination du public. En somme, les ingénieurs électriques amplifiaient le signal et non pas le son ou la musique. À la même époque, certains vocalistes comme Rudy Vallée ou Bing Crosby utilisaient néanmoins des mégaphones pour mieux se faire entendre en concert tandis que les partis politiques commençaient à utiliser des amplificateurs, des haut-parleurs et des microphones pour leurs meetings (Devine, 2013). Ces mêmes chanteur·euse·s, que l’on appellerait bientôt des crooners, eurent alors l’idée de coupler les microphones des studios de radio et d’enregistrement avec des amplificateurs (par exemple celui d’une 7 Par exemple dans la série de films intitulé « The Big Broadcast of » débutée dans les années 1930 à Hollywood. 1 Musi[ha]cking d’enregistrement et de radio) à un autre (la scène) en s’appuyant sur des pratiques et des objets déjà existants. Et surtout, les crooners font surgir des ressources inconnues d’un instrument, détournent des objets de leur usage habituel sans avoir la compréhension d’un ingénieur, sans comprendre explicitement comment un système technique fonctionne. De plus, ces détournements ne concernent pas seulement le fait d’utiliser un micro en scène mais s’expriment par la naissance d’une nouvelle façon de chanter, par le développement et la diversification d’un style qui se déploie tout au long des années 1960, 1940 et 1950 sur les scènes comme dans les studios (Granata, 1999) et qui influencera les styles suivants et en particulier le rock’n’roll. D’autres exemples, plus récents, comme l’utilisation des platines de disques et des répertoires enregistrés et dans le rap ou les usages des cassettes audio sont très largement similaires à ceux du micro des crooners. Ils montrent en outre que nombre de ces détournements émanent d’amateurs (pour plus de détails voir Ribac, 2005). Apprentissages Notre troisième entrée concerne une fois encore les musiques populaires mais se décline dans les processus d’apprentissage de ces musiques et implique des amateurs. Plusieurs études, réalisées avant, pendant et après la dissémination des outils numériques et du Web (Bennett, 1980 ; Green, 2001 ; Ribac, 2005, 2007, 2010 et 2012) ont en effet montré que le processus d’apprentissage du rock, du hip hop et de la techno se déroulent non seulement dans des cadres collectifs (par exemple les groupes Article 16 radio domestique) et de les utiliser en scène (Lockheart, 2003). Ce qui est ici important de signaler est que l’amplification (au sens où l’on parle aujourd’hui de musique amplifiée) servit tout autant à augmenter le niveau sonore des voix et à les distinguer des orchestres, qu’elle permit aux crooners de moduler leur voix et de chanter pianissimo et des nuances faibles même lorsque l’orchestre jouait fort. Comme l’a montré McCracken (2015) avec l’exemple de Rudy Vallée, l’un des premiers crooners, immense star (oubliée) de la radio et pionnier du microphone, son usage du microphone donna lieu à de violentes polémiques sur les capacités vocales de ceux et celles qui y recouraient, accusations allant souvent de pair avec des accusations d’homosexualité à l’encontre des hommes. Comme le rappelle le titre de l’ouvrage de McCracken, Real men don’t sing et certainement pas avec un microphone. Bruce Johnson (2000) a d’ailleurs montré que, dans le monde du jazz, c’est surtout les femmes qui adoptèrent le nouvel objet souvent dédaigné par les hommes. Dès lors, peut-on considérer l’usage du microphone comme une sorte de hacking ? Cela y ressemble à maints égards. Il y a bien une communauté d’usagers qui opère le déplacement, un objet et un réseau technique existants (l’amplification du son) affectés à un usage imprévu et, peut-être le plus important, la naissance de nouvelles configurations techniques et spatiales, de nouvelles compétences et des métiers inédits (les sonorisateurs), de nouvelles expériences d’écoute, de nouveaux mondes musicaux (les crooners), de nouveaux objets qui recomposent la physionomie de la « musique ». Comme le montre Edgerton dans d’autres sphères sociales, les micros passent du studio à la scène par une sorte de glissement d’un lieu (les studios 123 Nicolas Nova et François Ribac 124 de rock), mais que cette phase est précédée d’un usage intensif et solitaire des outils de reproduction sonore et des supports enregistrés. Bennet a ainsi montré, un point qui a beaucoup frappé Howard Becker, que des adolescents vivant dans les montagnes du Colorado à la fin des années 1970 étaient capables de reproduire des solos de guitare de Frank Zappa sans jamais avoir pris un cours de guitare ni joué dans un groupe. Ce recours à des instructeurs non humains, les supports enregistrés et leurs lecteurs, est un fait central dans l’apprentissage des musiques populaires et ce depuis que les phonographes et la radio ont fait leur entrée dans l’espace domestique. Il est déjà documenté dans la biographie d’un Bing Crosby apprenant la musique avec la radio et chantant avec le gramophone familial dans les années 1920 (Giddins, 2001 ; Martin & Crosby, 2003) ou encore dans les récits des rockers des sixties comme McCartney ou Keith Richard (2010) engagés dans leurs groupes respectifs parce qu’ils jouaient à la perfection des morceaux de rock’n’roll appris avec des disques et des tourne-disques Dansette. Des ethnographies réalisées au milieu des années 2000 montrent des adolescent·e·s en phase d’apprentissage bidouillant des systèmes multipistes avec des magnétophones à cassettes à la maison, utilisant la souris d’un ordinateur pour générer des sons à la place d’un clavier, faisant circuler de la modulation dans des configurations assez improbables (Ribac, 2007, 2010 et 2012). Dans un monde où les mashups 8 , la vaporwave et même les façons d’écrire 8 Un mashup consiste en la création d’une chanson, ou composition musicale, à partir de deux ou plusieurs autres chansons déjà existantes. des SMS (Serres, 2012) ont également été initiés par des amateurs et amatrices, ces innovations s’inscrivent là aussi dans une généalogie de hacks réalisés par des (groupes de) personnes sans compétences reconnues. Conclusion(s) Ce que le hacking fait à la musique Dans un ouvrage qui a fait date dans les études musicales, Christopher Small (2011 9) a proposé le terme de musicking pour décrire la multiplicité des significations, des pratiques, des usages et des collectifs qui composent ce que l’on appelle communément « la musique ». Difficile à traduire en français, le suffixe « -ing » signifie le « en train de se faire » ou, pour le dire autrement, que la musique vient à nous dans sa mise en œuvre et ses usages. Ce qui implique de penser, d’appréhender, et d’étudier la musique en action comme dirait Tia DeNora (2011). De ce point de vue, le hacking, tel que nous l’avons défini au début de ce texte, permet d’appréhender les pratiques musicales en portant attention autant aux gestes et aux objets (ce que l’on appellerait la technique) qu’aux formes de sociabilités. C’est à la conjonction entre ces deux pôles que l’on peut alors observer, écouter et repérer des innovations, des ruptures mais aussi des continuités stylistiques et matérielles, par exemple le dub et les processeurs des appareils des années 1950 dans un nouveau style : le 8-bit reggae. Appréhender ainsi le musicking permet à notre sens de mieux 9 Traduction française, 2019. Ce que les STS et la musique font au hacking 16 1 Réciproquement les études de sciences et en particulier le travail d’Edgerton nous rappellent que pour s’imposer et perdurer, toute technologie est nécessairement hackée. Autrement dit, les différentes formes de hacking nées à l’âge électronique et informatique doivent, premièrement, être replacées dans des généalogies historiques et, deuxièmement, considérées comme une des formes par lesquelles un segment du monde social s’approprie des objets, des dispositifs, des technologies etc. Si, comme on l’a vu avec l’exemple du 8-bit reggae, il existe des formes quasi ingénériales de bidouillage Bibliographie Adams S.B. & Butler O.R. (1999), Manufacturing the future, a History of Western Electric, Cambridge, Cambridge University Press. Akrich M. (1987), « Comment décrire les objets techniques ? », Techniques et culture, p. 49-64. Akrich M., Callon M. et Latour B. (eds.) (2006), Sociologie de la traduction. Textes fondateurs, Presses des Mines, Paris. Bennett H.S. (1980), On Becoming a Rock Musician, Amherst, MA, University of Massachussets Press. Collins H. (2010), Tacit and Explicit Knowledge, University of Chicago Press, Chicago. Chakrabarty D. (2000), Provincializing Europe, Princeton University Press, Princeton. DeNora T. (2011), Music in Action. Selected Essays in Sonic Ecology, Ashgate, Farnham. Devine K. (2013), « A Mysterious Music in the Air », Popular Music History, vol. 8, n° 1, p. 5-28. Edgerton D. (2011), Shock of the Old : Technology and Global History since 1900, Londres, Profile Books. Chamoiseau P. (1992), Texaco, Paris, Gallimard. Edgerton D. (2013), Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l’histoire, traduit par Jeanmougin C., Paris, Seuil. Musi[ha]cking dans la musique, le microphone des crooners et l’apprentissage des musiques populaires montrent que les fractures, les bifurcations et les usages détournés peuvent advenir, d’une part, sans une volonté explicite de rupture et, d’autre part, sans qu’il soit nécessaire de comprendre et d’analyser le fonctionnement des systèmes. Les amateurs sont souvent à l’origine de hacks qui ont modifié systèmes techniques et organisations sociales. Autrement dit, non seulement il n’est pas nécessaire de savoir comment fonctionne un objet pour l’utiliser (et heureusement !) mais cette méconnaissance peut même aider à en faire autre chose. Enfin, le savoir qui accompagne un système technique ou une machine est fondamentalement social, c’est par le biais de la communauté qui l’utilise que j’apprends – souvent implicitement – à l’utiliser (Collins, 2010). Le mode d’emploi est sûrement utile mais si le monde social ne me dit pas comment (et ce comment peut très fortement varier) l’utiliser, je n’y arriverai pas. Si les théories sur le hacking devraient se musiquer et la musique se hackiser, cela donnerait donc musi[ha]cking. Article comprendre comment de nouvelles communautés musicales surgissent et les divers registres qui donnent corps à ces styles de vie qui émergent et ce sans l’aveuglement des approches analytiques ou déterministes ni la distance du sociologisme qui rabat pratiques et objets à des reflets (Hennion, 1993). 125 Nicolas Nova et François Ribac Gelatt R. (1977), The Fabulous Phonograph 1877-1977 (second edition), Londres, Cassell. Giddins G. (2001), Bing Crosby, a Pocketful of Dreams : The Early Years, 1903-1940, Little, Brown and Company. Granata C.L. (1999), Sessions with Sinatra : Frank Sinatra and the art of recording, Chicago, A Cappella Books. Green L. (2001), How Popular Musicians Learn, a Way Ahead for Music Education, Ashgate, Aldershot. Hennion A. (1993), La Passion Musicale, une sociologie de la médiation, Paris, Métailé. Himanen P. (2001), L’éthique hacker, Paris, Exils. Jacob M.C. & Stewart L. (2004), Practical Matter. Newton’s Science in the Service of Industry & Empire, 1687-1851, Cambridge, Harvard University Press. Jaureguiberry F., Proulx S. (2011), Usages et enjeux des technologies de communication, Toulouse, Erès. Johnson B. (2000), The Inaudible Music, Jazz, Gender and Australian Modernity, Currency Press. Levy S. (2010), Hackers, Sebastopol, O’Reilly books. Lockheart P. (2003), « A history of Early Microphone Singing, 19251939 : America Mainstream popular Singing at the Advent of electronic microphone Amplification », Popular Music and Society, 26-3, p. 367-385. Martin P. & Crosby B. (2003), Call me Lucky, Bing’s Crosby’s Own Story, Boston, Da Capo Press. 126 McCracken A. (2015), Real Men Don’t Sing. Crooning in American Culture, Durham, Duke University Press. Millard A. (1995), America on Record. A History of Recorded Sound, Cambridge, Cambridge University Press. Nova N. (2014), 8-bit Reggae, Collision and Creolizatiion, Volumique. — (2017), « Démonter, extraire, combiner, remonter. Commodore 64 et créolisation technique », Techniques et Culture, 67-1, p. 116-133. Oudshoorn N. & Pinch T. (eds.) (2003), How Users Matter : The Co-Construction of Users and Technology (Inside Technology), Cambridge, The MIT Press. Pinch T. & Trocco F. (2002), Analog Days. The Invention and Impact of the Moog Synthesizer, Cambridge, Harvard University Press. Ribac F. (2005), « Sur l’importance des disques et du recording dans la musique populaire et la techno », Mouvements, n o 42, novembre/ décembre, p. 70-81. — (2007), « La circulation et l’usage des supports enregistrés dans les musiques populaires en Ile de France », commandé par le programme interministériel « Culture et Territoires en Île-deFrance », le Ministère de la Culture (Bureau des Écritures) et le Conseil général de Seine-Saint-Denis. — (2010), « L’autre musique de chambre, comment de jeunes adolescent-es ont appris la musique », Actes du colloque international enfance et cultures. — (2012), « Quand l’amateur rend le numérique analogique ; l’exemple des musiques populaires », Revue Anthropologie des connaissances, vol. 6, p. 717-741. Richard K. (2010), Life, Paris, Hachette/Littlehampton. Serres M. (2012), Petite poucette, Paris, Le Pommier. Small C. (2011), Musicking : The Meanings of Performing and Listening (Music Culture), Hanovre, Wesleyan University Press. Traduction française (2019), Musiquer. Le sens de l’expérience musicale, trad. J. Sklower, Paris, Philharmonie de Paris. Stamboliyska R. (2017), La face cachée de l’Internet, Paris, Larousse. Taylor,T.D., Katz M. & Grajeda, T. (ed.) (2012), Music sound and technology in America, Durham, Duke University Press. Turner F. (2008), From Counterculture to Cyberculture : Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, University of Chicago Press. Weber M. (2010), L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Pocket/Plon, collection Agora. 16 1 Interview by Clément Canonne (IRCAMCNRS-Sorbonne Université) Nicolas Collins is Professor at the School of the Art Institute of Chicago. Influenced by Alvin Lucier, David Tudor and punk culture, his work is at the intersection of experimental music, computer music, and sound art. During his career, he invented numerous musical devices by hijacking or altering existing technologies: CD players that play the sound produced by a disc when it is paused (Broken Light, 1991); attached to a trombone, a signal processing system that combines a digital reverb and a Commodore 64 motherboard (Tobabo Fonio, 1986); or discarded electronic circuits “reanimated” by probes that interact with other electronic components to create feedback (Salvage, 2008). He also wrote Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking (Routledge, 2009), an influential introduction to the world Influences Both my parents were artist-oriented so I grew up in New York in the 60s with a deep immersion in the art world—where they took their children instead of to the circus was galleries of avant-garde art, Jean Tinguely, a lot of technological art. I didn’t get interested in making music until high school, in 1968. I think it may have had as much to do with the idea of being anti-something as for-something. I liked the idea of the avant-garde, experimental music that was against the status quo. But then I branched into electronics, and weird things started to happen. I bought a reel-toreel tape recorder to dub records, and it had a funny switch in it that made it feedback on itself, so it turned into this instrument. I built my very first oscillator circuit by finding information in some hobby magazines—you know, it was before Internet. I ended up studying music in Wesleyan University, and the first time I met with my advisor in the Music Department, he said: “Do you know Alvin Lucier? You said you did electronic music”… And I didn’t know him. I was from New York, I thought I knew everything. I knew Cage’s music, but I didn’t know Lucier’s. And my advisor said: “Oh, you should meet him, he makes music with bats”. And I thought: “Whoo… That is like so far beyond anything experimental I thought of, I have to meet this guy”—it felt like meeting the Che Guevara of music. From Circuitry toLive Improvisation (and back)… Nicolas Collins From Circuitry to Live Improvisation (and back): Hacking One’s Way Through Contemporary Electronic Music Tribune Tribune of musical hacking. In this interview, Nicolas Collins describes his journey as an artist at the crossroads of experimental music, computer music and sound art, and explains why hacking matters that much within today’s artistic practices. 127 Nicolas Collins I worked with him for years (Bachelor and Master degrees) and he was a very big influence. Composers like Lucier, at that time, made the case that you could make music about anything. It doesn’t have to be about Beethoven, it doesn’t have to be about Mahler or Schönberg, it doesn’t have to come from just that one stream. So here is a composer who’s making music based on architecture, biology, neuroscience. And of course, for someone who didn’t have a strong traditional music background like me, that was very liberating… It was a catharsis. I think we may have slightly misunderstood that lesson, because I think, in the end, there is still something fundamental about musicality. Lucier is very careful to say in his pieces, like I am sitting in a room, that this is not “a demonstration of a physical fact”. He doesn’t want to do science. The way those pieces work, and the way they last for 50 years, it’s because they have a poetic quality, they’re not just science. I think in the 70s, sometimes, there was a confusion, people thought they could do didactic works, but it didn’t mean they were good “music”. But, you know, we learned that difference eventually. The point was that it was a very liberating feeling and it made me think that I could become a composer even though my background was very strange. That was what pushed me on the road. Electronics and indeterminacy 128 Lucier said in an interview: “I’m not interested in electronic circuits because they’re two-dimensional, and sound is three-dimensional.” But he encouraged his students to learn circuitry and computer programming—because he nonetheless thought this was the future of music. So he invited David Tudor and David Behrman, he introduced us to those people, he thought that was important for our education. I continued building my own circuits in the 70s—it was a little more difficult then, there was less information. But there was an aesthetic post-Cage of accepting accidents and indeterminacy. So a circuit that didn’t behave like a Moog, because it was glitchy or unstable, could work in our music—it might not work to play Bach, but it worked for the strange, post-Cagean ideas. This is why when I was a student, I worked with feedback a lot, because with feedback, you don’t have to make a decision, you just turn up the volume, and something in the real world makes a decision for you. It’s not my job to pick the pitch, and I just can manipulate by going from one to another that are just sort of given. And we were also always interested in live performance, I think that was the legacy of growing up on pop music, for my generation. My friends were not interested in doing studio work, we weren’t interested in making tapes, we wanted to get on stage and play. Then at the beginning of the 80s there was a big shift to the personal computer as the basis for live electronic music. MIDI was a very powerful tool, everything became much cheaper. You started to get application software like sequencers, so you didn’t have to write you own code yourself. So it was a big liberation. But at the same time, MIDI was designed for the commercial music market, it was designed to sell synthesizers to people who made what we might call “normal” music. And 1 I built this instrument that was based on hacking an early digital reverb—I stuck a Commodore 64 computer inside a digital reverb and made connections between the two, and I essentially made a DSP-extension for the C64 by using the signal processing capabilities of the reverb and just hand-shaking to the Commodore for control. It was very good for instantaneous looping, sampling and sound transformation. It’s like the looper pedals they sell now but this was 30 years ago. I liked the sound vocabulary of the transformations, which I could have done those in the studio, non-real-time. But I loved the idea of being able to do it fast, I loved the idea of sampling radio on stage, because it gave you this tension of… you know, it’s now, I need it now! So the idea was that it was fast and it was live. So I built up this system and to control it—again because I wanted something big—I decided that I needed a big slide fader, and I thought: oh, a trombone! You know, a stupid joke! And I connected the trombone to half a mouse—a data entry wheel, a shaft encoder— and then I put a keypad on the trombone with 24 buttons, and then I could click and drag, to change any parameter of the program: change the pitch, change the length, change the program, change the filter. In a way, the trombone was just a mouse! But I didn’t have to look at a computer screen, which meant I could be on a stage, I could concentrate on the other musicians, or on the audience. It had this intimacy on stage, even though it was obviously an electronic instrument—the sounds were electronic, I never blew into the instrument—it had From Circuitry toLive Improvisation (and back)… Live performance Tribune 16 normal music is based on notes. But a lot of what people were doing in my world didn’t have to do with playing notes, chords and melodies. We had other ideas about crafting sounds. The MIDI system was not so good for that. My friends who were working with computers were spending a lot of time kind of finding backdoors into MIDI equipment, so that you can do strange things with the synths. So in the 1980s, I worked with multiple technologies: I used computers for things that computers do well, which is mostly control; I used circuits for the things that circuits did well, like making strange noises, noises that weren’t synthesizer sounds; and because my music was based on performance, I worked with musicians, because I needed players. I worked with musicians playing circuitry that I would build, but also with their musical instruments. The thing was that, at the time, for the chamber music ensemble who would play contemporary music, there was still a lot of resistance to “open form” music. Even in the 80s, Cage was kind of a hot topic. Not everybody thought he was serious. And I think a lot of musicians who came out of conservatories basically either didn’t know how to improvise or they didn’t trust themselves doing improvisation. And so I ended up working with musicians from the improvised music world. They weren’t a lot of people working with electronics but unlike a lot of the classical musicians, the improvisers were open to it. They would say: “Oh, that’s cool, that’s different”, rather than “Oh, I don’t know, where are the notes?” 129 Nicolas Collins 130 this acoustic presence. I started working with improvisers. I said: “Look, can we just try something?” And improvisers are funny because they don’t say: “Let’s go to the studio and try it out”; they say: “Oh, ok, I booked a gig, and I meet you at 8 for sound check”. So it’s a “trial by fire” as we say in English. I started doing that in 1987 or 1988 and that’s what really opened up improvised music for me, because I finally had an instrument that felt right for me. 1 This trombone was the first thing that actually behaved like an instrument. That is, one day I could play wedding with it, and the next day a Bar Mitzva (well, not exactly). It was really my introduction to being an instrumentalist. When I would play with musicians on stage I would grab the very first noises they’d make, maybe just tuning or taping the keys and then I’d make 2 minutes of variations on it. I was very attracted to DJ culture, from rather early on. You know, I started listening early hip-hop DJs in 1980, when they were just beginning to emerge in the consciousness of the white world. I really wanted to be a DJ, but the problem was that it was a lot of equipment and I had all this other equipment that I had to carry for the other pieces—I couldn’t carry one suitcase of electronics for the electronic pieces, and then two turntables and a box of records. So with the trombone instrument, I was basically DJing with the sounds that the other musicians were making live on stage. 1 Pour un exemple, voir : https://www.youtube. com/watch?v=89jbl0ZuaH4&t=65s (consulté le 31 juillet 2019). Someone once said that I was responsible for slowing down improvised music, because everything I did was a question of extension. In improvisation it used to be that as soon as you did something, you could move away. And now, thanks to me, you couldn’t, because what you threw away was still there, I was sustaining it. My education took place during the minimalist era, when minimalism was really a strong force in the music field. Things were slow. The trombone extended things, it basically slowed things down. And many of the systems I built suffered from too much tranquil beauty as a result of my minimalist background. There are hints of Muzak or easy-listening music in a lot of what I did. I wasn’t, you know, like a meditative, Californian-mind type of person; I was a New Yorker and there was always a certain tension where I’d have to figure how to get edge in my work. And when I improvised with other players, of course, that was easy, because the other musicians could do something sudden. But I could never initiate an aggressive act without their input. This nagged me. And what was interesting about getting involved in circuitry in a more intense way, for the second time of my life, was that it allowed me to work with, shall we say, more aggressive sounds and less beautiful sounds. Circuitry There was always this idea in my circle that the circuit actually wasn’t just the sound instrument, but there was an element of a score in it. The circuit implies the piece. So very often, you’d make one circuit and you would only use it for one composition, 1 2 Voir : https://www.youtube.com/ watch?v=DtGcueEsuDE&t=71s (consulté le 31 juillet 2019). From Circuitry toLive Improvisation (and back)… that statistically I’m going to get a wide distribution of pitches, and I’m going to get certain types of modulations. Then, it’s just a question of how much work I have to do to find sounds and rhythmic patterns that I like: how often can I work it continuously and how often do I need to shake things up a bit. The piece does require “technique”, it’s not like playing a Bach partita, but you do learn from playing it. But even if I can learn from playing it, I don’t consider this circuit is really an “instrument”. It’s like asking a drummer: “Have you ever thought of doing a 3-week tour of concerts, improvising with these other musicians, with just a triangle?” A lot of my circuits are like a triangle. In the right context, it’s the perfect sound, but do you want to hear it a whole night of solo triangle music? I have made circuits that make incredibly beautiful sounds, but I would have to say that, generally speaking, they have a limited range of sound and performance options. When people build analog synthesizers, they have several different modules, so that you can have variety. But I only have 4 or 5 “drums”. And the way of playing them doesn’t really give me, as a performer, enough variation. Here’s the problem: real musical instruments are amazingly nuanced. You get somebody out there with a guitar, with their voice, I even know people who do solo snare drum performance (maybe not triangle), and you get so much range, so much flexibility. And I’m sorry, I’ve been building circuits since I was 17 years old, and I’m a pretty good builder, but I will never be able to build a circuit that will have the expressivity of a snare drum. I don’t have that ability. I simply don’t feel comfortable doing that. Tribune 16 as it were. For example, I have this piece called The Royal Touch, which is based on connecting a simple circuit I built to a dead circuit board I found in the garbage. 2 Now, I don’t know what’s on the found circuit board, I think it’s an input channel from an old mixer. I know that on the one side there are resistors and capacitors, integrated circuits, etc. but I don’t know what’s what or what is where. So what I do is: I just push small contacts around on the side of the board with the traces connecting all those components, and I get a bunch of glitchy sounds. I push them around some more and suddenly you’ll hear a clear pitch. I try to sustain it but my hands are moving a little bit, the pitch will vanish. I move a fraction of a millimeter, kind of rolling my finger, trying to get the tone back or find another. That’s basically the performance. Now here is the thing. The oscillator tuning is a function of two components: One is whatever components lie between the two contact points on the dead circuit board, and then, inside the circuit I built each voice has a capacitor, which sets the range of the oscillator. When I built my circuit I selected a capacitor for each voice, so that one of these voices will always be too high to hear, one will always be so low as to be a rhythm, and the others are in between; when they collide and interact on the board, they modulate each other, create side bands and other effects. I know that each voice lies in a specific range of frequencies, I don’t know which one is which, but I know 131 Nicolas Collins 132 Making My newfound interest in DIY and circuits is also strongly linked to the teaching job at the School of the Art Institute of Chicago, which had a department called “Sound”—not “Music” but “Sound”. It was a very digitally-oriented school; everyone was using computers. I often say that command-X/command-V is the most powerful tool an artist can have. Suddenly you have one “pencil” that you can use to edit words, edit films, edit videos, edit sounds, edit website code, edit illustrations… It’s amazing! But at the same time, it is a very non-physical tool. And artists, unlike composers, generally speaking, even digital artists, they always started messy. Everyone who decides to go to art school started out scribbling, drawing with crayons on the kitchen table. Maybe that will change, maybe in 10 years we’ll finally have a generation of kids who never touched paper. But in my students, I saw this kind of schizophrenia: they were very electronically-oriented sonically, everything they heard was through earbuds or speakers, none of them played acoustic instruments, none of them listened to concerts of acoustic music, if they went to music events it was always clubs, so they were immersed in electronic sounds; but they wanted to do something with their hands. You know, it’s like these kids had a digital hangover: They woke up one morning and said “Too much computer, give me a circuit!” And I gave them a circuit. I always had little bits of circuitry in my music, and I was always doing minor hacks on things: no mixer or effect processors that came into my house remained unmodified for more than 30 seconds, I just opened them up and changed something. But most my attention by the end of the 1990s was focused on software, that’s where you can really work and get things done. Urged by my students I looked back at what I knew about circuitry and I thought: What of this is relevant today? I was looking for things computers do badly. You know, I’m sorry if this offends people, but there’s really no point to try building your own analog synthesizer from scratch. I mean, come on: A/ You can get beautiful synthesizer emulators that run on your computer and you don’t have to carry an extra piece of luggage, and B/ there are wonderful designers making these modules and they’re not terribly expensive so why not just buy them? But there are things that computers do badly, and the performance instrument is one of those weaknesses. So I did this class which was mostly making performable circuits, things that you can really interact with directly, things that you would touch with your skin. And the other thing was that we made unusual microphones. Because, again, all of my students—and everybody else in the world— were working with sample-based music creation; some of the samples were computer generated sounds, but a lot of them originated from the acoustic world. They have to get from the acoustic world into the electronic world. And if you can design you own microphones, it’s like designing your own ears: You can change the way you hear those sounds. Some of these mics are really simple and inexpensive to build, so why not? Also, if you build a mike for two euros, you’re much more willing to do something crazy with it, like putting it in 16 1 Hacking, in American English, it always had a meaning of sort of improvisatory solutions. And you use it in a number of ways, you can say: “I was hacking around the house”, which means I was doing little repair, like “fiddling” or “tinkering”, which often means a kind of work that’s not hugely productive or isn’t very expert. Our vocabularies are rich with words like this because it’s a very human activity. There is a connection between hacking and power that I think is very important. When you hack the telephone system, the telephone system is a very powerful thing. In 1970, to be able to hack a free long-distance telephone call from New York to England, woah, it was probably the equivalent of a hundred euros at that time. This is like significant power. When you got access to a big computer system for an insurance company, that was a million-dollar computer system with all these data in it, it represented power. One of the early aspect of hacking in American culture, before the telephone, was hot rod cars. The engine boxes of cars were designed very conservatively, and the hole for the cylinder had a lot of metal around it. And if you made this bigger, the engine would be stronger, because it was more displacement on the engine. So they begin this movement of increasing the power of your car by doing this machining in your home garage. This was like circuit bending: You From Circuitry toLive Improvisation (and back)… Hacking take the toy and you do thing that the factory doesn’t want you to do. These engines represented power. In other words, there was more power in the engine that they gave you, because it was under-utilized. So when you were over-drilling this, it was like making free long-distance calls, you know, suddenly you got the power yourself. But here is the thing: Whether it was the hot rod people, the phone people, or the computer hackers, they didn’t always use the power to its fullest extent. What was interesting for the hacker was often just to expose that power. Now my situation with hacking is very similar to the hot rod car persons. I learned a little bit of circuitry, I made a few simple circuits, but then I would finally buy something, I would buy a mixer or an effect pedal. And I would look at it and say: There is more in here than they’re letting me have. So I would open it up and I would make a change to give me access to something that was there but that the manufacturer wouldn’t let me access. One of the things I very often did, for example, when I bought something like a Makie mixer was—they would have very nice power supplies inside—drill hole in the box and put a connector on it so I could use the power supply of the Makie to power some other circuit of mine. What this meant is that I didn’t have to bring along on the road this second big power supply that I needed for my circuit, I used the Makie. That was a question of simply taking something from it. At the same time, there was this journal called The Audio Amateur, which would publish articles about an amplifier that you can buy that’s quite good, but if you open it up, and you take out these two capacitors, and you put in these two better capacitors, Tribune the middle of the street and record what it sounds like to have a garbage trunk run over a mike—you won’t do that with a Neumann, unless you’re a very rich person. 133 Nicolas Collins 134 you will have an even better sound. So in that case, the hack was to improve something, not to turn a stereo into a 4-channel amp, but to improve its performance. When I tap the power supply from the Makie, I’m adding something. When I change the capacitors, I’m improving it—both are parts of the same hacking aesthetic. There is a big generational change between my father’s generation and the generation of my students. My father was an academic, but he was a man who grew up in a world of mechanical things, with the assumption that you have to understand your mechanical world to keep it going. And the assumption was that the world was “open”. If you couldn’t do it yourself, maybe your neighbor could. And now, we live in a world where the technology is either remote— where is “the Cloud”? I have no idea—or it’s closed—how often have you opened up your MacBook? One of the things I get constantly in my workshops is people using that cliché word empowerment. They say: It was empowering because I never thought I could open this thing. It’s as simple as that, a lot of what we are doing in these workshops is opening something: We open a radio and we touch the circuit board; or we connect a loudspeaker directly to a battery. It is about opening. Even when we build a circuit, in a sense, it’s an opening process, backwards. Afterwards we understand what’s inside the boxes we buy. This may be naïve on my part—and as a New Yorker, I’m bitter and twisted and cynical by nature—but I think that there is a political value to giving someone a sense of control over the material in their life, so you don’t feel that you are always a victim of something. I think that one of the things about hacking that has value that goes beyond just making weird noises is: It makes people aware of how things work, it either gives them a sense that they have a little bit more control over something that they otherwise couldn’t, or it means that they don’t have to believe what other people tell them. You know, like when you’re having problem with the cable for your television and phone support says: “Oh, there is nothing that can be done because the cable junction at the next block is broken”. Then you can say: “No! They can go to the cable junction, they can open a box, and they can put a jumper wire in!” And then they go: “Woah! How did you know that?” In other words, it means that you can challenge the people who depend on the “closedness” of their system for control. Which gets back to “power”: as long as the power is enclosed and is invisible, it’s mysterious and has power over you. But when you get access to it, you know what the mechanism is, and you realize that it isn’t absolute and that it has limitations. Notes de lecture Sommaire 136 Ewa Mazierska, Les Gillon et Tony Rigg, Popular Music in the Post-Digital Age : Politics, Economy, Culture and Technology, New York, Bloomsbury, 2018. Par Loïc Riom 139 Nicolas Collins, Micro Analyses, édité et traduit de l’anglais par Lionel Bize, Laura Daengeli, Samia Guerid, Christian Indermuhle, Christine Ritter et Thibault Walter, Paris, Van Dieren, coll. « Rip on/off », 2015. Par Christophe Levaux 142 Tetsuo Kogawa, Radio-art, UV Éditions, Paris, 2019. Par Gabriele Stera 16 Notes de lecture 1 135 Ewa Mazierska, Les Gillon et Tony Rigg, Popular Music in the Post-Digital Age : Politics, Economy, Culture and Technology, New York, Bloomsbury, 2018 Par Loïc Riom La liste des monographies et des ouvrages collectifs portant sur les musiques populaires et le numérique est longue 1 . Toutefois, la multiplication des travaux sur 136 1 On peut entre autres citer Rogers Jim (2013), The Death and Life of the Music Industry in the Digital Age, New York, Bloomsbury Academic ; Prior Nick (2018), Popular Music, Digital Technology and Society, Londres, Sage Publications ; Nowak Raphaël (2016), Consuming Music in the Digital Age Technologies, Roles and Everyday Life, Basingstoke & New York, Palgrave Macmillan ; Wikström Patrik (2013), The Music Industry : Music in the Cloud, Cambridge, Polity Press ; Leyshon Andrew (2014), Reformatted : Code, Networks, and the Transformation of the Music Industry, Oxford & New York, Oxford University Press, ou encore Philipe Le Guern (ed.) (2016), Où va la musique ? Numérimorphose et nouvelles expériences d’écoute, Paris, Mines ParisTech et ibid. En quête de Musique. Questions de méthode à l’ère de la numérimorphoses, Paris, Hermann. le sujet provoque un sentiment un peu paradoxal : alors que ces nombreuses publications pourraient laisser penser que la question est désormais bien balisée, plus les comptes rendus s’accumulent, plus il est difficile de savoir véritablement ce qui est en jeu. D’une part, chaque auteur semble donner un sens un peu différent aux termes de « numérique » ou de « numérisation ». D’autre part, les problématiques traitées semblent parfois quelque peu s’essouffler – mutations des pratiques d’écoute, crise de l’industrie de la musique enregistrée, etc. – sans que de nouvelles perspectives ne s’ouvrent réellement. Dans un tel contexte, que peut apporter la publication d’un nouveau livre comme Popular Music in the Post-Digital Age ? Au premier abord, la principale contribution de cet ouvrage collectif semble n’être que de réunir une grosse dizaine de chapitres supplémentaires sur un sujet déjà bien exploré. Néanmoins l’ouvrage aborde au moins deux pistes de recherche qui méritent notre attention. C’est 2 Strachan Robert (2017), Sonic Technologies : Popular Music, Digital Culture and the Creative Process, New York, Bloomsbury Academic. Popular Music in the Post-Digital Age : Politics, Economy, Culture and Technology 1 seulement permet de dépasser certains débats peu fertiles – comme la datation de l’entrée dans l’« âge numérique » –, mais invite surtout à explorer les sites et les activités qui comptent dans l’âge post-digital. À ce titre, le sommaire du livre donne quelques idées de ces enquêtes qui restent encore largement à mener : la curation de playlists, l’utilisation de la blockchain pour la gestion des copyrights, la prescription algorithmique ou encore les assistants vocaux personnels comme Alexa. Ensuite, tout en étant un marqueur temporel, le préfixe « post- » évite l’écueil de la rupture et d’une conception du temps peut-être trop linéaire. En posant la question « quand est-ce qu’a commencé le présent ? » (p. 2), les éditeurs esquissent d’autres manières de penser la temporalité. Dans son chapitre, Mathew Flynn reprend cette approche à son compte (chapitre 10, « Back to the Future : Proposing a Heuristic for Predicting the Future of Recorded Music Use »). En analysant tour à tour différents dispositifs d’écoute (« playback devices ») – le piano, le phonographe, la radio –, l’auteur cherche à saisir ce qui pourrait faire le succès des dispositifs de demain. Cette approche – presque archéologique – lui permet de souligner une continuité parmi ces dispositifs d’écoute : l’auditeur est progressivement libéré du « playbour » (contraction de « play » et de « labour »), le travail nécessaire à l’écoute. Pour Flynn, le succès des plateformes d’écoute en ligne s’inscrirait ainsi davantage dans le succès de la radio que dans celui du disque, laissant potentiellement envisager la montée en puissance à venir des assistants vocaux. Dans un registre proche, Patryk Galuszka et Katarzyna Wyrzykowska s’interrogent sur l’évolution de la notion d’indépendance dans l’industrie de la musique Notes de lecture 16 autour de celles-ci que j’organiserai mon propos – exercice toujours difficile pour des ouvrages qui, comme celui-ci, regroupent des contributions très hétérogènes. La première piste tient peut-être simplement à l’utilisation du préfixe « post- », qui dès le titre marque l’idée d’un décalage temporel. Dans leur introduction, Ewa Mazierska, Les Gillon et Tony Rigg précisent : « les termes de post-digital ou de post-internet ne se réfèrent pas à la période où les technologies numériques ou Internet cessent d’agir ou de compter, mais, au contraire, lorsqu’elles deviennent omniprésentes » (p. 3, ma traduction). Pour appuyer leur propos, ils reprennent ce que Robert Strachan 2 identifie comme la « convergence numérique » : la superposition des différentes couches d’innovations sociotechniques qui concordent dans certains dispositifs comme l’ordinateur personnel (auquel on pourrait ajouter désormais le smartphone). Il me semble que cette expression produit deux déplacements fructueux. D’abord, elle relègue au second plan le vocabulaire de la transformation, de la révolution ou du changement. Autrement dit, en postulant l’existence d’un âge post-digital, il ne s’agit pas tellement de savoir ce qui change et pourquoi, mais davantage de prendre acte de la place qu’occupent les technologies numériques et Internet dans les mondes contemporains de la musique. Cette prise de distance vis-à-vis d’une question souvent omniprésente dans les travaux sur les musiques populaires et le numérique non 137 138 (chapitre 1, « Rethinking Independence : What Does “Independent Record Label” Mean Today? »). lls partent du constat que la multiplication des formes de coopération entre majors et indés a brouillé les frontières entre ces deux catégories de labels. En s’appuyant sur des entretiens menés avec des professionnels de la musique en Pologne, les deux auteurs questionnent l’évolution du pouvoir descriptif du terme d’indépendant. Sans en donner de définition a priori, ils montrent comment les acteurs font évoluer sa signification et ce que cela leur permet de faire. Les auteurs soulignent en particulier que les petits labels utilisent l’indépendance pour se tenir en dehors d’un marché de la musique enregistrée en acceptant, par exemple, que leur activité soit déficitaire. Certaines plateformes comme Bandcamp ou Soundcloud leur permettent d’exister tout en renonçant à ce que leurs disques soient distribués en dehors de leurs sites Internet. La seconde piste intéressante qu’esquisse le livre est la préoccupation pour le futur. Dès les premières lignes de l’introduction, les éditeurs posent le « futur de la musique » au centre de leur projet éditorial. Si cette formulation peut paraître un peu surprenante, voire complètement étrangère au vocabulaire des sciences sociales, il y a peutêtre ici justement une manière de renouveler la façon de problématiser la rencontre de la musique et du numérique. En s’appuyant sur Jacques Attali, les éditeurs défendent le fait que la musique a toujours été en première ligne des changements technologiques, politiques, économiques et culturels (p. 1). Le futur de la musique serait donc un site d’observation privilégié des mondes à venir. Ce projet est repris à la lettre par Paolo Magaudda (chapitre 2, « The Future of Digital Music Infrastructures ; Expectations and Promises of the Blockchain “Revolution” »). Il s’intéresse aux promesses pour la musique de la technologie blockchain. Selon ses promoteurs, celle-ci permettrait de mettre en place un système de redistribution de royalties parfait et transparent. Toutefois, l’auteur souligne que ce futur encore largement à écrire met en évidence les enjeux micropolitiques des infrastructures nécessaires à la circulation des formats numériques : comment fonctionnent-elles ? qui les contrôle ? quelles idées de la musique se font les ingénieurs qui les développent ? Il conclut que cette technologie pourrait bien se transformer en cauchemar et au contraire faciliter des formes de contrôle automatisé au profit des grandes plateformes numériques. D’une manière un peu différente, Emilia Barna se penche sur le futur de la curation de playlists (chapitre 12, « Curators as Taste Entrepreneurs in the Digital Music Industries »). Pour ce faire, elle suit les débats qui entourent cette activité de prescription culturelle. Conscients de leur rôle, certains curateurs s’interrogent sur leur activité : comment assurer une bonne représentation de la diversité ? Que faire de son pouvoir de prescription ? Que faire de la compétition pour entrer dans les playlists ? En suivant leurs hésitations, Barna rend compte du futur de la curation de playlists peu à peu en train de se (re)faire et des efforts de certains pour imaginer ce à quoi pourrait ressembler la prescription musicale de demain. Si, dans certains passages du livre, plusieurs auteurs jouent avec le vocabulaire de la prédiction, voire de la prophétie, il ne faut pas s’y tromper : il n’est pas question de jouer aux apprentis astrologues, mais bel et bien de faire du futur un objet d’enquête. Barna et 1 Nicolas Collins, Micro Analyses, Paris, Van Dieren, coll. « Rip on/off », 2015 Par Christophe Levaux Compositeur issu de la mouvance expérimentale américaine, héritier de la culture punk ou à tout le moins d’une certaine culture postmoderne, Nicolas Collins est également curateur musical, professeur (à la School of the Art Institute of Chicago), éditeur (du Leonardo Music Journal), et enfin auteur. Collins n’a pas seulement écrit l’incontournable Handmade Electronic Music : The Art of Hardware Hacking 3 , véritable manuel du bricolage électronique sonore dont il est l’une des figures de proue, il a également produit une série de textes sur sa propre œuvre ou celle de contemporains (souvent renommés) avec lesquels il a collaboré comme David Tudor, ou Alvin Lucier, dont il a été l’élève au cours des années 1970. En 2015, Rip on/off s’empare d’une partie de ces textes. Rip on/off est un projet culturel, musical et littéraire qui depuis 2008, vise à « promouvoir, par le biais d’édition de livres, d’organisation de performances, de conférences et d’ateliers, le travail en art sonore effectué par des artistes contemporains ». Les écrits de Nicolas Collins, édités et traduits (par Lionel Bize, Laura Daengeli, Samia Guerid, 3 Nicolas Collins (2009), Handmade Electronic Music : The Art of Hardware Hacking, New York, Routledge. Notes de lecture 16 Micro Analyses Magaudda fournissent deux bons exemples de comment, en suivant les acteurs eux-mêmes à mesure qu’ils envisagent un futur pour la musique, tâtonnent et esquissent les contours des mondes qui viennent, il est possible de penser d’une manière originale les liens entre technologie, musique et innovation. Comme nous l’enseignent ces deux auteurs, il s’agit bien de redonner de la place au politique ou pour le dire un peu différemment (et en reprenant l’une des maximes des Science and Technology Studies) de montrer que les choses pourraient être autrement. Et c’est peut-être bien ici qu’on peut trouver, dans Popular Music in the PostDigital Age, quelques (bonnes) pistes pour tenter de ressaisir les musiques populaires et leurs devenirs numériques. 139 140 Christian Indermuhle, Christine Ritter et Thibault Walter), viennent ainsi s’ajouter à la liste de textes de compositeurs (de près ou de loin rattachés à la musique expérimentale) tels que Zbigniew Karkowski, David Dunn ou Leif Elggren. Souvent très brefs, toujours pédagogiques et parfois pleins d’humour, les textes de Collins, pour certains inédits, sont publiés sous le titre de Micro Analyses. Ce sont respectivement Veniero Rizzardi et Jérôme Noetinger qui introduisent l’ouvrage. À les lire, cela ne fait aucun doute : on se situe bien avec Collins dans la généalogie cagienne du « tout son peut être musical », étiré ici jusqu’au do-it-yourself et au circuit bending, cette activité qui consiste à court-circuiter des instruments de musique électronique de faible tension électrique. Micro Analyses est divisé en trois parties : « Écouter les autres », rassemblant les écrits de Collins sur ses collègues compositeurs ; « Expérimenter », présentant l’analyse de Collins de deux de ses œuvres, et enfin « Faire soi-même », une série de témoignages sur l’activité de détournement des matériaux techniques mise en œuvre par l’auteur lui-même. La première de ces trois parties est à n’en pas douter la plus séduisante pour l’historien de la musique des XX e et XXI e siècles. Riche en anecdotes sur la scène expérimentale américaine, elle présente d’abord un essai sur l’évolution de la réception de Cage, du « déni » à l’« acceptation », ainsi qu’une série de réflexions dont on ne pourra que saluer la perspicacité : « la suppression du goût personnel exigée par Indeterminacy remettait en cause les principes les plus fondamentaux de leur identité et de leur valeur en tant que compositeurs » écrit Collins au sujet des contemporains de Cage (p. 27). « Cage rejetait fréquemment l’improvisation sous toutes ses formes, et ce rejet était aggravé par la peur de nos mentors de ne pas être pris au sérieux en tant que ‘‘compositeurs’’ » affirme-t-il également (p. 32). Avec la même perspicacité, Collins s’attache dans un autre texte à identifier les concepts fondamentaux de la musique de son ancien maître Alvin Lucier. Sans surprise il vise en particulier ceux qu’il fera siens dans sa propre œuvre : la résonance et l’utilisation du haut-parleur comme agent plutôt que comme dernière étape de la diffusion musicale (p. 44). Plus dispensable : un très court texte sur David Tudor où l’amplification, et en particulier la notion de gain, se trouve au cœur de la lecture de Collins. On épinglera plutôt en fin de première partie cette réflexion que pose l’auteur sur l’idée de révolution musicale. « Je me demande maintenant si les années 1960-1970 ont effectivement représenté une révolution conceptuelle véritable dont nous sommes encore en train d’évaluer les répercussions ou s’il s’agissait simplement d’un changement parmi d’autres, de valeur plus ou moins égale, qui ont été éparpillés sur les cinquante dernières années, éclipsés par mes souvenirs de jeunesse. » écrit-il (p. 54). Question cruciale s’il en est pour ce compositeur ayant frayé avec l’avant-garde expérimentale américaine à l’époque de ses grandes heures. Collins tente d’y répondre lui-même avec l’aide d’autres compositeurs ou auteurs dont on se plaît de lire le nom : David Toop ou Kyle Gann parmi d’autres. Si l’anthropologue ou le féru d’épistémologie restera un peu sur sa fin à la lecture de la méditation de Collins et de ses collègues, l’historiographe appréciera d’avoir accès aux questionnements (et tentatives de réponse) que ceux-ci posent devant les nouveaux paradigmes musicaux créés par la croissance technologique ou internet. 1 Micro Analyses l’échantillonnage de transmissions d’ondes am, fm, et du bidouillage de circuits artisanaux, Devil’s Music, plus encore qu’« un modèle précoce de techno » comme l’avait décrit Philip Sherburne (p. 108), est une anticipation de près de trente ans de la Vaporwave de James Ferraro ou de Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), ce genre qui, très précisément, a fait du sampling et de la manipulation de sons associés à la consommation de masse sa marque de fabrique. Troisième et ultime partie de l’ouvrage, « Faire soi-même », vise à illustrer le travail de détournement des technologies sonores mis en œuvre par Collins – bien qu’on pourra au final se demander en quoi il se départit réellement de son activité expérimentale décrite au cours de la partie précédente. Toujours très ludique, « détourner le lecteur cd » illustre la manière dont Collins s’est emparé un peu comme un apprenti sorcier du lecteur CD afin de créer une musique évoquant « Terry Riley, remis au goût du jour pour l’ère numérique » (p. 116). Le texte illustre également des œuvres comme Broken Light (1991) opposant un quatuor à cordes live à un disque de concerti grossi baroque de Corelli, Torelli et Locatelli diffusé par un lecteur CD lui-même piloté par les musiciens via des pédales d’effet. « Fabriquez votre propre réverbe » poursuit dans la même veine, plus encore sur le mode du manuel du petit bricoleur : « Vous pouvez en acheter un chez Radio Shack si vous êtes pressé, mais vous paierez un supplément de commodité, et vous devrez compter sur votre expérience de décorticage de palourde pour extraire le disque de son coquillage » écrit Collins à propos des capteurs de micro contact (p. 127). Suivent des instructions du même acabit pour la construction des réverbes, la réalisation de soudures. Des témoignages sur Notes de lecture 16 La seconde partie de l’ouvrage, « Expérimenter », s’articule autour de deux œuvres de Nicolas Collins dont l’auteur propose un commentaire fouillé : Pea soup, composée au milieu des années 1970 et Devil’s Music écrite une dizaine d’années plus tard (et toutes deux révisées par la suite). Plus qu’une simple analyse technique (dont on appréciera par ailleurs la transparence et les nombreuses illustrations), l’aperçu que donne Collins de Pea soup laisse entrevoir le cheminement du compositeur à la suite de sa découverte de l’esthétique cagienne. Comme beaucoup d’expérimentalistes de la seconde génération, la « libération cagienne » apparait dans le même temps pour Collins comme une contrainte indépassable : « Le mot d’ordre de Cage selon lequel ‘‘tout son peut être musical’’ induisait une sorte de paralysie sonore en moi » écrit-il (p. 73). La paralysie ne sera pourtant que momentanée : l’attention du compositeur sur le concept de résonance et en particulier sur le feedback (le son produit par le haut-parleur lorsqu’un microphone est disposé trop près de lui) puis le hacking ont précisément trouvé leur origine dans la motto cagien : l’amplification du silence due au feedback produisait des sons « avec de minimales interférences de ma part » écrit Collins (p. 73). Et c’est en manipulant les circuits d’un simple enregistreur cassette qu’il créera un instrument de feedback portable indépendant. Sous les mots de Collins, le chemin de la découverte de Cage au hacking en passant par le feedback semble presque limpide. C’est le concept d’indétermination qui en imprime sa marque. L’histoire que livre ensuite Collins de Devil’s Music n’est pas moins riche d’enseignements divers. Ici, on s’étonnera sans doute du caractère presque prophétique de l’œuvre. Résultat de 141 le passage à la programmation informatique dont l’amateur de hacking ou de circuit bending familier du travail de Collins se délectera assurément. Livré avec le DVD Salvaged présentant une série d’œuvres du compositeur, Micro Analyses s’avérera un complément utile au Handmade Electronic Music : The Art of Hardware Hacking ou au (déjà très complet) site de Collins https://www.nicolascollins. com/. Pédagogique, parfois humoristique, il constituera également un témoignage riche pour l’historiographe ou l’historien de la musique des XX e et XXI e siècles. Tetsuo Kogawa, Radio-art, UV Éditions, Paris, 2019 Par Gabriele Stera 142 Pendant le boom électronique des années 1980, lorsque toutes les technologies de communication visaient à aller plus loin et plus vite, l’intuition radiophonique la plus déroutante de Tetsuo Kogawa a été celle de réduire au minimum la puissance de ses émetteurs, en participant ainsi à la naissance du mini-FM, un mouvement clé dans l’histoire des radios libres japonaises, qui visait à opposer au broadcasting des mass-médias une pratique militante et conviviale de la radio à petite échelle. Dans cette anthologie, coordonnée par Pali Meursault pour UV Éditions, nous trouvons une sélection des textes les plus importants de Kogawa, qui retrace son parcours d’artiste sonore, radio-activiste et théoricien. Le corps du livre est composé de deux sections. La première, « Akiba », raconte l’évolution du célèbre « quartier électronique » de Tokyo, à partir des années 1960. Dans ce fascinant récit autobiographique, Kogawa met en évidence les rapports intrinsèques entre les changements urbains, économiques et culturels qui ont accompagné l’évolution technologique du Japon post-moderne. C’est avec un regard passionné et quelque peu nostalgique que l’auteur nous décrit son parcours d’initiation à la construction d’émetteurs et de récepteurs radio. Les recherches de pièces détachées dans les junk-shops de Akiba, l’art de la soudure et de la conception de circuits, les ruses techniques et juridiques de l’émission à ondes courtes sont autant de phases d’un parcours d’apprentissage, à la fois technique, esthétique et politique qui fait la particularité de Kogawa. 1 4 On y trouve, parmi les autres, DeeDee Halleck, Hank Bull, Geert Lovnik, Adam Hyde, Marcello Lorrai. Radio-art radio-artiste et activiste. Kogawa décrit la radio comme un « espace polymorphe » (p. 231), et il appelle, dans le sillage de Félix Guattari, à une « révolution moléculaire » des systèmes de médiation, seule manière de dépasser l’individualisme électronique créé par la société de consommation capitaliste. À travers plus de 40 ans d’engagement artistique, de workshops de fabrication d’émetteurs, de radio-parties et performances collectives, Kogawa développe une pratique artistique singulière, qui est aussi une philosophie, une proxémique des circuits de médiation, affranchie et exploratrice, qui se joue à l’échelle des mains, d’un bâtiment, d’une communauté. Le radio-art dont il nous parle est donc bien plus qu’une pratique de niche parmi les media-arts, c’est une voie d’expérimentation radicale qui noue les rôles d’ingénieur et d’artiste, de chercheur et de hackeur, en apportant une réponse à ceux qui, des Futuristes à Arnheim, d’Adorno à Schaeffer jusqu’aujourd’hui, se sont demandés si un art proprement radiophonique était possible. Une très belle introduction de Pali Meursault, un entretien inédit de Kogawa à Félix Guattari, ainsi que deux textes de John Duncan et Elizabeth Zimmerman complètent l’ouvrage. Le livre, nourri de documents photographiques et soigneusement mis en page, se termine avec un schéma de construction d’un mini-émetteur radiophonique conçu par Kogawa lui-même. Ce qui confirme l’évidence que ces pages veulent être des outils, et qu’en tant que tels, ils appellent à une pratique. Puisque ce que Kogawa souligne dans chacun de ses textes est que la radio est belle « en action », dans le déploiement de ses possibles au sein d’un territoire et dans l’enchevêtrement de ses potentiels dans le tissu social. Notes de lecture 16 Dans ces pages, on découvre une radio souterraine, radicalement militante, constamment travaillée par des questionnements sociologiques, une radio qui sert à créer des modèles de pensée et à favoriser la prolifération de communautés électroniques résistantes. La machine, vue comme prolongement du corps organique, fait l’objet d’une « dévotion animiste post-moderne » (p. 126), et l’acte de la fabriquer, l’ouvrir, l’hacker, est alors un geste d’appropriation qui s’oppose au « fétichisme malsain de l’emballage » (p. 74) et à l’asservissement aux préfabriqués capitalistes. Ainsi on suit Kogawa à travers l’histoire des radios libres japonaises : du début du mouvement mini-FM à la création de Radio Home Run, jusqu’aux nombreuses expériences d’échange avec les activistes européens, américains, australiens 4 . La radio, telle que Kogawa la conçoit, est un art du corps et des corps, un art de la transmission et de la radiation, un « outil de convivialité » (dans les termes de Ivan Illich) qui dépasse la fonction de moyen de communication centralisé pour devenir un espace d’apprentissage collectif. C’est donc dans une démarche post-média qu’il nous invite à « penser avec les mains », dans l’esprit de la culture DIY, afin d’explorer la matérialité du métal et des ondes, sans trop nous soucier du contenu de l’émission, mais plutôt en concentrant notre attention sur la qualité esthétique et politique des circuits, aussi électroniques que sociaux. Dans la deuxième partie de l’ouvrage, on trouve une sélection des manifestes et des articles de Kogawa, qui développent les lignes conceptuelles de son expérience de 143 d’adaptation. Ce travail vise ainsi à penser la complexité de l’articulation entre les notions de culture ouvrière, culture Cultures ouvrières et musiques populaires en Grande-Bretagne : le cas des brass bands miniers de 1945 au milieu des années 1970 entre l’histoire sociale et les popular music studies. Mots-clés : musiques populaires / cultures ouvrières / fanfare, / jazz, rock’n’roll / pop music / culture jeune / Grande-Bretagne / XXe s Abstract: The history of British brass bands in the second half of the 20th century is often portrayed as the symbol of a declining working-class culture swallowed by mass culture and other types of popular music like rock’n’roll. The case of brass bands in British coalfields shows that if this musical genre became more and more marginalized between 1945 and the mid-1970s, this process was ongoing since the interwar years and its unfolding was very complex. The use of new and varied material—and especially oral history—highlights the 16 Par Marion Henry (Institut d'Études Politiques de Paris) importance of complementarities and continuities between genres of popular music and adaptation capacities from brass bands. The aim of this paper is ultimately to refine Cet article a reçu le prix « Jeune chercheur » décerné par la branche francophone d’Europe de l’International Association for the Study of Popular Music (IASPM-bfE) pour l’année 2018. Résumé : L’histoire des brass bands britanniques dans la deuxième moitié du xxe siècle est souvent mise en avant comme le symbole d’une culture ouvrière en déclin, progressivement avalée par les forces de la culture de masse et le succès d’autres types de musiques populaires comme le rock’n’roll. Le cas des brass bands miniers montre que si ce genre musical est de plus en plus marginalisé entre 1945 et le milieu des 1970, processus qui n’est que l’intensification d’un phénomène amorcé dans l’entre-deux-guerres, son évolution est complexe. L’utilisation de sources variées et inédites, et en particulier de sources orales, met en lumière our understanding of the relationship between the notions of working-class culture, popular culture and mass culture and to foster the discussion between social history and popular music studies. Keywords: popular music / working-class culture / brass band / jazz / rock’n’roll / pop music / youth culture / Great-Britain / 20 th century En juillet 2 012 , le Grimethorpe Colliery Band, fameux brass band minier du Yorkshire est invité à jouer lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres pour accompagner la fresque historique pensée par Danny Boyle représentant le passage de la Grande-Bretagne d’un paradis rural et bucolique à une société Article 1 populaire et culture de masse et à contribuer au dialogue Cultures ouvrières et musiques populaires en Grande-Bretagne… Article des phénomènes de complémentarité, de continuité et 145 Marion Henry 146 industrielle 1. Cette performance est particulièrement représentative de la place ambiguë que tient ce genre musical, à la fois marginale au sein de la culture musicale populaire britannique et centrale dans l’expression d’une identité ouvrière symbolique. Les brass bands sont des ensembles musicaux amateurs formés de 24 à 25 cuivres accompagnés de percussions. Nés dans les régions industrielles du Nord de l’Angleterre au milieu du XIX e s., leur instrumentation se fige à la fin du siècle dans le cadre de la pratique de la compétition (Herbert, 2000 : 6). Ces formations musicales, qui occupent une place centrale au sein du champ des musiques populaires en Grande-Bretagne jusqu’en 1914, sont progressivement marginalisées après cette date. Dans un chapitre intitulé « What is wrong with the Brass bands ? Cultural Change and the Brass Band Movement, 1918-c.1964 », Dave Russell détaille ce processus de déclin numérique accompagné d’une perte d’influence, qui trouve un point de non-retour à la fin des années 1950 (Russell, 2000). S’il ne peut donner des chiffres précis en raison de l’absence d’un registre officiel des brass bands, l’historien estime à 2 600 le nombre de ces formations musicales en 1913 et fait état d’un déclin continu depuis 1918 avec des phases d’accélération juste après la Première Guerre mondiale et entre la fin des années 1950 et les années 1960. Selon lui, le nombre de brass bands aurait diminué de plus de la moitié entre 1913 et le milieu des années 1960 (Russell, 2000 : 69-72). 1 « Grimethorpe set for Olympic Opening Ceremony », 4barsrest, 27 juillet 2012 [en ligne]. URL : https:// www.4barsrest.com/news/15553/grimethorpe-setfor-olympic-opening-ceremony Dans une perspective héritée des cultural studies, développées à partir des années 1950 par Richard Hoggart, Raymond Williams et Stuart Hall, l’histoire des brass bands dans la seconde moitié du XX e siècle est exemplaire du déclin de la culture ouvrière perçue comme traditionnelle, avalée par la culture de masse (Fontaine, 2017b). Dans La Culture du pauvre paru en 1957, Richard Hoggart met en avant ce genre musical comme représentatif d’un « monde plus ancien » (Hoggart, 1992 : 110 2). S’inscrivant dans les renouvellements récents d’une histoire sociale des musiques populaires (Gildart, 2013 ; Frith et al., 2013 et 2018 ; Nott, 2002), cet article, en se concentrant sur le cas des brass bands liés à l’industrie minière britannique, cherche à mettre en avant la complexité de ce processus et à souligner l’existence de continuités et de complémentarités entre les genres musicaux dits traditionnels et ceux liés à l’explosion de la culture jeune et à l’influence des États-Unis, principalement le jazz et le rock’n’roll. Cette démarche permet d’interroger l’évolution des brass bands en insistant sur la porosité de la frontière entre tradition et modernité. Elle s’appuie sur le recours à des sources variées et notamment à l’histoire orale, qui permet de mettre en lumière les expériences et trajectoires individuelles des musiciens et des musiciennes 3 . 2 L’ouvrage d’Hoggart est divisé en deux parties : « An “Older” Order » et « Yielding Place to the New » (« céder la place au nouveau »). 3 L’analyse repose essentiellement sur les archives du magazine Coal publié par le National Coal Board (N.C.B.) à partir de 1947 et qui devient le journal Coal News en 1961 et sur une série de 14 entretiens menés avec des musiciens de brass bands liés à l’industrie minière (anciens employés du N.C.B. et membres de 1 leur famille) en Écosse, dans les Midlands de l’Est et dans le Yorkshire entre juillet 2012 et juillet 2018. 4 Voir notamment le programme du colloque « Le son et la musique au prisme des sound studies » organisée à l’EHESS du 24 au 26 janvier 2019 : https:// www.ehess.fr/fr/conference-sound-studies. Cultures ouvrières et musiques populaires en Grande-Bretagne… orphéonique (Gumplowicz, 1987 ; Martino, 2016 ; Cambon, 2011). Le cas des brass bands miniers est particulièrement intéressant car les formations musicales liées à l’industrie minière représentent au lendemain de la guerre une part très importante du brass band movement (Russell, 2000 : 100) et parce que les pratiques culturelles des communautés minières britanniques ont longtemps été présentées comme spécifiques et archétypiques de la culture ouvrière. Cette vision a été influencée par les travaux d’anthropologie et de sociologie des community studies des années 1950 et 1960 (Dennis et al., 1956 ; Franckenberg, 1957) mais aussi par l’historiographie marxiste (Arnot, 1949). Elle a largement été critiquée à partir des années 1980 par un ensemble de travaux cherchant à nuancer l’unité supposée des mineurs en mettant en lumière l’importance des expériences régionales et locales (Campbell et al., 1996). Appréhender l’histoire de ce genre musical à travers l’industrie minière permet également d’utiliser des sources inexplorées par les historiens du brass band movement et d’opérer un glissement de perspective vers des espaces aux degrés d’urbanisation divers, alors que les villes sont généralement au cœur des travaux qui analysent l’impact de la culture de masse sur les musiques populaires dans la deuxième moitié du XX e siècle (Gildart, 2013 ; Frith et al., 2013). Au moment de la nationalisation de l’industrie minière britannique en 1947, désormais dirigée par le National Coal Board (N.C.B.), les brass bands sont mis en avant comme le porte-drapeau de l’unité des mondes miniers alors que le charbon est essentiel à la reconstruction du pays après la guerre (Henry, 2018). En 1945, il existe Article 16 Cette recherche s’inscrit dans un contexte d’essor de l’histoire sociale des musique populaires depuis les années 1980, alors que celles-ci sont progressivement devenues un objet d’étude à part entière pour les historiens grâce au développement et à l’institutionnalisation des popular music studies et plus récemment des sound studies (Russell, 1993 ; Sterne, 2012). Ce dynamisme a permis de consolider le dialogue entre les disciplines comme l’histoire, la musicologie ou encore l’anthropologie autour de l’objet musical (Buch et al., 2013 ; Campos et al., 2006 4). Cette évolution se reflète dans celle de l’histoire du brass band movement, qui s’attache depuis les années 1980 à inscrire davantage le genre musical dans un contexte social, économique et culturel (Taylor, 1979 et 1983 » ; Herbert, 1991 et 2000). Toutefois, si l’identité ouvrière des brass bands est mise en avant, le lien entre ces formations musicales et les secteurs industriels est rarement exploré en détail, si ce n’est pour la période d’avant 1930 et dans le cas d’études régionales (Etheridge, 2014). Le chapitre déjà évoqué de Dave Russell sur l’histoire des brass bands entre 1918 et le milieu des années 1960 est une donnée précieuse, bien que les analyses concernant la période d’après 1945 soient moins détaillées que celles sur l’entre-deux-guerres. On peut également mentionner ici l’utilité des travaux francophones sur le mouvement 147 Eamonn Bell 148 différents types de formations musicales liées à l’industrie : des town bands ou publics bands liés à une localité, des colliery bands affiliés à une mine en particulier et des welfare bands rattachés à un miners’ welfare club. L’expression de « brass bands miniers » permet de recouvrir cette diversité. Cette étude prend en compte l’ensemble des régions minières britanniques mais avec un regard plus précis sur une sélection d’espaces : l’Écosse, les Midlands le l’Est et le Yorkshire. Ce choix permet de mettre en évidence des bassins miniers aux caractéristiques différentes : une industrie vieillissante et touchée dès la fin des années 1950 par le processus de désindustrialisation en Écosse contrairement aux mines du Yorkshire et des Midlands de l’Est, plus modernes et atteintes plus tardivement par les fermetures de puits. Cette démarche permet également de ne pas restreindre l’analyse aux brass bands anglais, qui sont généralement au cœur des travaux de synthèse (Russell, 2000). La période qui s’étend du lendemain de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1970 enserre ce deuxième moment d’accélération du déclin des brass bands de la fin des années 1950 et des années 1960 (Russell, 2000 : 72) et coïncide avec une première vague de désindustrialisation qui affecte principalement les bassins miniers d’Écosse, du nord-est et du nord-ouest de l’Angleterre et du sud du Pays de Galles (Phillips, 2018). Il s’agit alors d’interroger la spécificité de ce moment marqué par l’essor du rock’n’roll 5 , tout en 5 L’arrivée du rock’n’roll en Grande-Bretagne est marquée par la sortie de « Rock Around the Clock » de Bill Haley and The Comets en 1955 et « Heartbreak Hotel » d’Elvis Presley en 1956 (Gildart, 2013 : 14). insistant sur la continuité avec la période de l’entre-deux-guerres. En effet, le processus d’américanisation de la culture de masse et de diversification des pratiques culturelles, lié aux innovations technologiques et à la hausse du niveau de vie est en cours depuis les années 1920 (Fowler, 2008 ; Nott, 2002 ; Russell, 2000). Le milieu des années 1970 marque en Grande-Bretagne le début d’une période de stabilisation du processus de désindustrialisation qui affecte l’industrie minière (Phillips, 2018) et l’apparition de nouveaux sous-genres musicaux liés aux cultures jeunes avec le glam rock porté par David Bowie à partir de 1972-1973 et la musique punk (Gildart, 2013 : 16). Une première partie de cet article s’appuiera volontairement sur l’opposition classiquement opérée entre les brass bands, comme forme de musique populaire dite traditionnelle, et le jazz et le rock’n’roll, genres musicaux liés à l’américanisation de la culture de masse, afin de montrer la porosité de cette frontière et de mettre en lumière des complémentarités et des continuités sur le plan des pratiques. Une deuxième partie s’intéressera aux efforts d’adaptation des brass bands, en particulier en matière de répertoire, et soulignera l’importance du rôle de ces dernier pour la vie sociale et culturelle des bassins miniers jusqu’au milieu des années 1970. Bien que la portée de ces initiatives soit limitée, il s’agit ici de mettre en avant la persistance, sous certains aspects, du caractère populaire de ces formations musicales dans les bassins miniers. 16 1 La transformation des pratiques musicales des bassins miniers britanniques liée à l’américanisation de la culture de masse et à l’essor des cultures jeunes s’inscrit dans un cadre chronologique large. Depuis les années 2000, les historiens des musiques et des cultures populaires ont nuancé la rupture des années 1950-1960, mise en avant notamment par Arthur Marwick (Marwick, 1998), et ont montré la continuité avec l’entre-deuxguerres (Gildart, 2013 ; Fowler, 2008 ; Nott, 2002) voire avec la période antérieure (Faulk, 2010), alors que le concept de « culture jeune » est désormais pensé sur le long terme (Fowler, 2008 ; Savage, 2008). Dans son analyse des musiques populaires britanniques pendant l’entre-deux-guerres, James Nott montre que le processus d’américanisation est déjà bien enclenché dans les années 1930 avec le succès du jazz et des dance bands (Nott, 2002). Le jazz participe du déclin des brass bands après la Première Guerre mondiale, alors que ceux-ci sont progressivement éclipsés par les dance bands lors des soirées dansantes locales (Russell, 2000). La fonction dansante des brass bands, déjà peu importante avant 1914, disparaît alors progressivement, rompant un Hacking Jeff Minter’s Virtual Light Machine... Les brass bands miniers face au jazz de 1945 à la fin des années 1950 : une frontière poreuse « [Mon père] était passionné de musique et a appris le saxophone, c’était dans les années 1940 ou au début des années 1950 quand la musique des dance bands était à la mode. Il a appris le saxophone et a joué dans un groupe de 6 Entretien réalisé avec Marie Smith à Stonebroom, Derbyshire, le 19/03/18. Article Les brass bands miniers face aux « nouvelles » musiques populaires des liens primordiaux entre ce genre musical et la culture jeune. À partir des années 1920, les brass bands se concentrent alors sur les concerts, de plus en plus souvent organisés à l’intérieur, sur les défilés lors d’événements sociaux ou politiques et sur les compétitions (ibid : 86-92). Ces évolutions se poursuivent dans les années 1940 et 1950, alors que la présence de militaires américains en Grande-Bretagne pendant la guerre accroit rapidement la popularité du jazz (ibid. : 109). La concurrence croissante du jazz pour le brass band movement est bien visible dans les bassins miniers entre 1945 et la fin des années 1950, alors que les dance bands locaux se multiplient et attirent des musiciens des brass bands. C’est le cas d’une jeune cornettiste du Shirland Miners’ Welfare Band dans le Derbyshire, Marie Smith, qui devient trompettiste professionnelle au sein du groupe de jazz féminin formé par Ivy Benson, le Ivy Benson’s and Her All Girls Band puis du Dinah Dee All Girls’ Band entre la fin des années 1950 et le début des années 1960 6 . Les trajectoires inverses, quoique plus rares, existent également. Rab Wilson, ancien mineur de la région de l’Ayrshire en Écosse mentionne le cas de son père, saxophoniste d’un groupe de jazz local, « The Modernaires », dans les années 1940 et 1950 avant de rejoindre un brass band : 149 Marion Henry jazz très populaire qui s’appelait The Modernaires […] mais quand il s’est marié il a abandonné le jazz et il s’est installé ici à New Cumnock […] et s’est intéressé à la musique de brass band, il a abandonné le saxophone 7. » Si la proximité de l’instrumentation entre les brass bands et les dance bands rend possible ces va-et-vient, elle permet surtout des formes de complémentarités de ces deux pratiques musicales dans les bassins miniers. Dave Russell souligne que les musiciens des brass bands conservent souvent l’habitude de combiner leur loyauté envers leur formation musicale d’origine et des activités semi-professionnelles (Russell, 2000 : 107). Les entretiens réalisés avec des musiciens de brass bands liés à l’industrie minière montrent en effet qu’il est fréquent pour ces individus de cumuler leur appartenance au brass band local avec des performances au sein d’un dance band le week-end, généralement dans les miners’ welfare clubs. Ainsi, c’est en accompagnant tous les week-ends son oncle cornettiste jouer de la trompette dans les clubs de mineurs du Derbyshire que Marie Smith acquiert de l’expérience en tant que musicienne de dance band avant de devenir professionnelle. Plus tard, cette activité ne l’empêche pas de revenir occasionnellement jouer des solos avec le Shirland Miners’ Welfare Band lors de compétitions. Elle 150 7 « He was a keen musician and he learned saxophone and this had been like in the 1940s or in the early 1950s when dance band music and dance bands where the thing to be in. So, he learned saxophone and played in a very successful local jazz band called The Modernaires (…) but when he got married he gave up playing in a jazz band and he came here to New Cumnock and (…) he got interested in silver band music so he gave up saxophone. » Entretien réalisé avec Rab Wilson à New Cumnock, Ayrshire, le 04/12/17. Toutes les traductions sont de l’auteur. est présente en septembre 1963 lorsque son père, Jack Fawbert, qui dirige alors le brass band lors d’une compétition locale, décède sur scène. Marie abandonne ensuite sa carrière de musicienne professionnelle pour enseigner la musique aux anciens élèves de son père 8 . Cet exemple montre bien les complémentarités qui existent entre les brass bands et les dance bands et qui peuvent être mis en lumière grâce à une focalisation sur les trajectoires individuelles plutôt que sur les formations musicales. L’expérience de Marie souligne en outre le rôle encore relativement peu étudié les femmes dans dance bands professionnels et semi-professionnels (Bailey, 2013). Brass bands miniers et « pit pop » du milieu des années 1950 au milieu des années 1960 : l’impact de la culture de masse au regard du processus de désindustrialisation La fin des années 1950 et le début des années 1960 marquent une période d’accélération de la marginalisation de la musique des brass bands en Grande-Bretagne ; comme le note Arthur Taylor dans son ouvrage de synthèse : « Quand les années 1960 arrivèrent joyeusement, les brass bands se retrouvèrent souvent amputés de musiciens, en grande partie parce les municipalités et le public les trouvaient désormais démodés. Le baiser de la mort dans une décennie ou tout 8 Entretien réalisé avec Marie Smith. Article du Derbyshire Times du 20 septembre 1963, Derbyshire Record Office, Matlock. 1 9 « Now, as the 1960s swung merrily on, the bands often found themselves squeezed out, largely because they were regarded by local councils, promoters and audiences alike, as old fashioned – the kiss of death in a decade when everything had to be new. » 10 Coal News, octobre 1963, National Mining Museum Scotland (N.M.M.S.), Newtongrange, Écosse. 11 Coal News, mars 1964, N.M.M.S. 12 Coal News, ibid., N.M.M.S. Cultures ouvrières et musiques populaires en Grande-Bretagne… avant sa ressemblance avec Ringo Starr 13 . Il convient toutefois d’utiliser ces sources avec précaution. En tant que publication officielle du N.C.B., le journal cherche à donner à l’industrie minière une image moderne en mettant en avant les pratiques musicales des jeunes et le succès de ces groupes doit être relativisé. Il est ainsi intéressant d’observer que la tentative du district du Fife en Écosse de la Coal Industry Social and Welfare Organisation (C.I.S.W.O.), institution chargée du développement des loisirs dans les bassins miniers, d’organiser une compétition de groupes de beat music lors du gala de 1965 se solde par un échec 14 . Alors que la C.I.S.W.O. cherche à rendre cet événement traditionnel davantage attractif pour les jeunes, aucun groupe ne s’est porté volontaire pour participer. Il est difficile de savoir si cela est dû au manque de groupes dans la région ou à une mauvaise communication de la part de la C.I.S.W.O. mais cela nuance l’enthousiasme de Coal News sur la portée de la « pit pop ». Parallèlement à cet engouement pour les musiques liées au rock’n’roll dans les bassins miniers, les années 1960 voient les brass bands faire face à un certain nombre de difficultés. Ils ont alors peine à trouver de jeunes recrues à l’instar du Bedlington Doctor Pit Band dans le Northumberland, 13 Coal News, mars 1964, N.M.M.S. 14 Acc. 9805/186 : Collated Information, N.U.M. Scottish Area Records, National Library of Scotland, Edinburgh. Les galas sont des événements politiques et culturels traditionnels des bassins miniers marqués par un défilé des loges syndicales accompagnées des brass bands, suivi d’un meeting politique et d’activités culturelles et sportives. Le plus important est celui de Durham ou « Big Meeting » qui existe depuis 1871. Article 16 devait être nouveau » (Taylor, 1979 : 165 9). L’impact de l’arrivée du rock’n’roll sur les pratiques et goûts musicaux des régions minières britanniques est bien visible dès la fin des années 1950, comme le souligne Keith Gildart pour le cas anglais (Gildart, 2013). Si le magazine Coal, organe officiel de l’industrie minière nationalisée, ne relaie que très peu l’activité musicale qui sort du cadre perçu comme traditionnel (brass bands, chorales, sociétés d’opéra amateur et pipe bands), la donne change au début des années 1960 dans le contexte de l’explosion de la beat music. Durant l’année 1963, de nombreux articles du magazine sont consacrés à des groupes pop formés de mineurs ou de fils de mineurs. C’est le cas des « Sixteen Strings » dans la région du Tyneside 10 , ou de « The Detour » dans les Midlands de l’Est 11. L’engouement est tel que le journal crée l’expression « pit pop » (« la pop du puit ») pour nommer le phénomène 12 . Outre la musique, ces jeunes musiciens adoptent également le style vestimentaire et capillaire en vogue à l’instar de George Palmer, dessinateur industriel pour le N.C.B. dans les Midlands de l’Est et guitariste de « The Detour », dont Coal News s’amuse à mettre en 151 Marion Henry dont un membre du comité se plaint du manque d’intérêt des jeunes pour le genre musical 15 . Le succès du rock’n’roll, dont l’instrumentation est peu compatible avec celle des brass bands, et plus généralement l’attrait d’autres activités comme le sport ou la télévision peut expliquer ce manque d’intérêt pour une pratique musicale perçue comme démodée (Russell, 2000 : 109). Dave Russell souligne également le manque d’attractivité de la culture du brass band movement centrée sur la discipline (ibid. : 110). Ces évolutions culturelles et musicales affectent par ailleurs la popularité du jazz et des dance bands (ibid.). Mais les difficultés des brass bands miniers pendant cette période s’expliquent aussi par l’impact du processus de désindustrialisation sur les formations musicales alors qu’une première vague de fermetures touche principalement les bassins miniers dits « périphériques » d’Écosse, du Nord-Est et du Nord-Ouest de l’Angleterre et du Sud du Pays de Galles (Phillips, 2018 : 43). Celles-ci entraînent des transferts de main-d’œuvre vers des bassins miniers plus modernes et notamment les Midlands de l’Est. Kevin Nicholson et Stuart Fletcher, anciens mineurs et musiciens respectivement du Shirebrook Miners’ Welfare Band et du Creswell Colliery Band dans le Nottinghamshire se souviennent de l’arrivée de musiciens Écossais dans leur brass band au début des années 1960 16 . Si le succès des genres musicaux liés au rock’n’roll auprès des jeunes des bassins miniers participe fortement de l’accélération du déclin des brass bands entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 1960, il est important de mettre en regard ces bouleversement culturels avec l’impact du processus de désindustrialisation. La continuité des pratiques musicales et la coexistence des générations entre 1945 et le milieu des années 1970 Bien que la complémentarité des pratiques soit beaucoup plus rare entre les brass bands et les groupes de musique rock’n’roll, il faut souligner la continuité des goûts musicaux et des pratiques comme le souligne Andrew Goodwin dans son introduction à une réédition de La Culture du pauvre : « nous ne devons pas confondre l’émergence de nouvelles pratiques et comportements culturels avec l’éradication de ce qui existait jusqu’alors » (Hoggart, 1992 : xxi 17). Le succès du rock’n’roll à partir du milieu des années 1950 n’éclipse pas non plus complètement la demande pour les dance bands et les brass bands dans les bassins miniers, notamment grâce à la coexistence générationnelle au sein de ces communautés. Si Jim Phillips a montré l’intérêt de la notion de génération pour l’histoire minière britannique d’un point de vue social et politique (Phillips, 2019), elle est également très utile en matière de pratiques culturelles. Ainsi, la génération qui atteint l’âge adulte dans les années 1920 au moment de l’explosion des dance bands, 15 Coal News, avril 1963, N.M.M.S. 152 16 Entretien réalisé avec Kevin Nicholson à Shirebrook, Derbyshire le 21/03/18 et avec Stuart Fletcher à Clowne, Derbyshire le 23/03/18. 17 « We should not mistake the emergence of new cultural practices and attitudes for the obliteration of the old ». 1 Cultures ouvrières et musiques populaires en Grande-Bretagne… Après le jazz en début de soirée, place à la musique pop après neuf heures du soir avec la performance de son groupe puis à la musique disco 19 . Ainsi, la focalisation sur les bassins miniers permet de mettre en lumière ces lieux spécifiques, comme les miners’ welfare clubs locaux, où les genres musicaux coexistent jusqu’au milieu des années 1970. Bien que le processus de marginalisation des brass bands, continu depuis l’entre-deux-guerres, soit bien visible au sein des bassins miniers britanniques, le recours à l’histoire orale et la mise en lumière des trajectoires individuelles des musiciens montrent l’existence de continuités et de complémentarités sur le plan des pratiques. Ces complémentarités existent également en matière de répertoire alors que les brass bands miniers tentent de s’adapter aux transformations musicales de la période. « Tous les jeudi soir il y avait une soirée, je ne me souviens pas de son nom officiel mais tout le monde l’appelait “attrape une mamie”. Il y avait de la musique toute la soirée et bien sûr on commençait avec les trucs dansants pour les vieux ou pour les adultes tu vois, les plus vieux dansaient toutes sortes de danses de salon sur du jazz. C’est pour ça qu’on appelait ça “attrape une mamie” 18 ! » 18 « On Thursday night, they had a night on Thursday night em I don’t remember its official name but everybody called it “Grab a Granny” (…) So it was a full night music, and of course it started with, you know dancing for the old folks or the middle age folks, you know see these older guys and women there doing all the kind of ball room dances with the jazz band, so that was why they called it “Grab a Granny” you know ! » Entretien réalisé avec Rab Wilson. 19 Entretien réalisé avec Rab Wilson. Article 16 désormais âgée de plus de soixante ans dans les années 1960-1970, coexiste avec une génération adulte, qui a grandi dans les années 1940-1950 avec le renouveau du jazz et l’émergence du rock’n’roll et une génération plus jeune, qui vit sa jeunesse au son du rock’n’roll. Si les plus jeunes bénéficient d’espaces et de médias pour développer leur culture musicale propre (Gildart, 2013), les miners’ welfare halls, où sont souvent organisés des soirées dansantes le week-end, demeurent des points focaux des communautés minières, réunissant ces différentes générations. Ces événements donnent ainsi la possibilité aux musiciens des brass bands de continuer à se produire au sein de dance bands. Les sources montrent en effet que ces soirées voient souvent se succéder plusieurs genres musicaux en fonction de l’heure. Cela conduit soit à l’aménagement du répertoire par le groupe qui anime la soirée, soit à la succession de plusieurs groupes. Rab Wilson, musicien du New Cumnock Silver Band et d’un groupe de pop local nommé Midnight Express, relate ainsi le déroulement des soirées dansantes surnommées « Grab a Granny » (littérale ment « attrape une mamie ») organisées à d’Ayr en Écosse tous les jeudis soir dans les années 1970 : 153 Marion Henry La persistance du caractère « populaire » des brass bands dans les bassins miners britanniques La capacité d’adaptation des brass bands aux transformations culturelles 154 S’intéresser plus précisément au répertoire des brass bands, loin de constituer un ensemble homogène, permet également de montrer les circulations entre ce genre musical et la culture de masse et de souligner la capacité d’adaptation de ces formations musicales. Ce répertoire est très composite dans la deuxième moitié du XX e siècle et comprend à la fois des adaptations de morceaux de musique classique, des pièces spécialement composées pour les brass bands, des adaptations de chansons populaires, des marches d’inspiration militaire et des hymnes religieux (Russell, 2000 : 94). Il varie également en fonction du type de performance des brass bands, entre compétition d’un côté et concerts ou défilés de l’autre. Si l’évolution du répertoire des compétitions est bien étudiée et montre la montée en puissance des pièces composées spécialement pour les brass bands et la progression vers un public de plus en plus spécialisé (ibid. : 96), le cas des concerts et des défilés, événements à l’audience plus large, est moins connu. Généralement, et au moins jusqu’aux années 1950, le programme des concerts est fidèle à la structure établie par le modèle victorien : une marche suivie par une ouverture et une sélection de pièces d’opéra afin de plaire aux intérêts différents du public (ibid.). À partir des années 1950, les sources étudiées pour le cas des brass bands miniers montrent une relative ouverture de ces formations musicales aux morceaux de musique populaire contemporains. Les échanges entre les brass bands et le jazz sont notamment bien visibles sur le plan du répertoire alors que certains standards de jazz sont adaptés et interprétées par les brass bands miniers lors de concerts. Ainsi, Danny Buchanan, ancien mineur du Fife en Écosse et musicien du Cowdenbeath Silver Band, se souvient de jouer régulièrement « On the Sunny Side of the Street », suscitant ainsi l’enthousiasme du public dans les années 1960 20 . En outre, les entretiens oraux mettent en évidence la place des musiques de film dans le répertoire des brass bands. Danny Buchanan souligne également que le Cowdenbeath Silver Band jouait souvent des morceaux de La Mélodie du bonheur (1965) et de Mary Poppins (1964) dans les années 1960 21. De même, une musicienne du Shirland Miners’ Welfare Band dans le Derbyshire raconte avoir joué une adaptation de « Bohemian Rhapsody » de Queen dans les années 1970 22 . Sur le LP du Shirland Miners’ Welfare Band intitulé Music For You et enregistré en 1976, 20 Entretien réalisé avec Danny Buchanan à Perth, Tayside le 14/12/17. « On the Sunny Side of the Street » est une chanson populaire composée par Jimmy McHugh en 1930 devenue un standard de jazz. 21 Entretien réalisé avec Danny Buchanan. 22 Entretien réalisé avec une musicienne du Shirland Miners’ Welfare Band (anonyme) à Matlock, Derbyshire le 20/013/18. 1 25 « Most of the concerts that I had in the 1960s with Whitwell before I went to Creswell they all… you got to play em… you know Gilbert O’Sullivan things like that […] ‘cause people wanted it. » Entretien réalisé avec Stuart Fletcher. Gilbert O’ Sullivan est un auteurcompositeur et interprète irlandais particulièrement populaire au début des années 1970. 26 BBC Light est devenue BBC Radio 2 en 1967. L’émission « Listen to the Band ! » s’est arrêtée définitivement en mai 2018. Voir le catalogue historique des programmes de la BBC en ligne : https://genome.ch.bbc.co.uk/. 23 « Sweet Gingerbread Man » est une chanson dont la mélodie a été composée par Michel Legrand et les paroles écrites par Alan Bergman et Marilyn Bergman pour le film The Magic Garden of Stanley Sweetheart de Leonard Horn datant de 1970. Cultures ouvrières et musiques populaires en Grande-Bretagne… 24 Shirland Miners’ Welfare Band, Music For You, 1976 (source privée). exceptionnel et l’entrée de la musique de brass band dans le marché de la musique pop demeure très rare. La BBC joue toutefois un rôle important dans la diffusion de ce genre musical après 1945. Après la guerre et jusqu’au milieu des années 1950, de nombreux programmes radiophoniques sont consacrés aux brass bands. Ce dynamisme est en partie dû à l’action d’Harry Mortimer, figure éminente du brass band movement comme directeur des programmes de musique de brass et militaire entre 1942 et 1964 (Russell, 2000 : 94 ; Newsome, 2006 : 187). L’émission musicale hebdomadaire « Listen to the Band ! », diffusée à partir de 1943 sur BBC Home Service puis sur BBC Light à partir de 1958 26 , est particulièrement populaire (Newsome, 2006 : 187). À partir de 1956, des brass bands sont invités à accompagner des orchestres de la BBC et des chanteurs star pour le programme « Friday night is Music Night » (ibid. : 188). Toutefois, le nombre de programmes dédiés à ce genre musical décline à partir de la fin des années 1950. Roy Newsome compte plus de 300 émissions avec 83 brass bands en 1955 contre respectivement 230 et 67 en 1960 (ibid.) et la tendance se poursuit dans les années 1960 et 1970. Le départ d’Harry Mortimer de la BBC en 1964 porte également un coup à la présence du genre musical sur les ondes (ibid. : 192). De manière générale, il convient de souligner que cette capacité d’adaptation aux transformations technologiques est plus aisée pour les brass bands les plus prestigieux, qui bénéficient de davantage Article 16 on trouve aussi bien une adaptation de la chanson populaire « Sweet Gingerbread Man 23 » que l’ouverture du Barbier de Séville de Rossini ou encore l’hymne religieux « Belmont » datant de 1854 24 . Il s’agit alors de s’adapter à la demande du public comme le montre cette citation de Stuart Fletcher, ancien mineur et musicien du Whitwell Colliery Band et du Creswell Colliery Band dans le Nottinghamshire : « À la plupart des concerts que j’ai fait dans les années 1960 avec Whitwell avant d’aller à Creswell… il fallait jouer euh… tu vois Gilbert O’ Sullivan des choses comme ça […] parce que c’était ce que les gens voulaient 25 . » Ces tentatives d’adaptation et d’appropriation de la part des brass bands miniers sont également visibles sur le plan des pratiques après 1945, alors que ceux-ci cherchent à embrasser les innovations technologiques : enregistrements de LP, passages radiophoniques et télévisuels (Russell, 2000 : 93). Un cas emblématique est celui du Brighouse and Rastrick Band dans le Yorkshire qui atteint la seconde place des charts du Royaume-Uni en novembre 1977 avec son titre « Floral Dance » (Taylor, 1979). Cet exemple reste néanmoins 155 Marion Henry de couverture médiatique 27. Ces initiatives ne permettent par ailleurs que très rarement aux brass bands d’obtenir une audience plus large que le public spécialisé (Russell, 2000 : 94). Si ces efforts ont leurs limites, ce point permet néanmoins de souligner que les brass bands ne sont pas hermétiques à la culture de masse et qu’ils ne sont pas simplement des acteurs passifs des bouleversements culturels de la deuxième moitié du XX e siècle. Une fonction culturelle et sociale importante dans les bassins miniers La question de l’éducation musicale au sein des régions minières britanniques permet de mettre en évidence la persistance du rôle des brass bands jusqu’au début des années 1970. L’analyse des sources, et en particulier des entretiens, montre l’existence d’un solide réseau de musiciens pour l’enseignement de la musique, au cœur duquel on trouve d’abord la famille. L’apprentissage d’un instrument de brass a souvent une origine familiale dans les bassins miniers et les musiciens débutent souvent très jeunes. C’est le cas de Marie Smith, fille d’un musicien du Shirland Miners’ Welfare Band dans le Nottinghamshire qui apprend le cornet à piston à l’âge de trois ans, en 1945 et joue son premier solo lors d’une compétition à l’âge de cinq ans 28 . Pour ceux qui n’apprennent 27 Les brass bands forment un ensemble très hiérarchisé reposant sur la pratique de la compétition. Ils sont répartis en différentes sections en fonction de leur niveau, de la plus haute (championship section) à la plus basse (quatrième section). 156 28 Entretien réalisé avec Marie Smith. pas la musique dans un cadre familial, l’école joue un rôle important, en particulier à partir des années 1950 et 1960, l’institution scolaire encourage le développement des junior bands et la formation d’un vivier de jeunes musiciens, à un moment ou le brass band movement peine par ailleurs à recruter. Les créations de la National School Brass Association et du National Youth Brass Band en 1952 s’inscrivent dans cette dynamique (Russell, 2000 : 75-77). Si le rôle des écoles est important, celles-ci s’appuient généralement sur l’enseignement des musiciens des brass bands locaux, souvent bénévoles. Rab Wilson, qui apprend le cornet à piston dans les années 1960, se souvient ainsi d’Hugh Johnstone, qui a enseigné la musique à bon nombre de musiciens de brass bands juniors de l’Ayrshire en Écosse 29 . Marie Smith quant à elle, a commencé à enseigner la musique quand elle avait 21 ans en plus de son activité professionnelle et continué pendant plus de trente ans 30 . Entre ses 8 et 15 ans, elle a pu bénéficier de leçons de la part d’un musicien professionnel mais celles-ci ont un coût qui en limite l’accès et rend indispensable l’existence de ce réseau de solidarité 31. Les brass bands conservent ainsi un rôle culturel important au sein des bassins miniers britanniques, permettant aux plus jeunes de pratiquer un instrument. Outre la formation musicale, ce réseau permet aussi de fournir des instruments aux nouveaux musiciens par un système de prêt. 29 Entretien réalisé avec Rab Wilson. 30 Entretien réalisé avec Marie Smith. 31 5 shillings pour la leçon et 2,5 shillings pour le bus jusqu’à Sheffield dans le cas de Marie dans les années 1950. ments et nous avons formé un groupe. Quelqu’un est parti et […] c’est comme ça que j’ai pu avoir l’instrument que j’ai aujourd’hui. Le directeur est venu me voir et a dit “Oh tu voulais rejoindre le brass band n’est-ce pas ?” J’ai dit “oui” et il a dit “viens avec moi” et m’a donné ce tuba avec lequel je joue toujours 32 . » 16 1 Enfin, les brass bands conservent plus largement une fonction sociale importante dans les bassins miniers jusqu’au début des années 1970. Dans cette perspective, le cas des communautés minières permet de fortement nuancer l’idée d’une séparation progressive entre brass bands et vie sociale, telle qu’elle a été mise en évidence par Dave Russell (Russell, 2000 : 77). Dans les bassins miniers, les brass bands ne sont pas seulement des acteurs culturels, ils ont également une fonction sociale et politique qui est visible lors d’un certain nombre d’événements. L’exemple le plus parlant est sans doute celui des galas annuels organisés dans les différents bassins miniers et très populaires jusqu’au milieu des années 1970. Il convient toutefois 32 « I started playing at school. […] Creswell band started a junior section […] they provided instruments and we started the band. Somebody left and […] that’s when the instrument that I got came available. The headmaster came ‘round and said “Oh you wanted to join the band, didn’t you ?” I said “yes” and he said “well come with me” and he gave me this tuba and I played it ever since. » Entretien réalisé avec Stuart Fletcher. Cultures ouvrières et musiques populaires en Grande-Bretagne… « J’ai commencé à jouer à l’école […] Creswell Band avait lancé une section junior […] ils fournissaient les instru- de souligner que la popularité des galas a sans doute décliné au cours de la période et parallèlement au processus de désindustrialisation comme le note Martin Bulmer dans son analyse sociologique des communautés minières de la région de Durham à la fin des années 1970 (Bulmer, 1978 : 157). Malgré ce déclin, les brass bands continuent de jouer, et ce jusqu’à aujourd’hui, un rôle important lors de ces événements, alors que le défilé des brass bands avec les loges et les bannières syndicales demeure l’un des temps forts du gala, recréant symboliquement des communautés minières affectées par le processus désindustrialisation. Cette fonction sociale et symbolique est fondamentale pour comprendre la persistance de l’attrait pour les brass bands pendant la période comme le souligne Rab Wilson : « Je suppose que c’est quelque chose de social […] faire partie d’un groupe social établi… il y a un attrait pour cela, surtout quand tu as entre 12 et 15-16 ans […] tu veux faire partie d’une bande, d’un groupe […] et les brass bands […] recréent vraiment ça […]. Tu as l’impression de faire vraiment partie de ce groupe, de cette identité, il y a l’identité du groupe mais aussi […] l’unité sociale du groupe d’un village en particulier 33. » C’est la capacité des brass bands à recréer l’unité sociale des communautés minières qui peut expliquer la spécificité du cas des 33 « I suppose it’s a social thing, […] being part of an accepted social group … there’s an attraction to that, especially when you’re the age of say 12 and 15-16 […] you want to be part of a gang, a group […] and … that’s where bands […] are very much like that […] You feel very much part of that group that identity, there’s the identity of the band but there’s also […] the social unity of the band from a certain village ». Entretien réalisé avec Rab Wilson. Article Quand un brass band acquiert de nouveau instruments, les anciens servent souvent aux junior bands comme le souligne Stuart Fletcher pour le Creswell Colliery Band dans les années 1960 : 157 Marion Henry 158 brass bands miniers et la persistance de leur rôle politique et social, bien que principalement symbolique. A insi, le cas des bassins miniers montre que la ma rg ina lisation de la musique des brass bands en Grande Bretagne entre 1945 et le milieu des années 1970 est un processus complexe fait de complémentarités, de chevauchements et de tentatives d’adaptation. Les outils de la méthode historique, et en particulier l’utilisation des sources orales, permettent de mettre en lumière la diversité des expériences et des trajectoires individuelles. Il s’agit ainsi de ne pas considérer les brass bands comme des acteurs passifs, avalés par ces changements mais d’historiciser l’analyse afin de penser les continuités et les ajustements au même titre que les ruptures et les révolutions. L’objectif de cet ancrage dans un contexte social particulier est de montrer la complexité que recouvrent les notions de « musique populaire » et de « culture populaire » en général. Dans son compterendu de l’histoire du brass band movement au xxe s., Dave Russell explique que les brass bands ont été une victime précoce de la culture de masse parce qu’ils n’occupaient pas une position centrale au sein de la culture ouvrière (Russell, 2000 : 121). Il compare cette position à celle d’autres institutions qu’il ne mentionne cependant pas. Pense-t-il aux syndicats ou aux partis politiques ? Nous dirons au contraire que les brass bands jouent un rôle éminemment social et politique et qu’il est important de continuer à faire dialoguer l’étude des musiques populaires avec l’histoire sociale. Bailey Jenna (2013), « Lady be good » : an exploration of women making music in the Ivy Benson Band 1940 – c. 1985, Thèse de doctorat, University of Sussex. Buch Esteban, Donin Nicolas & Feneyrou Laurent (eds.) (2013), Du Politique en analyse musicale, Paris, Vrin. Bulmer Martin (1978), Mining and Social Change : Durham County in the Twentieth Century, Londres, Croom Helm. 16 1 Cambon Jérôme (2011), Les Trompettes de la République. Harmonies et fanfares en Anjou sous la Troisième République, Rennes, PUR. Campbell Alan, Fishman Nina & Howell David (1996), Miners, Unions and Politics 1910-1947, Aldershot, Scholar Press. Fontaine Marion (2017a), « Introduction », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 1, no 35, p. 9-17. — (2017b), « Une Quête sans cesse renouvelée. Culture ouvrière et politique au prisme de Richard Hoggart », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 1, no 35, p. 159-182. Fowler David (2008), Youth Culture in Modern Britain, c. 1920-1970, Londres, Palgrave Macmillan. Franckenberg Ronald (1957), Village on the Border : A Social Study of Religion, Politics and Football in a North Wales Community, Londres, Cohen & West. Frith Simon, Brennan Matt, Cloonan Martin & Webster Emma (2013), The History of Live Music in Britain, Volume I : 1950-1967 : From Dance Hamm to the 100 Club, Farnham, Ashgate. Campos Rémy, Donin Nicolas & Keck Frédéric (2006), « Musique, musicologie, sciences humaines : sociabilités intellectuelles, engagements esthétiques et malentendus disciplinaires (18701970) », Revue d’Histoire des sciences humaines, vol. 1, no 14, p. 3-17. — (2019), The History of Live Music in Britain, Volume II : 1968-1984 : From Hyde Park to the Hacienda, Londres, Routeledge. Dennis Norman, Henriques Fernando & Slaughter Clifford (1956), Coal is our Life : An Analysis of a Yorkshire Mining Community, Londres, Tavistock Publications. Grignon Claude & Passeron Jean-Claude (1989), Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Gallimard. Etheridge Stephen (2014), « Slate-Grey Rain and Polished Euphoniums » : Southern Pennine Brass Bands, the Working-Class and the North, c. 1840-1914, PhD thesis, University of Huddersfield. Gumplowicz Philippe (1987), Les Travaux d’Orphée : 150 ans de vie musicale amateur en France : harmonies, chorales, fanfares, Aubier. Gildart Keith (2013), Images of England through Popular Music. Class, Youth and Rock‘n’roll, 19551976, Londres, Palgrave Macmillan. — (2017), « De l’orphéon au jazz. Une métamorphose de classe (XIXe-XXe s.) », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, vol. 1, no 35, p. 103-116. Henry Marion (2018), « Les usages politiques et formes de politisation des cultures minières britanniques (1945 – début des années 1960) : le cas des brass bands », Cahiers Jaurès, vol. 4, no 230, p. 91-107. Herbert Trevor (1991), Bands : The Brass Band Movement in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Manchester, Open University Press. — (2000), The British Brass Band : A Musical and Social History, Oxford, Oxford University Press. Hoggart Richard (1992) [1957], The Uses of Literacy : Aspects of Working-Class Life with Special Reference to Publications and Entertainments, N. Brunswick, Transaction Publishers. Cultures ouvrières et musiques populaires en Grande-Bretagne… Arnot Robert (1949), The Miners : A History of the Miners’ Federation of Great Britain 1889-1910, Londres, Allen & Unwin. Faulk Barry (2010), British Rock Modernism, 1967-1977, The Study of Music Hall in Rock, Farnham, Ashgate. Jackson Brian (1968), Working Class Community : Some general notions raised by a series of studies in Northern England, Londres, Routledge. Martino Laurent (2016), Sous le signe de la lyre : les ensembles à vent en Europe, Thèse de doctorat en histoire sous la direction de Didier Francfort, Université de Lorraine. Marwick Arthur (1998), The Sixties : Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United Sates, c. 1958-c.1974, Oxford, Oxford University Press. Nott James (2002), Music for the People. Popular Music in Interwar Britain, Oxford, Oxford University Press. Phillips Jim (2019), Scottish Coal Miners in the Twentieth Century, Article Bibliographie 159 Marion Henry Édimbourg, Edinburgh University Press. — (2018), « The Meanings of Coal Community in Britain since 1947 », Contemporary British History, vol. 32, no 1, p. 39-59. Russell Dave (1993), « The “Social History” of Popular Music : A Label Without a Cause ? », Popular Music, vol. 12, no 2. — (2000), « “What’s Wrong with Brass Bands ?” : Cultural Change 160 and the Band Movement, 1918c.1964 », in Herbert (ed.), The British Brass Band. A Social History, Oxford, Oxford University Press, p. 68-121. Savage John (2008), Teenage : The Creation of Youth, 1875-1945, Londres, Pimlico. Sterne Jonathan (2012), The Sound Studies Reader, New York, Routeledge. Taylor Arthur (1979), Brass Bands, Hart-Davis MacGibbon. — (1983), Labour and Love : An Oral History of the Brass Band Movement, Londres, Elm Tree Books. Colloque ACEMUP, 4 e édition, 12 avril 2019 Colloque ACEMUP, 4e édition, 12 avril 2019 Par Eva Nicolas 16 1 Permettre aux étudiants de présenter leurs travaux dans un cadre encourageant les échanges interdisciplinaires avec des pairs et des chercheurs expérimentés, tel était l’objectif de cette 4e édition du colloque étudiant consacré aux musiques populaires organisé par l’ACEMUP le 12 avril 2019. Visant également à favoriser les liens entre sphères académique et professionnelle, la journée d’étude s’est déroulée au sein du FGO-Barbara, un établissement dédié à la pratique et à la diffusion musicale à Paris. La première session du colloque a été consacrée à appréhender les musiques populaires au prisme du genre. La présentation d’une étude de cas sur la fabrication des clips de rue dans le rap de Baton Rouge aux États-Unis a ouvert la discussion autour de cette thématique. Analysant le rôle à la fois marginal et central des femmes, Guillaume Echelard a montré en quoi le tournage de clips est un moment où les rapports de genre sont performés et négociés. Étudiant la scène féminine, féministe et queer dans le rap en France, Tiffanie Marsaud a étendu la réflexion en s’intéressant à la question de l’auto-définition des artistes féminines face aux constructions sexistes du rap. La présentation de son travail a permis de mieux comprendre en quoi les traditions de contestation dans le hip-hop ouvrent un espace propice aux revendications des artistes féminines. Dans une troisième communication, Laure-Hélène Swinnen a abordé la problématique des genres au travers des images de la femme dans le reggae véhiculées par les médias et la façon dont les publics féminins s’approprient cette image. La question de la circulation des musiques au sein de différents espaces a ensuite été au cœur de la deuxième session de cette journée. S’intéressant aux artistes de rap algériens travaillant en France, Yacine Khiar a apporté des éléments de compréhension sur les processus de création d’artistes en migration. À travers le cas du rappeur Youss dont le studio d’enregistrement se trouve au sein de son appartement à Paris, Compte rendu Compte rendu 161 Eva Nicolas 162 il a mis en lumière la manière dont l’espace de création interfère avec le processus de production musicale. L’appartement de Youss, fonctionnant comme un lieu de vie à l’image du « quartier » défini au sens algérien, impacte sa création en maintenant les liens, avec un certain aspect nostalgique, entre l’artiste et la culture de son territoire d’origine. Selon une approche musicologique, Sébastien Lebray a également constaté l’influence des espaces investis par les artistes sur leur travail de création. Il y a adjoint la notion d’espace partagé par plusieurs artistes comme facteur d’influence sur la production d’une esthétique musicale commune. Son analyse lui permet d’éclairer la problématique de son travail portant sur la désignation d’un style musical par son origine géographique, et plus spécifiquement sur le cas de la French Touch, en relevant des spécificités esthétiques musicales liées aux aires géographiques fréquentées par des réseaux d’artistes qui leur sont propres. La notion de territoire a ensuite été abordée par Coline Calix dans sa dimension d’espace construit et façonné par des dispositifs performatifs constitutifs d’un événement festif au rayonnement régional. Ainsi, le concours, le défilé et les fêtes du festival El Porro Pelayero en Colombie ont été analysés de manière à rendre compte de la façon dont les festivaliers vivent les pratiques musicales, habitent et s’approprient le territoire, et dont le festival permet de construire une identité musicale fédératrice. La session s’est terminée par l’intervention de Claire Fraysse qui, dans une analyse musicologique précise et technique, nous a expliqué la manière dont la chanson « You Can Call Me Al » de Paul Simon peut être considérée comme étant à l’origine de l’émergence d’une « musique-monde ». En incorporant des sonorités étrangères au public occidental de 1986 à un style musical pop, l’artiste participe à l’invention de ce qui peut être qualifié de World Music. La journée s’est terminée par une troisième session dédiée à la réception et à l’appropriation de la musique selon différentes dimensions. Une approche historique a d’abord été présentée par Manuel Boquier dont le travail porte sur la réception de la old-time music aux États-Unis pendant l’entre-deux-guerres. L’analyse d’un corpus de lettres d’auditeurs envoyées aux artistes Bradley Kincaid et John Dair dont les musiques étaient diffusées à la radio a permis de mieux caractériser le public de ces musiques et de comprendre la perception de celles-ci par ceux qui l’écoutaient. La seconde intervention consistait en une étude musicologique des textes de chansons folk américaines et britanniques de la seconde moitié des années 1960. Dans ses travaux, Marion Brachet cherche à comprendre les enjeux des récits et leur évolution avec l’arrivée et le développement du rock. Sa présentation a notamment mis en avant deux types de récit, l’un à caractère littéraire et poétique, ayant une portée relevant de l’intime, l’autre à caractère politique et militant, ayant une portée collective. Le croisement entre ces deux types de récit est alors à questionner. La notion de croisement, d’hybridité, se retrouve également au sein du travail de Victor Dermenghem qui s’interroge sur les liens et ruptures entre la notion de goût et de pouvoir en prenant le cas de la deconstructed music. Les artistes de ce style de musique électronique dont la diffusion se fait essentiellement par Internet cultivent une certaine pratique de l’hybridité entre musiques underground et mainstream. 1 Colloque ACEMUP, 4 e édition, 12 avril 2019 questionner le sens du terme « popular ». Cette mise en regard avec la recherche anglophone a été l’occasion de revenir sur la polysémie du terme « populaire » en France. Contrairement à l’acception anglaise qui peut renvoyer aussi bien à la chanson comme objet d’étude interdisciplinaire, comme produit phonographique et commercial, comme pratique esthétique ou encore comme discours social et politique, la définition de cette expression est encore floue pour les chercheurs français. La notion d’identité nationale portée par l’idéologie républicaine et le regard curieux et méprisant posé par les gens de lettres sur les pratiques du peuple par le passé auraient participé à la difficulté d’appréhender aujourd’hui la notion de « populaire » de façon claire et unifiée. Présentant une partie de ses travaux concernant la production et la réception des chansons disco de Dalida, Barbara Lebrun a ensuite questionné la différence de valeur accordée à la « chanson à texte » et à la « variété » au prisme de cette approche plurivoque de la « musique populaire ». Compte rendu 16 Comme proposé par l’ACEMUP depuis la première édition du colloque, les communications étudiantes ont été enrichies par l’intervention d’un chercheur confirmé. Pour cette 4 e édition, Barbara Lebrun (Maître de conférence au département de civilisation française et francophone de l’Université de Manchester) a été invitée à présenter son approche théorique et méthodologique de l’objet « musique populaire ». Ses recherches menées dans le cadre anglophone permettent de comprendre le regard posé par les chercheurs britanniques sur la façon dont les Français conceptualisent la « culture populaire ». L’expression « popular music » est utilisée de façon consensuelle dans le monde anglophone et fait référence à une conceptualisation qui reconnait et valide, dans une certaine mesure, toutes les pratiques culturelles, qu’elles soient issues ou non de moyens de production et de diffusion passant par l’industrialisation, par des ventes en masse, etc. Pour autant, Barbara Lebrun précise que cet aspect consensuel n’empêche pas les chercheurs britanniques de continuer à 163 À propos de l’ouvrage Made in France, Studies in Popular Music Tribune 1 Par Denis-Constant Martin (Les Afriques dans le monde, Sciences Po Bordeaux) Destinée en priorité à un lectorat anglophone, cette collection d’essais rassemblés par Gérôme Guibert, maître de conférences en sociologie à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris III (UFR Arts & Médias, département ICM) et Catherine Rudent, maître de conférences HDR à Paris IV Sorbonne (UFR de musique et musicologie), captivera au moins autant les francophones qui s’intéressent aux musiques qualifiées de « populaires 1 ». Les deux directeurs ont été, depuis les années 1990-2000, les chevilles ouvrières des recherches françaises en ce domaine : le premier est notamment l’un des fondateurs de Volume ! La revue des musiques populaires 2 qui est devenue le forum indispensable de diffusion des travaux et des débats portant sur les innombrables aspects de ce champ ; la seconde est, outre ses fonctions d’enseignante-chercheuse, membre fondatrice de la branche francophone d’Europe de 1 Il constitue un contrepoint et une mise à jour d’un volume rédigé en presque totalité par des anglophones, publié quinze ans auparavant : Dauncey & Cannon (2003). 2 Voir : https://journals.openedition.org/volume/ (consulté le 30 octobre 2018). Tribune 16 À propos de l’ouvrage Made in France, Studies in Popular Music Sous la direction de Gérôme Guibert et Catherine Rudent, Abingdon & New York, Routledge, 2018, coll. « Routledge Global Popular Music Series » 165 Denis-Constant Martin l’IASPM (The International Association for the Study of Popular Music 3) et responsable du Centre de recherches sur les musiques populaires dans le cadre de l’IReMus (Institut de recherche en Musicologie) ; ils cumulaient donc des compétences et des réseaux permettant de réunir un certain nombre de celles et ceux qui étudient ces objets et de sélectionner quelques-uns des thèmes qui sont aujourd’hui en discussion. De fait, cet ouvrage 4 se révèle intéressant à, au moins, un double titre : d’une part, il présente un panorama des musiques « populaires » françaises et analyse leurs évolutions depuis le début des années 1960 ; de l’autre, il retrace l’histoire des recherches sur les musiques populaires en France et met en lumière les approches qui y ont dominé, les thèmes les plus fréquemment abordés. De ce fait, il ne manque pas de soulever plusieurs questions d’analyse. L’ouvrage est organisé en quatre parties, introduites et mises en perspective par Gérôme Guibert et Catherine Rudent 5 , qui abordent : les mutations de la musique populaire française durant les « trente glorieuses » ; la politisation de la musique populaire ; la spécificité française nourrie d’assimilations et d’appropriations ; 3 Dont le premier colloque, en 2007, s’interrogeait sur l’existence d’une « exception francophone » dans les études sur les musiques populaires, interrogation renouvelée dans le présent ouvrage ; voir : Looseley (2006). 4 Qui prolonge et complète le dossier « French Popular Music, Actes du Colloque de Manchester », Volume ! La revue des musiques populaires, no 2-2, 2003. 166 5 Chaque chapitre est suivi d’une bibliographie propre et le volume propose également une bibliographie sélective à la fin. les thèmes actuels de la sociologie française des musiques populaires, des enjeux numériques à la notion de patrimoine culturel. Sans reprendre strictement ce découpage, je voudrais regrouper les apports de ce volume sous quatre rubriques : l’histoire des musiques populaires en France depuis le début des années 1960 ; le développement des études sur les musiques populaires en France ; les thèmes de recherche qui y ont été privilégiés et les pistes analytiques qui s’en dégagent. Made in France présente pour l’essentiel des musiques qui sont apparues en France à partir des années 1960, succession de genres dans laquelle les mélanges et les tuilages furent intenses : la chanson française, le yé-yé, le rock (y compris le heavy metal et le punk), le free jazz (un peu décalé par rapport aux autres genres ici traités) et les musiques électroniques. Dans cet enchaînement, le yé-yé représente un tournant parce que, derrière la réplication puis l’adaptation de modes étrangères (pop anglaise, rock étatsunien), il exprime en France « une mutation culturelle profonde » (Matthieu Saladin : 23), résultant, selon Edgar Morin 6 , à qui renvoie Florence Tamagne (39), d’une prise de conscience par les jeunes de l’appartenance à une classe d’âge dotée d’un pouvoir économique. Cette mutation marque au début une fracture de classe opposant les amateurs de « variété française » (collégiens issus de la classe ouvrière) aux adeptes du yé-yé et du rock anglo-étatsunien (lycéens, étudiants venant des classes moyennes et de la bourgeoisie) (Gérôme Guibert : 7), à qui 6 Edgar Morin, « On ne connaît pas la chanson », Communications, 6, 1965 : 1-9 et « Salut les copains », Le Monde, 6 et 7 juillet 1963, reproduits dans Morin (1994). 1 7 Pour illustrer cette assertion, l’auteur cite p. 30 la conclusion de la reprise en français du « What’d I say ? » de Ray Charles (« Est-ce ce que tu le sais ? ») par Sylvie Vartan : « Que faut-il faire dans la vie pour dénicher un gentil mari ? ». 8 Voir : https://www.persee.fr/collection/vibra (consulté le 30 octobre 2018). À propos de l’ouvrage Made in France, Studies in Popular Music anglophones. Dans son introduction, Gérôme Guibert rappelle la difficile émergence de l’étude des musiques populaires au sein des universités françaises. Les premiers travaux s’intéressèrent surtout aux paroles des chansons (Calvet, Brunschwig & Klein, 1972) ; ensuite, au milieu des années 1970, Antoine Hennion commença, au Centre de sociologie de l’innovation de l’École des mines à Paris (et non dans un département universitaire), à étudier l’économie du disque (Hennion, 1975 ; Hennion & Vignolle, 1978), avant de jeter les bases d’une « musicologie du social » (Hennion, 1982) et de s’intéresser aux amateurs et à leurs goûts (Hennion, 1999). En 1985, il participa au lancement de la première revue française à comité de lecture consacrée à l’étude scientifique des musiques populaires : Vibrations 8 qui ne publia que sept numéros de 1985 à 1991 mais préfigura Volume ! où, à partir de 2002, se manifesta la diversité des thèmes et des approches caractérisant les travaux français sur les musiques populaires. Des enseignements spécialisés furent ensuite proposés dans les universités de Paris IV et Paris X (Anne-Marie Green qui publia également des études pionnières [Green, 1986, 1993, 1997 et 1998]), de Bourgogne (Philippe Gumplowicz) et de Paris I (Séminaire « Histoire et théorie des chansons », dirigé par Christian Marcadet) et de Paris VIIISaint Denis (Denis-Constant Martin), permettant à des étudiants de rédiger des mémoires et des thèses dont le nombre s’est considérablement accru au X XI e s. Malgré cette dynamique, il n’en reste pas moins que, Tribune 16 sont proposés de nouveaux « modèles » incarnant des valeurs anciennes (Matthieu Saladin : 30 7). Le rock, au contraire, est interprété dans les milieux conservateurs comme la manifestation chez les jeunes de comportements pathologiques et la presse construit, pour en souligner la dangerosité, un triptyque blousons noirs – délinquance juvénile – rock‘n’roll (Florence Tamagne : 35). Pourtant, l’industrie du disque assure la diffusion du rock par les microsillons (45t singles, 33t 30cm) comme elle avait fait la promotion des « yé-yés » (Marc Kaiser : 27-69) et, par la suite, ces oppositions s’estomperont ; les différences entre chanson, yé-yé et rock français s’amenuiseront, Serge Gainsbourg faisant lien entre ces genres (Gérôme Guibert : 7 ; Olivier Julien : 47-56), avant qu’au débouché du punk n’apparaissent des groupes puisant à toutes ces sources comme Pigalle ou Noir Désir. Le « tournant yé-yé », les incompréhensions suscitées par l’engouement pour les nouvelles idoles et les rugosités du rock firent sentir la nécessité d’étudier ces innovations musicales comme des phénomènes sociaux. Pourtant, il fallut attendre plusieurs années avant que les textes d’Edgar Morin ne soient suivis d’études rigoureuses et systématiques formant progressivement un corpus d’études de sociologie des musiques populaires, puis avant que ces recherches n’acquièrent une légitimité dans l’enseignement supérieur, en décalage sensible avec ce qui s’était produit dans les mondes 167 Denis-Constant Martin comme le constate dans sa « coda » David Looseley (professeur émérite à l’université de Leeds) : « Des décennies après l’émergence des études sur les musiques populaires dans le monde anglophone, les sociologues, musicologues et historiens qui figurent dans Made in France apparaissent encore comme des pionniers dans l’université française, bien que les changements soient aujourd’hui rapides [...] Pourtant, il existe encore, dans une certaine mesure, une sorte d’“exception culturelle française”, aussi typique que la musique elle-même, en ce qui concerne le type de questions qu’ils posent. » (239) Gérôme Guibert 9 le souligne, la production (au sens socio-économique) de la musique fut un des premiers thèmes abordés par les Français et continue d’occuper une place importante dans leurs travaux. À une époque où la diffusion de la musique était pour l’essentiel assurée par le disque microsillon et les radios qui les mettaient en ondes, l’industrie phonographique joua un rôle déterminant dans la formation et la propagation de nouvelles modes : le yé-yé et le rock, aussi bien par l’importation d’enregistrements anglais et étatsuniens que par la promotion des créations françaises qui s’en inspirèrent (Gérôme Guibert & Catherine Rudent, préambule à la troisième partie). Les grandes firmes finirent toujours par prendre en charge les innovations, après qu’elles ont démontré leur potentiel commercial, souvent en tissant des liens avec les producteurs indépendants. Les créateurs français firent le plus souvent preuve d’ambivalence dans leurs rapports avec les compagnies phonographiques : soucieux 168 9 Qui signa une somme sur ce sujet : Guibert (2006). d’affirmer leur indépendance (même au temps du yé-yé [Marc Kaiser : 63]), désireux de rester maîtres de leurs choix esthétiques, dispersés en de multiples scènes locales (Fabien Hein : 173-184) et enregistrant pour de petits labels indépendants, ils finirent fréquemment par tomber dans les rets de la grande industrie, constituant ainsi des « oligopoles à franges » (Guibert, 2006 : 11). Les possibilités nouvelles offertes par l’internet bouleversèrent, jusqu’à un certain point, ces arrangements et permirent à des musiciens, disposant plus facilement de home studios grâce aux nouvelles technologies, de contrôler complètement la chaîne de production : de l’enregistrement à la diffusion, en passant par le mixage et, éventuellement, la mise en images vidéos (Gérôme Guibert & Catherine Rudent, préambule à la quatrième partie). L’Internet constitue désormais une sorte de vitrine dans laquelle les musiciens peuvent placer leurs productions, les vendre directement et annoncer leurs concerts, source parfois principale de leurs revenus. La mise sur la toile de musique soulève évidemment des questions de propriété artistique que tendent à ignorer les adeptes du téléchargement et des échanges de pair à pair ( peer to peer, P2P). Pour combattre des pratiques jugées néfastes aux artistes, les autorités françaises ont adopté une loi dite HADOPI 10 (Sylvain Dejean & Raphaël Suire : 217) visant à réprimer les abus. Toutefois, compte tenu d’une attitude répandue chez les geeks de tolérance aux pratiques illégales et de leur maîtrise de techniques d’évitement des contrôles, 10 Instituant une Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. 1 À propos de l’ouvrage Made in France, Studies in Popular Music lui, de soutenir la chanson, le rock, le jazz regroupés artificiellement en « musiques actuelles 11 » (Gérôme Guibert : 11-12). Il mit en œuvre des mesures de « développement culturel » inspirées par les travaux du Service des études et recherches du ministère, entrepris sous ses prédécesseurs 12 . Si les moyens fluctuèrent au gré des gouvernements et des contraintes budgétaires qu’ils imposaient dans ce domaine, les musiques populaires y gagnèrent une légitimité qui entraîna leur intégration dans toutes sortes de programmes et d’actions (dont le rap, par exemple, bénéficia [Faure & Garcia, 2005]). Néanmoins, chez les artistes, notamment les jeunes, la crainte de la dépendance et de la « récupération » suscita des ambivalences que Fabien Hein résume à propos du punk mais qui paraissent tout aussi répandues dans d’autres genres : « En fait, il semble que la scène française du punk rock hésite en permanence entre la subversion et les subventions. » (179) La recherche des significations sociales de la musique, qu’elle soit entreprise du côté de ses mécanismes de production et de diffusion ou de celui de ses processus créatifs et de la réception de ses œuvres, traverse l’ensemble des chapitres de Made in France ; des approches analytiques diverses y sont employées. Les plus classiques, mais non les moins fécondes, combinent, comme le fait Gérôme Guibert dans son étude d’un groupe de heavy metal (89-103), le récit 11 Sur l’hétérogénéité des musiques coiffées par cette appellation et la méconnaissance des goûts du public « jeune » ciblé par ces politiques, voir : Le Guern (2007). Tribune 16 l’HADOPI n’a pas eu de grands effets et a, tout au plus, incité les amateurs à écouter en streaming ou à échanger des fichiers copiés sur clef USB par des internautes plus audacieux (Sylvain Dejean & Raphaël Suire : 217-228). L’internet n’a pourtant pas annihilé l’industrie du disque, que la vogue nostalgique des vinyles a également un peu relancée : le système d’« oligopole à franges » fonctionne encore et les nouveaux genres de musiques électroniques illustrent l’entremêlement de réseaux horizontaux tissés sur l’internet et des moyens de diffusion traditionnels de la musique, le disque notamment, fournissant aux majors un accès à un public très jeune qui, en quête de célébrité, s’ébaudit de cette mise en lumière (Anne Petiau : 203-215). Ainsi, l’histoire de ces cinquante dernières années montre que les tentatives des artistes pour s’émanciper de la tutelle des grandes firmes phonographiques n’ont pas abouti à les éliminer mais que celles-ci sont parvenues à établir des synergies avec les producteurs indépendants pour retrouver une place centrale comme acteurs de la production et de la diffusion musicale. Les musiques populaires ont pendant longtemps été ignorées, voire méprisées, par les autorités publiques, à l’exception de quelques initiatives de collectivités territoriales. André Malraux, premier titulaire du ministère de la Culture créé en 1959, lança le projet des Maisons de la culture, dont la première ouvrit ses portes au Havre en 1961. Leur programmation fit quelquefois place à des musiques non savantes mais, dans l’ensemble, jusqu’en 1981, la politique publique nationale de la culture s’intéressa surtout aux arts « légitimes ». Jack Lang, à qui François Mitterrand confia ce portefeuille, entreprit, 12 Notamment d’un rapport présenté en 1973 par Michel de Certeau ; voir : Teillet (1993). 169 Denis-Constant Martin historique (notamment les rapports avec l’industrie du disque), l’analyse des discours (paroles des chansons, propos tenus par les musiciens) et les réactions des auditeurs ; méthodes auxquelles s’ajoute naturellement l’ethnographie d’une scène 13 (Fabien Hein : 173-184). L’écoute musicale et son histoire constituent, pour Jedediah Sklower (77-87), un nouvel horizon des études musicales en France 14 . La manière dont les mélomanes s’approprient ce qui leur est proposé par des « dispositifs musicaux 15 » constitue une « expérience de la musique » dont l’analyse construit des données sur les représentations associées à la musique, les perceptions de l’objet écouté, voire les choix de carrière des musiciens. Les études qui se focalisent sur la réception font évidemment partie intégrante de toute tentative pour appréhender les manières dont les musiques sont perçues et comprises par les auditeurs ; elles favorisent aussi une connaissance plus fine des publics qui permet de contrebattre certains clichés. Ainsi, Stéphanie Molinero constate que, loin d’être cantonné aux banlieues, « le rap a été adopté à de multiples niveaux de la société, des plus “instruits” aux plus “populaires” : il a touché, sous des formes variées et de diverses manières, la totalité de la population française » (161) ; il a pénétré les zones rurales et n’est plus aujourd’hui uniquement une musique de jeunes. À cette révision de l’image des amateurs de rap Christian 13 Sur la notion de scène, voir : Guibert & Bellavance (2014). 14 Sur ce sujet, voir : Pecqueux & Roueff (2009). 170 15 Notion empruntée à Michel Foucault et utilisée notamment dans : Grenier (2006) et Hennion & Grenier (2000). Béthune (163-171) suggère que doit s’ajouter une reconsidération de la créativité linguistique des rappeurs. Nombre d’entre eux sont en effet capables de manipuler différents codes linguistiques de manière inventive : ils mêlent l’héritage du français classique et les dialectes urbains, jouent de divers procédés d’assonance et leurs transgressions révèlent fréquemment des formes littéraires complexes 16 : ils mettent, comme Victor Hugo, « un bonnet rouge au vieux dictionnaire 17 ». Les représentations des musiciens, comme George Brassens, peuvent devenir l’enjeu de compétitions entre des politiques de patrimonialisation et des processus mémoriels non institutionnels, peignant du même créateur des images contrastées, sinon contradictoires (Juliette Dalbavie : 194-202). Elles 16 Il semble cependant ne prendre en compte qu’une certaine partie de la production rap et passe sous silence des jeunes qui emploient un langage différemment élaboré, comme Biffty, voir : « Roule un boze [Remix Dj Weedim] », https://www.youtube. com/watch?v=6idy7JSPDVg), Vald (« Strip [Part.1] », https://www.youtube.com/watch?v=g1JYvI-RbD4; consultés le 31 octobre 2018), sans oublier Jean Janin, alias Cézaire, qui lança du perron de l’Elysée (mais en anglais !), ces paroles particulièrement poétiques : « Les femmes et la beuh strictement verte, ne t’assieds pas salope s’il te plaît, t’es vénère parce que je me suis fait sucer la bite et lécher les boules. » Céline, « Fête de la musique à l’Élysée : Emmanuel Macron indigne la “fachosphère” », AgoraVox TV, 23 juin 2018 (https://www.agoravox. tv/actualites/societe/article/fete-de-la-musique-al-elysee-77484; consulté le 2 novembre 2018). Pour mieux entendre ces textes, il faudrait sans doute en revenir aux développements de Mikhail Bakhtine sur le « grotesque » et le « bas » (Bakhtine, 1970). 17 « Et sur l’Académie, aïeule et douairière, / Cachant sous ses jupons les tropes effarés, / Et sur les bataillons d’alexandrins carrés, / Je fis souffler un vent révolutionnaire. / Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. » « Réponse à un acte d’accusation », Les Contemplations, Livre premier VII, 1834. 1 18 Il est regrettable que Barbara Lebrun, qui enseigne à Manchester, s’appuie surtout sur Stuart Hall pour ce qui est de l’analyse des phénomènes identitaires et ignore les débats français sur ce sujet, comme elle néglige les travaux d’Armelle Gaulier sur Zebda et Magyd Cherfi (Gaulier, 2014 et 2015). 19 C’est ce pour quoi, par exemple, a été inventée l’étiquette « world music ». 20 Catherine Rudent renvoie ici à Tagg (1989). À propos de l’ouvrage Made in France, Studies in Popular Music « chanson française » que la catégorisation apparaît comme particulièrement problématique. Inventée vers 1963, cette appellation servit d’abord à tracer une frontière entre « chanson de variété » et « chanson à texte », soulignant la supériorité artistique de cette dernière ; pourtant, elle ne circonscrivit jamais un ensemble homogène de productions, ni sur le plan musical, ni sur le plan textuel, et devint encore plus imprécise lorsque une « nouvelle chanson française » se mit à faire un usage immodéré de l’anglais (Cécile Prévost-Thomas : 125-135). En fait, conclut Catherine Rudent, la « chanson française » est caractérisée par son hétérogénéité et son instabilité ; elle « n’est pas définie musicalement. Elle est plutôt une collection de singularités, avec ses vedettes, ses lieux évocateurs et ses mots-clefs, que ne relie aucun fil rouge » (148). Cette étiquette prend son sens uniquement « par opposition à la musique populaire anglo-étatsunienne » (David Looseley : 242), le protéen Serge Gainsbourg illustrant les innombrables passages entre genres divers susceptibles d’être, à un moment ou à un autre, assimilés à de la « chanson française » (Olivier Julien : 47-56). La même mise en question pourrait être appliquée à « musique populaire ». Cécile Prévost-Thomas le remarque à l’orée de son chapitre sur la « chanson française », selon les époques elle a signifié musique du peuple ou des travailleurs ; pop music, au sens anglais ; musique goûtée par une majorité d’auditeurs et diffusée par les grands moyens de communication (125). Ce sont, encore une fois, la variabilité historique des significations de cette étiquette et son inconstance musicale qui la caractérisent et invitent, selon Charles Hamm, les analystes à partir non d’une définition a priori, mais de sa diversité et de la Tribune 16 peuvent parfois être également le résultat d’une forme de dialectique entre la configuration identitaire élaborée par les musiciens et les attentes de leurs auditeurs. Ainsi Rachid Taha et Magyd Cherfi ont, selon Barbara Lebrun, « ethnicisé leurs performances » (110) en y intégrant des sons et des instruments du Maghreb pour exprimer leur appartenance à la « communauté beur » et se distinguer de la « majorité blanche » (109 18). L’analyse des représentations sociales des musiques et des musiciens ouvre sur le problème de la définition des genres et de leur catégorisation, tant les étiquettes jouent un rôle central dans le fonctionnement des musiques populaires (Catherine Rudent : 137). Ces processus de catégorisation répondent à divers buts : regrouper des œuvres différentes facilite leur promotion et leur commercialisation 19 mais, dans la mesure où ces catégories et les noms qui leur sont donnés ne correspondent pas nécessairement à des pratiques et des caractéristiques musicales identiques 20 , leur fonction est surtout symbolique (Catherine Rudent : 138). La « musique légère » actuelle, par exemple, ce que les anglophones ont baptisé easy listening, recouvre un ensemble de productions extrêmement varié qui a pour but d’accompagner des activités (d’achat en particulier) ou des périodes d’attente (Vincent Rouzé : 228-237). Mais c’est à propos de la 171 Denis-Constant Martin 172 non-étanchéité de ses frontières internes, donc à déterminer pour chaque étude de cas le type de « musique populaire » auquel appartient l’objet étudié (Hamm, 1995). C’est bien à cette recommandation qu’ont obéi les auteurs de Made In France. Ce remarquable ensemble de textes n’épuise évidemment pas le sujet de ce qui a pu être saisi comme « musique populaire » en France durant les cinquante dernières années, ni des théories et méthodes susceptibles d’en rendre compte. Au nombre des particularités composant l’« exception culturelle » qui, selon David Looseley, observateur attentif de la vie musicale dans l’hexagone, distingue les études françaises des anglophones, il convient d’ajouter la négligence des apports potentiels de la musicologie et de l’ethnomusicologie à la sociologie des musiques populaires. Il est frappant, de ce point de vue, que, des « pionniers » ayant contribué à ce volume, une seule, si l’on en croit les résumés biographiques présentés pages xii à xv, Catherine Rudent, est musicienne et musicologue 21 ; les autres sont philosophe, spécialiste des sciences de l’information ou des « études culturelles », économiste, sociologue et historien. En conséquence, les efforts pour analyser les significations sociales des phénomènes musicaux laissent dans l’ombre une partie essentielle de ce qui les constitue : la musique elle-même et ses dimensions symboliques dont la prise en compte est nécessaire à la compréhension des mécanismes 21 Elle a présenté un mémoire intitulé « L’analyse musicale des chansons populaires phonographiques » lors de sa soutenance d’habilitation à diriger des recherches, le 28 juin 2010 (voir : https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel01773326/document, consulté le 30 octobre 2018). construisant les représentations sociales qui lui sont associées, tout particulièrement en ce qui concerne les configurations identitaires. Catherine Rudent avait elle-même souligné naguère que « l’approche musicologique de ces répertoires est la seule qui puisse prendre en compte l’organisation sonore de façon précise » (Rudent, 1998 22). Quelle que soit la qualité des analyses présentées dans Made in France, on ne peut omettre de signaler, pour le déplorer, cet angle mort de la plupart des études françaises sur les musiques populaires. Enfin, un tel ouvrage ne peut s’intéresser à tous les genres de musiques qui ont été pratiqués, et étudiés, en France depuis cinq décennies mais il y manque, entre autres, des études consacrées au mouvement folk qui a marqué les années 1960 et 1970 et aux musiciens de « balloche » qui animent fêtes villageoises et bals du 14 juillet en proposant 22 Ce fossé est beaucoup moins profond dans le monde anglophone où les spécialistes cumulent souvent des compétences socio-anthropologiques et des connaissances musicales sérieuses. Robert Walser, par exemple, directeur du Center for Popular Music Studies à la Case Western Reserve University de Cleveland (Ohio), rappelle dans un chapitre de synthèse : « Si nous ne prenons pas au sérieux les analyses techniques et interprétatives des musiciens et des musicologues, nous risquons d’aboutir à une mystification de la musique et au rejet des débats musicologiques comme autant d’obscurations universitaires. » (Walser, 2008 : 21) Mais, de l’autre côté, on pourrait aussi remarquer, avec Paul Friedlander, directeur du Music Industry Program à la California State University, Chico, que : « Il incombe aux musicologues de développer une méthode de communication avec les non musicologues qui permette de traduire les précieuses conclusions de leurs analyses musicologiques dans un langage susceptible d’être compris, plus largement, dans le monde des études de la musique populaire. » (Friedlander, 1996 : 77) Même en Grande Bretagne, il semble que les difficultés dans les relations entre sociologues et musicologues ne soient pas encore surmontées (Marshall, 2011). 23 Kali Argyriadis et Sara Le Menestrel avaient naguère donné un excellent exemple d’une enquête sur un sujet proche : Argyriadis & Le Menestrel (2003). sur celles qui sont réputées françaises. On pourrait multiplier ainsi les souhaits et les suggestions ; certaines de ces pistes sont déjà explorées dans d’autres publications 24 et, de plus en plus, dans des mémoires et des thèses universitaires. L’état des lieux que dresse Made in France est, dans l’immédiat, fort stimulant 25 ; il ne peut qu’inspirer et encourager le développement des recherches dans ce champ. 24 Par exemple : Brandl, Prévost-Thomas & Ravet (2012). 25 De ce point de vue, il serait bienvenu qu’en soit proposée une traduction française ; elle n’est pas, semble-t-il, envisagée pour le moment mais ne devrait pas soulever d’immenses difficultés dans la mesure où la plupart des textes ont d’abord été rédigés en français. À propos de l’ouvrage Made in France, Studies in Popular Music des répertoires éclectiques ; or ils sont pour beaucoup de citoyens les seuls producteurs de musique qu’ils ont l’occasion d’entendre en direct 23 . Il serait également intéressant de travailler sur les modes de composition par ordinateur qui sous-tendent les assemblages essentiels à nombre de musiques « actuelles » (rap, techno, world music de synthèse) ou encore sur le fonctionnement des émissions de télé-réalité musicale et sur leur impact. Enfin, il paraîtrait important, compte tenu des débats actuels sur l’« identité française » et les immigrations d’apprécier l’influence des musiques coloniales et postcoloniales 16 1 Argyriadis Kali & Le Menestrel Sara (2003), Vivre la guinguette, Paris, Presses universitaires de France. Bakhtine Mikhail (1970), L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance, traduit du russe par André Robel, Paris, Gallimard. Brandl Emmanuel, Prévost-Thomas Cécile & Ravet Hyacinthe (eds.) (2012), 25 ans de sociologie de la musique en France, tome 1 ; Réflexivité, écoutes, goûts ; tome 2 : pratiques, œuvres, interdisciplinarité, Paris, L’Harmattan. Calvet Louis-Jean, Brunschwig Chantal & Klein Jean-Claude (1972), 100 ans de chanson française, Paris, Le Seuil. Dauncey Hugh & Cannon Steve (eds.) (2003), Popular Music in France from Chanson to Techno, Aldershot, Ashgate. Faure Sylvia & Garcia MarieCarmen (2005), Culture hip-hop, jeunes des cités et politiques publiques, Paris, La Dispute. Friedlander Paul (1996), « Plenary panel don’t know much about history : Historiography and popular music studies, IASPM/US 1997 conference Pittsburgh, PA », Journal of Popular MusicStudies, no 8, p. 57-89. Gaulier Armelle (2014), Zebda, Tactikolectif, Origines controlees : la musique au service de l’action sociale et politique à Toulouse, Pessac, Sciences Po Bordeaux (thèse pour le doctorat en science politique ; https://tel.archives- ouvertes.fr/tel-01139950/document, consulté le 30 octobre 2018). — (2015), « La musique du groupe Zebda entre revendication identitaire et résistance symbolique », Transposition, CRAL/ EHESS, 5, http://transposition. revues.org/1398 (consulté le 30 octobre 2018). Green Anne-Marie (1986), Les adolescents et la musique, Issy-lesMoulineaux, Éditions E.A.P. — (1993), De la musique en sociologie, Issy-les-Moulineaux, Éditions E.A.P. (réédition [2006], Paris, L’Harmattan, coll. « Musiques et Champ Social »). — (1997), Des jeunes et des musiques aujourd’hui : Rock, Rap, Techno, Paris, L’Harmattan. Tribune Bibliographie 173 Denis-Constant Martin — (1998), Musicien de métro : approche des musiques vivantes urbaines, Paris, L’Harmattan. Grenier Line (2006), « Making pop matter : The rise to fame of global pop star Céline Dion in Québec », paper presented at British and Irish Studies Seminar : « What’s so popular about popular culture ? », University of Helsinki, Finland, April 28th. Guibert Gérôme (2006), La production de la culture, le cas des musiques amplifiées en France, genèse, structurations, industries, alternatives, St. Amand Tallende, Mélanie Séteun / Paris, IRMA. Guibert Gérôme & Bellavance Guy (eds.) (2014), « La notion de “scène”, entre sociologie de la culture et sociologie urbaine : genèse, actualités et perspectives », Cahiers de recherche sociologique, 57, automne (https://www.erudit.org/ fr/revues/crs/2014-n57-crs02378/, consulté le 30 octobre 2018). Hamm Charles (1995), Putting Popular Music in its Place, Cambridge, Cambridge University Press. Hennion Antoine (1975), La production musicale : les politiques des firmes discographiques, Paris, Centre de sociologie de l’innovation, ENSMP. — (1982), « Une Sociologie des variétés : d’une sociologie de la musique à une musicologie du social », Xème congrès de sociologie. — (1999), « Les amateurs de musique, sociologie d’une pratique et d’un goût », Sociologie de l’Art, no 12, p. 9-38. 174 Hennion Antoine & Vignolle JeanPierre (1978), L’économie du disque en France, Paris, Ministère de la Culture / La Documentation Française (série Les industries culturelles). openedition.org/volume/295, consulté le 30 octobre 2018). Hennion Antoine & Grenier Line (2000), « Sociology of Art : New Stakes in a Post-Critical Time », in Stella Quah & Arnaud Sales (eds.), Sociology : Advances and Challenges in the 1990s, New York / Londres, Sage / ISA Research Council, p. 341-355. (https:// halshs.archives-ouvertes.fr/ halshs-00193262/document, consulté le 30 octobre 2018). Teillet Philippe (1993), « Sur une transgression : la naissance de la politique du rock », L’Aquarium, no 11-12, p. 73-85. Le Guern Philippe (2007), « En arrière la musique ! Sociologies des musiques populaires en France, la genèse d’un champ », Réseaux, 2 (141-142), p. 15-45. Looseley David (2006), « Musiques populaires : une exception francophone ? », Volume ! La revue des musiques populaires, no 5-2, p. 199-204. Marshall Lee (2011), « The sociology of popular music, interdisciplinarity and aesthetic autonomy », The British Journal of Sociology, 62 (1), p. 154-174. Morin Edgar (1994), Sociologie, Paris, Fayard, (Points essais 276). Pecqueux Anthony & Roueff Olivier (2009), Écologie sociale de l’oreille, enquêtes sur l’expérience musicale, Paris, Éditions de l’EHESS. Rudent Catherine (1998), « Analyse musicale des musiques populaires modernes : un état des lieux », Musurgia, 5 (2), p. 21-28. Tagg Philip (1989), « Open letter : “Black Music”, “Afro-American Music”, and “European Music” », Popular Music, 8 (3), p. 285-298 (traduction française [2008], « Lettre ouverte sur les musiques “noires”, “afro-américaines” et “européennes” », Volume ! La revue des musiques populaires, no 6-(12), p. 135-161 ; https://journals. Walser Robert (2008), « Popular music analysis : ten apothegms and four instances », in Moore Allan F. (ed.), Analyzing Popular Music, Cambridge, Cambridge University Press, p. 16-38. Notes de lecture 176 François Ribac (ed.), Simon Frith : Une sociologie des musiques populaires, Paris, Les presses du réel, 2018. Par Maxim Bonin 179 Dean Vuletic, Postwar Europe and the Eurovision Song Contest, New York, Bloomsbury, 2018 ; Karen Fricker et Milija Gluhovic (eds.), Performing the « New » Europe. Identities, Feelings and Politics in the Eurovision Song Contest, Basingstoke & New York, Palgrave Macmillan, 2013. Par Stéphane Resche 183 Sarah Baker, Catherine Strong, Lauren Istvandity et Zelmarie Cantillon (eds.), The routledge companion to popular music history and heritage, Abingdon & New York, Routledge, 2018. Par Eva Nicolas 187 José Juan Olvera Gudiño, Economías del rap en el noreste de México. Emprendimientos y resistencias juveniles alrededor de la música popular, Mexico, CIESAS, 2018. Par Michael Spanu 16 1 Notes de lecture Sommaire 175 François Ribac (ed.), Simon Frith : Une sociologie des musiques populaires, Paris, Les presses du réel, 2018 Par Maxim Bonin Sociologue, maître de conférence à l’Université Franche-Comté et compositeur de théâtre musical, François Ribac signe la direction de Simon Frith : Une sociologie des musiques populaires. Préfacé et postfacé par François Ribac lui-même, l’ouvrage rassemble deux textes de Simon Frith traduits par Charlotte Bomy et dont la publication en langue anglaise 1 date respectivement de la fin des années 1980 et du début des années 1990. Il présente par ailleurs une entrevue de François Ribac avec Gilles Castagnac, directeur de l’Irma (Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles) sur la présence du rock et de ses acteurs dans le paysage musical français. 176 1 Les textes « Why do songs have words ? » et « The Industrialization of Popular Music » ont été respectivement publiés dans les ouvrages Lost in Music. Culture, Style and The Musical Event (White, 1987) et Popular Music and Communication (Lull, 1992). En préface, François Ribac soulève la contribution de Simon Frith dans l’avancement des études sur les musiques populaires, mais également son apport au milieu de la presse musicale nord-américaine et britannique. Cette contribution influence l’approche de Frith ancrée dans « son expérience d’auditeur ou de spectateur qui est le plus souvent son point de départ » (p. 10). La préface permet de positionner la contribution de Frith en concordance avec les transformations et mutations de la musique populaire et de ses industries au cours des années 1980, 1990 et 2000 tout en soulignant l’influence d’une pensée pragmatique wittgensteinienne sur son approche. Dans « Pourquoi les chansons ont-elles des paroles », Frith effectue un retour sur les études sociologiques des musiques populaires 1 Simon Frith : Une sociologie des musiques populaires représente une ère de conformisme, une époque où l’industrie du disque s’impose comme un média de masse distribuant des productions musicales au plus grand nombre de consommateurs possible, mesurant son succès par les ventes et la diffusion à la radio (p. 83-84). Après la Seconde Guerre mondiale, le rock‘n’roll entre en scène. La performance live et l’authenticité des enregistrements haute fidélité censée reproduire l’expérience du concert rock sont au coeur des nouvelles innovations qui touchent l’industrie de la musique au cours des années 1960 et 1970 (p. 85-86). En dernière partie de cet essai, Frith (2018) revient sur ses écrits dans Sound Effects (1981) où il affirme que le caractère oligopole de l’industrie du disque permet difficilement une volonté d’innovation et que seules une brèche ou une perte de contrôle entraînées par un changement technologique peuvent mener vers de nouvelles pratiques. La postface de ce livre présente une entrevue entre François Ribac et Gilles Castagnac. En s’inspirant du dernier chapitre de l’ouvrage On Records de Frith et Goodwin (1990) qui donne la parole aux fans, l’éditeur laisse ici la parole à l’un des « pionniers de la politique publique en matière de rock en France » (p. 111). Leurs échanges dressent un portrait de la présence du rock dans le paysage musical français tout en faisant état des événements, acteurs, structures formelles et informelles qui ont contribué, depuis la fin des années 1970, à son émancipation en France hexagonale. En conclusion, Castagnac revient sur la pluralité des tâches à accomplir pour un musicien avec la montée en force du numérique et revient sur l’importance de la formation pour qu’ils parviennent à maîtriser les outils qui leur permettront de faire carrière (p. 127). Notes de lecture 16 des années 1950 et 1960 et amorce sa réflexion sur les analyses des paroles des chansons qui lui ont permis de comprendre l’essor d’une « nouvelle » jeunesse nord-américaine dans un contexte d’après-guerre (p. 29). Selon l’auteur, cette période est marquée par une analyse des paroles de chansons (Peatman, 1944) qui vise à déterminer le contexte social de production et de diffusion. Frith souligne les limites de ces analyses ancrées dans la « théorie du reflet » de Mooney (1954) qui fixent de manière trop simpliste une association entre les comportements sociaux et les paroles des chansons, alors que l’interprétation de ces comportements émerge souvent des préjugés des chercheurs sur le mode de vie des jeunes de l’époque (p. 30). Dans son retour sur la théorie du réalisme, Frith affirme que l’analyse de l’authenticité des chansons traditionnelles et des conditions sociales qu’elles expriment est biaisée par des conventions qui dictent les paramètres de ces mêmes conditions (p. 39). La pertinence d’une théorie du réalisme (p. 41) se trouve alors pour Frith dans l’analyse de sa fonction idéologique, c’est-à-dire chercher à comprendre les conventions sociales qui permettent d’affirmer ce qui est authentique et ce qui ne l’est pas. En conclusion, Frith (p. 61) affirme qu’une compréhension de l’usage des paroles dans les chansons issues de différents genres musicaux s’impose aujourd’hui dans les études sur la musique populaire. Dans « L’industrialisation de la musique populaire », Frith revient sur les craintes de l’industrie du disque face à l’arrivée des nouvelles technologies de diffusion telles que la radio et la télévision et situe ces changements dans le contexte sociopolitique du XX e siècle. Selon Frith, la période située entre les deux grandes guerres mondiales 177 Bien qu’en préface Ribac revienne sur les publications marquantes de Frith, dont Performing Rites (1996), il ne propose malheureusement pas une contextualisation des deux textes de Frith présentés dans le présent ouvrage. Ces derniers auraient gagné à être situés dans le contexte de globalisation des industries de la musique qui marquent les années 1980 et 1990. À la lecture de la postface, nous nous interrogeons par ailleurs sur la complémentarité de l’entrevue de Castagnac avec les essais de Frith. Nous comprenons l’intention de l’auteur de donner la parole à un pionnier du rock en France tout comme l’ont fait Frith et Goodwin (1990) avec les fans dans On Records. Il nous semble qu’une ouverture sur la pertinence de lire Frith dans le contexte actuel des industries de la musique soulignerait la nécessité de traduire cet auteur. Par exemple, quelle direction pourrait prendre une réflexion sur les paroles des chansons dans le contexte actuel d’écoute en streaming ou encore dans la diffusion des lyric videos sur YouTube ? Quels parallèles peuvent être tracés entre l’industrialisation de la musique populaire au X X e siècle et les réactions actuelles des industries de la musique face au modèle d’affaires des plateformes d’écoute telles que Spotify, cette brèche technologique porteuse de changement évoquée par Frith il y a pourtant près de 30 ans (p. 104-105) ? En terminant, nous souhaitons souligner l’importance de la traduction en français de l’œuvre de Frith. L’apport de cet auteur doit circuler davantage au sein de la communauté académique pour appuyer le rayonnement des études sur les musiques populaires dans la francophonie. 178 Bibliographie Frith Simon (1981), Sound Effects - Youth, Leisure, and the Politics of Rock’n’Roll, New York, Pantheon. — (1996), Performing Rites, Cambridge, Harvard University Press. — (2007), Taking Popular Music Seriously. Selected Essays, New York, Routledge. Frith Simon & Goodwin Andrew (eds.) (1990), On Records, New York, Routledge. Lull James (ed.) (1987), Popular Music and Communication, Londres, Sage Publications. Mooney Hughston F. (1954), « Song, Singers and Society - 1890-1954 », American Quarterly, vol. 6, p. 221-232. Peatman John (1944), « Radio and Popular Music », in Lazersfeld Paul Felix et Santon Franck (eds.). Radio Research : 1942-1943, New York, Duell, Sloan & Pearce. White Avron Levine (ed.) (1987), Lost in Music. Culture, Style and The Musical Event, New York, Routledge. 1 Par Stéphane Resche S’il n’existe pas encore de monographie de référence sur le concours Eurovision de la chanson (ou Eurovision Song Contest) en français, voilà quelques nouveaux ouvrages qui devraient permettre malgré Postwar Europe and the Eurovision Song Contest tout aux curieux comme aux plus assidus d’en apprendre enfin davantage sur la question. Le travail de Dean Vuletic (2018) est le plus récent. Néanmoins, il s’insère dans une continuité scientifique pluriannuelle. Aussi convient-il tout d’abord de se pencher sur le recueil d’études dirigé par Karen Fricker et Milija Gluhovic, paru en 2013. Ce dernier est divisé en trois parties. L’ouvrage vise, dans son ensemble, à interroger l’évolution de l’Europe au cours des dernières décennies avec une attention précise pour le début des années 2000 – il fait écho à cet égard au recueil francophone de Lévy & Sicard (2008), consacré à l’Europe mais dans une approche médiatique où l’ESC est très largement invoqué. L’introduction commence par une analyse précise de l’année 2012 qui permet de donner un cadre aux études qu’elle anticipe – rappelons au passage l’existence de l’article de Wolther (2012), Notes de lecture 16 Dean Vuletic, Postwar Europe and the Eurovision Song Contest, New York, Bloomsbury, 2018 ; Karen Fricker et Milija Gluhovic (eds.), Performing the « New » Europe. Identities, Feelings and Politics in the Eurovision Song Contest, Basingstoke & New York, Palgrave Macmillan, 2013 179 180 une étude succincte et condensée, mais utile pour appréhender en quelques pages les enjeux désormais incontournables dans les études sur le sujet. On perçoit, dès les premières lignes du volet d’ouverture de Fricker et Gluhovic, que l’ESC est envisagé comme un prisme des nouveaux enjeux internationaux notamment dans la pensée de l’européanisation et d’un européisme commun. En 2009, un groupe de recherche sur l’Eurovision (aujourd’hui en sommeil) a rassemblé 24 chercheurs d’horizons divers. Deux workshops furent rapidement organisés, le premier en février 2011 à la Royal Holloway de Londres, le second à Venise deux mois plus tard. Une dernière session se tint en mai, à Düsseldorf, juste avant le concours qui vit l’Azerbaïdjan gagner la compétition annuelle (victoire qui imposa donc l’organisation du concours à Bakou, en 2012, événement qui stimule profondément les études dans le domaine). Les trois parties du volume de Fricker et Gluhovic reprennent le cœur des interventions de ces workshops, tout en accordant une place de choix aux transcriptions des échanges les plus féconds. La première partie « Feeling European : The ESC and the European Public Sphere » tente d’expliciter la manière dont l’ESC a pu refléter le fait d’appartenir à l’Europe – mais quelle(s) Europe(s) ? – au cours des vingt dernières années. Le concours constitue un lieu de discussion, où plusieurs réalités coexistantes participeraient de l’émanation d’un sentiment de citoyenneté européenne. L’aspect performatif donne l’occasion de questionner les récits officiels (nationaux et supranationaux), les modes d’adresse et les évidences, de proposer enfin des alternatives (un peu comme dans le cadre international général des Jeux Olympiques). En tant qu’espace où l’on s’exhibe, affirment les autrices, et où l’on célèbre ou critique des valeurs aux références a priori communes, l’ESC est catalysé par la puissance de l’affect (via la musique, la compétition, ou encore le plurilinguisme). L’affect, justement, influerait sur notre sentiment d’appartenance nationale, régionale, européenne, comme sur celui d’identification à des groupes ou des communautés (gay, queer, ou encore migrantes, engendrées par les diasporas continentales des dernières décennies). La composante affective du sentiment de citoyenneté européenne et d’appartenance à la sphère publique éponyme se situe donc au cœur de la partie I – édifiante – du recueil, au sein de laquelle (tout en saluant l’équilibre des études) on signalera la pertinence spécifique du second article, consacré à l’analyse des commentaires du concours de Terry Wogan pour la BBC, dont la portée conservatrice et 1 Postwar Europe and the Eurovision Song Contest does not deal with politics, politics deals with it » (Le Soir - Belgique, 1979), le travail de Vuletic s’évertue à nouer les contextes politiques et les réalités événementielles de l’ESC (même si, par moments, on perd un peu de vue l’origine des éclairages pléthoriques et on a l’impression, en passant à plusieurs reprises de l’ESC à l’histoire et inversement, de tourner en rond). Noble projet en tout cas (et belle concrétisation) que d’avoir décidé de présenter les soixante années d’ESC (de 1956 à 2015) en coupant la poire en deux sections très distinctement délimitées par la chute du rideau de fer. Et le titre de l’ouvrage, qui commence par « Postwar Europe » (là encore, quelles Europes ?), de révéler pleinement sa polysémie. L’étude est donc structurée en deux parties équilibrées : « I : The Cold-War 1945-1989 » (qui comprend trois chapitres) ; « II : European Unification, 1990-2016 » (deux chapitres). Le cheminement est par conséquent plutôt chronologique. La première partie enquête sur le rôle de l’ESC, depuis son lancement jusqu’à sa célébration, dans les relations entre les pays, aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest. La seconde cible quant à elle davantage les liens entre l’ESC et les politiques européennes depuis la fin de la guerre froide. Le déroulement des analyses est l’autre point fort qu’il faut à mettre au crédit de l’auteur. Les titres des chapitres sont clairs, et ceux des sous-chapitres, aussi précieux qu’essentiels. Ils reflètent un style limpide, solide, charpenté autour d’exemples et d’anecdotes en grand nombre qui raviront les fanatiques ou les historiens. Par exemple, le quatrième chapitre (partie II) intitulé « A Concert of Europe », se développe en trois moments, désignés ainsi : Wars, Europeanism, Euroscepticism. Notes de lecture 16 les relents « mélancoloniaux » n’ont d’égal que la puissante sagacité avec laquelle ils furent proférés. Le second volet de l’ouvrage avance que la modernisation est un concept clé de l’identité européenne, bien que le terme recouvre des réalités très diverses, à savoir des développements et des processus de transformations et de modernisation très divers. L’ESC promet de relire cette modernité en des termes pluriels. La place des Balkans, par exemple, comme celle de l’Europe dite « de l’Est » est revue à l’aune de la persistance de préjugés et de préconceptions. La Russie, la communauté rom, l’Irlande occupent respectivement les chapitres 5 à 7. La troisième partie (chapitres 8 à 11), enfin, confirme l’ouverture à ce qui prédomine aujourd’hui dans les recherches qui se penchent sur l’ESC. Le troisième moment « Gender Identities and Sexualities in the ESC » s’inscrit ainsi dans le sillage d’une première série de travaux précédents (notamment le recueil de Raykoff & Tobin [2007] et deux numéros spéciaux de Tuhkanen et Vänskä [2007] et Georgiou & Sandvoss [2008]) tout en annonçant ce qu’on peut lire, dans le détail souvent mais aussi hélas dans le ressassement, dans de nombreux articles épars consacrés à l’ESC. L e réc ent ouv r a ge d e Vu let ic – « Monsieur » Eurovision – reprend à son tour les thèmes fondateurs des recherches sur l’ESC. Produit joliment annoncé et désormais très bien diffusé dans la sphère de rigueur, il a surtout l’avantage non négligeable de faire dialoguer, sur la longueur, et avec une certaine virtuosité, les disciplines et les détails inhérents à chacune des éditions du concours. Reprenant à son compte les célèbres mots du journaliste Jean Coucrand : « If the Eurovision Song Contest 181 182 La valeur symbolique des termes choisis en tête de gondole n’empêche pas une évolution logique du propos, à la manière d’un roman documenté. Ainsi, les paragraphes consacrés à l’européanisme explicitent-ils, en somme, qu’après les années 2000, la relation entre la victoire à l’ESC et les aspirations à l’intégration de l’Union Européenne sont devenues de plus en plus évidentes. Les cas des victoires à l’ESC de l’Estonie et de la Lettonie, puis des concours 2001 et 2002, sont abordés en parallèle des étapes du processus d’intégration des pays. Puis viennent les cas de la Turquie (vainqueur successif, chronologiquement parlant), et de l’Ukraine. Vuletic argumente le point de vue selon lequel le Conseil de l’Europe serait beaucoup plus lié à l’ESC que ne l’est en réalité l’Union Européenne (aisément accusée de tous les maux continentaux, notamment lorsqu’approche le contexte printanier du concours, propice à toutes les révoltes). En réalité, assène l’auteur, l’UE est le grand absent de l’ESC. Comme pour les premières sections de l’ouvrage, le passage au développement suivant (Euroscepticism) paraît évident et nécessaire. On ne saurait tenir rigueur à l’ouvrage de ne faire que trop peu appel à des notions musicologiques, ou encore dramaturgiques (il faudra bien un jour s’y coller), tant l’objet remplit parfaitement ses fonctions : être un manuel historico-politique condensé, dans un format idéal de 200 pages (sans compter les notes et la très complète bibliographie). Et l’on saisit d’autant mieux le souhait de Vuletic de voir le Concours Eurovision de la Chanson retrouver ses aspirations de célébration de la diversité culturelle et d’expression de la critique sociale (qui furent très fortes pendant la guerre froide), et qui se révèlent plus faibles aujourd’hui en raison de la commercialisation rampante de l’événement et de sa conséquente « anglicisation », culturelle et linguistique. Ces deux ouvrages constituent des incontournables qui appellent d’aussi prometteuses mises à jour. Il y a fort à parier que le constant développement international et économique du concours (son ouverture récente à l’Australie n’en est qu’un énième révélateur) se traduira également par de nouvelles recherches. Dans ce cadre, même s’il ne s’agit pas d’un ouvrage aux prétentions académiques, nous n’oublierons pas de saluer la sortie de l’ouvrage en français de Richard, Clapasson & Tanner (2017). Enfin un bon compendium des résultats et des anecdotes fondatrices du concours. L’outil pratique qui manquait, bien organisé, illustré sobrement et en cela agréable à feuilleter. Bibliographie Georgiou Myria & Sandvoss Cornel (eds.) (2008), « Special Issue : “Euro Visions : Culture, Identity and Politics in the Eurovision Song Contest” », Popular Communication, vol. 6, no 3. Lévy Marie-Françoise & Sicard Marie-Noëlle (eds.) (2008), Les lucarnes de l’Europe, Paris, Publications de la Sorbonne. Raykoff Ivan & Dean Robert (eds.) (2007), A Song for Europe : Popular Music and Politics in the Eurovision Song Contest, Londres, Ashgate. Richard Jean-Marc, Clapasson Mary & Tanner Nicolas (2017), La saga Eurovision, Lausanne, Favre. Tuhkanen Mikko & Vänskä Anna Mari (eds.) (2007), « Special issue “Queer Eurovision” », SQS – Journal of Queer Studies in Finland, vol. 2, no 7. Wolther Irving (2012), « More than just music: the seven dimensions of the Eurovision Song Contest », Popular Music, vol. 31, no 1, p. 165-171. 1 Par Eva Nicolas The Routledge Companion to Popular Music History and Heritage, réalisé sous la direction de Sarah Baker, Catherine Strong, Lauren Istvandity et Zelmarie Cantillon, est composé de trente-huit chapitres organisés en cinq parties thématiques. L’intention des auteures, exprimée dans la préface, est de présenter l’éventail grandissant d’études portant sur la notion de patrimoine des musiques populaires et de rassembler les réflexions fondamentales et progressistes The routledge companion to popular music history and heritage du début du XXI e siècle sur le sujet dans un format digeste au sein duquel les chercheurs, débutants ou expérimentés, pourront aisément venir puiser des idées. Si les ouvrages collectifs Sites of Popular Music Heritage, dirigé par Sara Cohen, Robert Knifton, Marion Leonard et Les Roberts (2015), et Preserving Popular Music Heritage, dirigé par Sarah Baker (2015), balayent déjà de nombreuses problématiques relatives à la patrimonialisation des musiques populaires, ils abordent le sujet en traitant respectivement des espaces où se construisent les relations avec le passé relatif aux musiques populaires et des pratiques de patrimonialisation considérées « do-it-yourself ». En se voulant plus général, interdisciplinaire et international, The Routledge Companion to Popular Music History and Heritage vient ainsi combler l’absence d’une synthèse des différentes approches portant sur le patrimoine des musiques populaires. Cet ouvrage apparaît pertinent en ceci qu’il vient documenter des pratiques et des projets en constant développement, Notes de lecture 16 Sarah Baker, Catherine Strong, Lauren Istvandity et Zelmarie Cantillon (eds.), The Routledge Companion to Popular Music History and Heritage, Abingdon & New York, Routledge, 2018 183 184 l’intérêt pour le patrimoine des musiques populaires étant grandissant ces dernières années (multiplication d’expositions, de projets d’archivage, de musées… consacrés à diverses cultures musicales comme le rock, le hip-hop, la techno…). Les trois premières parties de l’ouvrage traitent des musiques populaires selon différentes perspectives relationnelles que nous pouvons avoir avec le passé : histoire, patrimoine et mémoire. La première partie, intitulée « History and historiography », examine ainsi l’histoire de la musique populaire et son processus de construction. Les premiers chapitres sont consacrés à la remise en question du discours historique traditionnellement accepté en mettant en évidence l’existence de récits alternatifs. La place des femmes et le rôle des politiques raciales dans la construction de l’histoire des musiques populaires sont ainsi respectivement interrogés par Rosa Reitsamer dans le chapitre « Gendered narratives of popular music history and heritage » et Nabeel Zuberi dans « Racialising music’s past and the media archive ». Les derniers chapitres de cette première partie analysent un certain nombre de supports ayant joué un rôle important dans la production de récits historiques. Les livres, fanzines, blogs, magasines ou encore films, émissions télévisées et archives sont ainsi examinés pour comprendre comment chaque format a contribué à façonner les histoires racontées. Par exemple, dans le chapitre « Screening popular music’s past: music documentary and biopics », Tim Wall et Nicolas Pillai abordent la manière dont les films et la télévision documentent la musique populaire en questionnant le sens du terme « documenter » d’une part et les significations générées lors des processus de production, de distribution et de réception des vidéos d’autre part. Ainsi, cette première partie donne d’emblée les clés de lecture pour appréhender au mieux cet ouvrage en montrant que tout ce qui est relatif au passé des musiques populaires comporte une pluralité de discours tout à la fois acceptés, contestés, négociés selon les périodes, les espaces et les acteurs qui participent à leur production. La deuxième partie aborde le champ des musiques populaires sous l’angle du patrimoine, que les auteurs distinguent de l’histoire par sa capacité à créer un sentiment d’identité au sein de groupes de personnes à des échelles variées. Les premiers chapitres examinent les forces qui influencent notre compréhension de la musique populaire en tant que patrimoine. Les notions de légitimité, les relations de pouvoir au sein des processus de patrimonialisation et les effets des flux mondiaux sur la culture locale sont ainsi abordés. Les chapitres suivants sont consacrés à mettre en avant des pratiques et utilisations spécifiques du patrimoine des musiques populaires : le tourisme, les pratiques DIY de préservation du patrimoine et les groupes « en hommage à » sont questionnés. La cohérence de cette seconde partie tient au déroulement des chapitres qui s’intéressent successivement aux discours patrimoniaux « autorisés », « auto-autorisés » puis « non-autorisés » (Roberts & Cohen, 2014). Dans le dernier chapitre « Burning punk and bulldozing clubs : the role of destruction and loss in popular music heritage », Catherine Strong rappelle que c’est à travers le processus de destruction que la notion de patrimoine telle que nous la concevons aujourd’hui s’est développée. Par des exemples tels que la fermeture du CBGB en 2006, elle montre que le processus de perte, comme celui de 1 The routledge companion to popular music history and heritage La quatrième partie explore la manière dont les institutions jouent un rôle dans la sauvegarde, la présentation ou la redéfinition du passé de la musique populaire. Les premiers chapitres sont consacrés à l’étude du rôle des musées, des archives sonores et des Halls of Fame. Aux côtés de ces institutions traditionnellement reconnues comme telles, les auteurs de l’ouvrage se proposent d’inclure dans cette partie l’analyse d’autres formes institutionnelles. Ainsi, les deux derniers chapitres « DIY institutions and amateur heritage making » de D-M Withers et « Reissue programmes, framing the past as project » de Elodie A. Roy traitent du rôle des « DIY institutions » (Baker & Huber, 2013), caractérisées par des initiatives patrimoniales portées par des communautés de personnes initialement non-expertes en matière de gestion du patrimoine, et des maisons de disques spécialisées dans la réédition d’archives musicales. Enfin, la cinquième partie de l’ouvrage est dédiée à la présentation d’une série d’études de cas donnant un aperçu de la diversité des activités de patrimonialisation et d’historicisation des musiques populaires, l’accent étant mis sur l’incorporation de voix extérieures à la sphère anglo-américaine. Dans les premiers chapitres, les interactions entre musiques populaires et musiques traditionnelles sont questionnées par l’étude d’Åse Ottosson portant sur des peuples autochtones d’Australie Centrale et celle de Dan Bendrups, Pip Laufiso and Hiliako Iaheto traitant de nations insulaires du Pacifique. Les façons dont les attitudes politiques façonnent le patrimoine musical populaire sont ensuite abordées au travers de travaux réalisés en Inde par Jayson Beaster-Jones, en Hongrie par Emilia Barna, en Afrique du Notes de lecture 16 sauvegarde, peut aboutir à transformer les valeurs et les significations accordées à certains lieux, pratiques et artefacts. Rarement abordée, cette dimension du patrimoine vient enrichir la compréhension que nous pouvons avoir de celui-ci. La troisième partie de l’ouvrage interroge le lien entre musiques populaires et mémoire. Le premier chapitre « Popular music and the memory spectrum », écrit par Michael Pickering, fournit un vaste cadre pour examiner les fonctions que la musique remplit dans la mémoire individuelle et collective, à travers différentes technologies et différents concepts comme celui de nostalgie. Ces aspects sont ensuite abordés plus précisément dans les chapitres qui suivent. Dans « Popular music and autobiographical memory : intimate connections over the life course », un aperçu est d’abord donné par Lauren Istvandity de la manière dont les liens entre mémoire, musique et affect ont été étudiés et conceptualisés en psychologie et en sciences humaines. L’interaction entre mémoire médiée et mémoire collective, ainsi que le rôle de la musique dans la vie quotidienne sont ensuite interrogés dans le chapitre proposé par Ben Green « Popular music in mediated and collective memory ». Les derniers chapitres de cette troisième partie traitent de la manière dont la musique devient l’objet de la mémoire individuelle ou collective lorsqu’elle est associée à certains lieux ou certains contextes. Sont ainsi analysés les actes de mémoire dédiés à des artistes lors de rituels commémoratifs, la place de la nostalgie dans la production et la consommation de musique, et la manière dont les mémoires musicales sont préservées dans un environnement virtuel via des sites d’archivage participatifs. 185 186 Sud par Schalk van der Merwe et en Guinée par Graeme Counsel. Les deux derniers chapitres mettent en avant la défaillance des processus patrimoniaux dans le cas de la musique populaire palestinienne étudiée par Moslih Kanaaneh et dans celui de sites patrimoniaux liés aux Beatles en Angleterre analysés par Mike Brocken. Parce que les frontières entre histoire, patrimoine et mémoire sont parfois floues, le découpage des trois premières parties de l’ouvrage n’est pas une évidence au premier abord. Il apparait toutefois à la lecture des différents chapitres que les dimensions que ces domaines recouvrent se nourrissent les unes les autres sans pour autant se confondre. Une telle organisation thématique permet alors de clarifier la manière dont les relations au passé des musiques populaires sont appréhendées par les chercheurs. Si les deux dernières parties de l’ouvrage traitant des institutions et des études de cas semblent s’ajouter sans cohérence apparente à l’ensemble, l’approche plurielle de la notion d’institution de la quatrième partie et l’effort d’intégration d’études internationales dans la cinquième partie apparaissent en cohérence avec le discours sous-tendu dans l’ensemble de l’ouvrage qui met un point d’honneur à déconstruire les schémas occidentaux sur la formation de l’histoire et du patrimoine. De manière générale, la transversalité des parties permet d’éviter de tomber dans une dichotomie opposant discours dominants et discours alternatifs relatifs au passé des musiques populaires. Les pratiques et discours portés sont questionnés dans leurs relations les uns aux autres au sein des parties thématiques, la structure de l’ouvrage illustrant alors l’évolution du paradigme patrimonial occidental à l’œuvre depuis ces deux dernières décennies. Le patrimoine n’est plus seulement considéré comme objet et discours univoque mais recouvre une multitude d’activités témoignant de la coexistence de relations au passé continuellement négociées. La diversité des cas étudiés, des approches disciplinaires et des méthodes, et l’équilibre entre apports théoriques et empiriques participent à la pertinence de l’ensemble. Ce livre remplit ainsi l’objectif qu’il s’est fixé de rendre compréhensible et accessible les idées « fondamentales et progressistes » qui parcourent les études fleurissant actuellement aux quatre coins du monde à propos de l’histoire et du patrimoine des musiques populaires. Bibliographie Baker Sarah (ed.) (2015), Preserving Popular Music Heritage : Do-it-Yourself, Do-it-Together, New York, Routledge. Baker Sarah & Huber Alison (2013), « Notes towards a typology of the DIY institution : Identifying doit-yourself places of popular music preservation », European Journal of Cultural Studies, vol. 16, no 5. Cohen Sara, Knifton Robert, Leonard Marion & Roberts Les (eds.) (2015), Sites of Popular Music Heritage : Memories, Histories, Places, Abington (UK) & New York, Routledge. Roberts Les, Cohen Sara (2014), « Unauthorising popular music heritage : outline of a critical framework », International Journal of Heritage Studies, vol. 20, no 3. 1 Par Michael Spanu Malgré une période d’effervescence dans les années 2000 autour du groupe de Monterrey Control Machete, le rap mexicain reste un genre musical assez confidentiel, tant dans son propre pays que dans les pays friands de culture hip hop comme la France ou les États-Unis. En effet, on ne le retrouve dans aucun classement de vente ou d’écoute en ligne. Pourtant, la pratique du rap est toujours vivace au Mexique, notamment dans les quartiers populaires de la zone frontalière avec les États-Unis. C’est ce que montre cet ouvrage du sociologue José Juan Olvera Gudiño, qui analyse le rap nord mexicain au prisme du concept de « scène musicale », dans un contexte de fortes inégalités sociales, de violence croissante et de Economías del rap en el noreste de México… flux de populations incessants entre ÉtatsUnis et Mexique. L’originalité de l’ouvrage est d’adopter une perspective économique pour aborder une scène musicale fragile, éclatée et qui dispose de très peu de ressources pécuniaires. En effet, la pratique du rap se démarque majoritairement de l’industrie musicale hégémonique au niveau régional, celle de la musique tex-mex, tant sur le plan esthétique qu’idéologique. Elle lutte contre un pouvoir politique considéré comme corrompu, qui ne reconnaît pas le rap comme pratique culturelle légitime ou qui l’instrumentalise occasionnellement à des fins électorales (aux dépens des acteurs de terrain pour qui le rap a une dimension éducative et sociale). Le rap se confronte aussi aux forces paramilitaires (les cartels) qui fragmentent et détruisent les communautés, soit en dénonçant le phénomène, soit en l’intégrant pour Notes de lecture 16 José Juan Olvera Gudiño, Economías del rap en el noreste de México. Emprendimientos y resistencias juveniles alrededor de la música popular, Mexico, CIESAS, 2018 187 188 en faire la chronique (narcorap). Ainsi, des formes de perméabilité existent, illustrant la complexité et l’ambivalence du phénomène observé. Cela nécessite un cadre théorique particulièrement flexible : l’auteur fait appel à Edward P. Thompson pour son concept d’économie morale, à Will Straw, Andy Bennett et Richard A. Peterson pour leur concept de scène, et à José Juis Paredes Pacho pour le concept de pouvoir horizontal/vertical au sein des réseaux de production/diffusion culturelle ancrés dans la société mexicaine. L’auteur pose parallèlement les jalons historiques de la pratique du rap dans la ville où se déroule son étude (Monterrey), à partir des récits des acteurs impliqués. La première époque se situe entre 1985 et 1989, avec une poignée de jeunes des quartiers populaires dont les liens familiaux avec les États-Unis et la possession d’antennes paraboliques permettent une forme d’initiation à la culture hip-hop. Dans les années 1990, plusieurs kiosques et marchés informels deviennent des points de rendez-vous des amateurs, préfigurant internet comme espace d’échange, tandis que les médias locaux s’ouvrent peu à peu à cette nouvelle culture. À cette époque naît aussi, de l’autre côté de la frontière, le rap chicano qui adopte et développe le point de vue des immigrés mexicains et de leurs descendants, traitant la dimension ethnique, la violence ou encore la solidarité de la vie des quartiers latinos, à travers une pratique oscillant entre espagnol et anglais (le parler « pocho » ). En 1996 sort l’album Mucho Barato du groupe Control Machete chez Polygram. Cet album à succès et aux sonorités rock initie une controverse concernant la « trahison » de la scène rap de Monterrey, tout en donnant à celle-ci une visibilité sans précédent qui culminera dans les années 2000. Cette dynamique s’estompe au milieu de la décennie, avec la hausse de la violence entraînée par la guerre contre la drogue entamée par l’administration du président Felipe Calderón et les conflits entre cartels. En effet, la lutte territoriale de ces derniers dépend du contrôle des espaces nocturnes, affectant directement toutes les festivités musicales qui ont lieu généralement la nuit. Les lieux de concerts et bars musicaux sont régulièrement extorqués par les cartels (cobro de piso), voire deviennent carrément des lieux de rendez-vous mafieux, des zones de non droit. Le rap étant une culture de la rue, sa pratique est donc très affectée. Parmi les 80 espaces dédiés au rap que l’auteur a recensé dans les années 1990, il n’en reste plus que quatre en 2013. À travers une enquête ethnographique et des entretiens auprès d’artistes de rap, l’auteur met en évidence la précarité, le manque de relais médiatiques et de moyens de production. Un recensement des affiches de concerts sur une période allant de 2013 à 2015 permet d’établir qu’une grande partie de ces événements sont gratuits ou à un prix très accessible et se déroulent majoritairement dans des bars, des clubs ou des espaces publics (contrairement au rap étasunien ou espagnol dont les concerts sont chers et ont lieu dans des grandes salles). La vente de merchandising, comme au sein d’autres scènes musicales, permet aux artistes de générer quelques revenus supplémentaires. Le recours à des sponsors tels que des marques de vêtements hip hop permet de diminuer les frais d’organisation de concerts et de trouver un certain équilibre, l’objectif se limitant souvent à ne pas perdre d’argent et à entretenir les liens de fraternité et de respect au sein de la scène. À travers une série d’études de cas, l’auteur identifie 16 Economías del rap en el noreste de México… ensuite plusieurs niveaux de formalité de la pratique du rap : souterraine (rappeurs de rue, faible scolarisation, présence d’anciens détenus, esthétique chicano), indépendante (insertion dans des circuits commerciaux alternatifs, forte scolarisation, esthétique east coast) et institutionnelle (dans le cadre de programme d’intervention dans des quartiers difficiles). Cet ouvrage constitue ainsi une entrée bien documentée sur le fonctionnement de la scène rap du Nord-Est mexicain. On regrettera simplement un certain manque de systématisation et de références universitaires sur les dynamiques DIY qui ont été bien étudiées pour d’autres scènes musicales et qui ne sont jamais mentionnées dans l’ouvrage. Enfin, certains aspects, comme la dimension religieuse, ne sont que rapidement évoqués et méritent d’être explorés dans de futurs travaux sur le sujet. Notes de lecture 1 189 190 Biographies des auteurs 16 1 Eamon Bell : Eamonn Bell est docteur en théorie de la musique (Université de Columbia, 2019). Sa thèse, sous la direction de Joseph Dubiel, porte sur les débuts de l’utilisation de l’informatique dans l’analyse des partitions musicales. À Columbia, il donne un cours qu’il a conçu sur la critique de la musique numérique (2018), et a enseigné l’histoire de la musique occidentale pour les non-musiciens (2018) et les fondamentaux de la théorie musicale aux étudiants de licence (2017). Ses recherches sont consacrées à l’histoire de la technologie et ses liens avec la production et la consommation musicale au XXI e siècle. Il s’intéresse particulièrement aux premiers ordinateurs numériques, à l’application des mathématiques et des techniques numériques actuelles à la résolution de problèmes en musicologie et en théorie de la musique, à la visualisation des données musicales. Il est également titulaire d’une licence en Musique et Mathématiques du Trinity College à Dublin (2013). Il a récemment obtenu un contrat de recherche de deux ans dans son institution d’origine, au sein de laquelle il travaille sur l’histoire des supports d’enregistrement optiques. Sarah Benhaïm : Docteure en musique et sciences sociales au CRAL à l’EHESS, Sarah Benhaïm a consacré sa thèse à l’étude de la musique noise et aux pratiques culturelles qui lui sont associées, par le biais d’une approche interdisciplinaire mêlant musicologie, sociologie et esthétique. Elle s’intéresse en particulier aux leviers pratiques et symboliques que constituent dans la construction du genre le bruit, l’expérimentation et le Do It Yourself (DIY), et leur résonance dans les pratiques contemporaines relevant des arts sonores, du bricolage instrumental et de la culture amateure. Membre du comité de rédaction de la revue Transposition. Musique et sciences sociales, elle a enseigné la théorie de l’art et l’histoire du design graphique. Elle joue dans le trio électronique DMZ et collabore au label Tanzprocesz. Maxim Bonin : Maxim Bonin est étudiant au doctorat en communication à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) où il enseigne comme chargé de cours à l’École de design. Sa thèse, en cours de développement, explore les transitions numérique et territoriale de la scène indie rock de New York des années 2000. En plus d’être récipiendaire de bourses d’excellence, il reçoit en 2016 le Terrance Cox Award de l’Association de culture populaire du Canada. Il est également Biographies des auteurs Baptiste Bacot : Baptiste Bacot est docteur en musique, histoire, société (EHESS/Ircam). Son travail porte sur les pratiques de la musique électronique. En approchant l’activité musicienne par la démarche ethnographique, il s’intéresse particulièrement aux questions de design instrumental et d’organologie, d’esthétique musicale, au rapport entre la technologie et les stratégies créatives des musiciens et enfin, au geste et à la performance dans la musique savante contemporaine, la musique électronique de danse et les représentations audiovisuelles. 191 étudiant chercheur au sein de l’Atelier de chronotopies urbaines et fondateur de la coopérative de design urbain Le Comité. Biographies des auteurs Clément Canonne : Clément Canonne est chargé de recherche au CNRS, rattaché à l’équipe Analyse des Pratiques Musicales au sein de l’UMR 9912 « Sciences et Technologies de la Musique et du Son » (IRCAM-CNRS-Sorbonne Université). Ses recherches portent principalement sur la question de l’improvisation, envisagée à la fois comme pratique et comme paradigme. Son travail récent a fait l’objet de publications dans plusieurs revues internationales (Cognition, Empirical Musicology Review, Music Theory Online, Revue de Musicologie, Psychology of Music, Journal of New Music Research, etc.). Il s’intéresse également à la philosophie de la musique : il a dirigé un ouvrage collectif consacré aux Perspectives philosophiques sur les musiques actuelles (Delatour, 2017) et a traduit et introduit, en collaboration avec Pierre Saint-Germier, une sélection des Essais de philosophie de la musique de Jerrold Levinson (Vrin, 2015). 192 David Christoffel : David Christoffel est poète et compositeur, homme de radio et docteur en musicologie de l’EHESS. Auteur d’opéras parlés (Échecs opératiques, Opéra de Rouen, 2018), de mélodrames (Tapisseries, Festival d’automne à Paris 2018) et de pièces radiophoniques pour la scène (La Voix de Foucault, ManiFeste, 2014), il mène une réflexion sur les rapports entre poésie et musique en publiant de nombreux articles et en dirigeant le volume Orphée dissipé (RSH, 2018). Ancien chroniqueur pour France Musique, il produit des émissions pour Espace 2 (RTS) et le programme Métaclassique diffusée sur plusieurs dizaines de radios associatives. Il est également l’auteur d’Ouvrez la tête (ma thèse sur Satie) (aux éditions MF, 2017) et de l’essai La musique vous veut du bien (PUF, 2018). Ses travaux sont recensés sur le site http:// www.dcdb.fr/ Nicolas Collins : Nicolas Collins est Professeur à la School of the Art Institute de Chicago. Influencé par Alvin Lucier, David Tudor et la culture punk, son travail se situe à la croisée de la musique expérimentale, de l’informatique musicale et de l’art sonore. Au cours de sa carrière, il a créé de nombreux dispositifs musicaux reposant sur le détournement ou l’altération de technologies existantes : des lecteurs CD modifiés donnant à entendre le son produit par le disque lorsque celui-ci est mis en pause (Broken Light, 1991) ; un trombone abritant un système de traitement du signal bricolé à partir d’une réverb digitale et d’une carte mère de Commodore 64 (Tobabo Fonio, 1986) ; ou encore des circuits électroniques hors d’usage qui se trouvent « réanimés », le temps d’une performance, par des sondes créant des jeux de feedbacks avec d’autres composants électroniques (Salvage, 2008). Il est également l’auteur d’un ouvrage de référence, Handmade Electronic Music : The Art of Hardware Hacking (Routledge, 2009), véritable manuel d’introduction au monde du hacking musical. Marion Henry : Marion Henry est doctorante en co-tutelle au Centre d’Histoire de Sciences Po (CHSP) (Paris) et au Scottish Oral History Centre (SOHC) de l’Université de Strathclyde (Glasgow). Son travail de thèse, dirigé conjointement par Paul-André Rosental et Arthur McIvor, 16 1 Christophe Levaux : Christophe Levaux est docteur en musicologie de l’Université de Liège et Chargé de recherches F.R.S.-FNRS. Sa recherche croise les approches de la théorie de l’acteur réseau et de l’histoire de la musique expérimentale et populaire du XX e siècle. Il a publié sur le sujet dans les revues Tacet, Rock Music Studies ou Organised Sound et a édité avec Olivier Julien un ouvrage consacré à la répétition dans les musiques populaires chez Bloomsbury Academics en 2018. Sa thèse de doctorat, « We Have Always Been Minimalist », sera publiée aux University of California Press en 2020. Denis-Constant Martin : DenisConstant Martin, docteur ès-Lettres, aujourd’hui à la retraite, effectua, après avoir suivi des études de socio-anthropologie et de politologie, une carrière de chercheur à la Fondation nationale des sciences politiques de 1968 à 2015 (CERI, Centre de recherches internationales, Sciences-Po Paris, puis, LAM, Les Afriques dans le monde, Sciences Po Bordeaux, laboratoire auquel il est toujours associé). Il a enseigné notamment à Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, Paris 1 et Paris 8. À partir de travaux de terrain en Afrique orientale et australe ainsi que dans les Caraïbes du Commonwealth, il s’est attaché à explorer les rapports entre culture et politique dans une perspective comparatiste, ce qui l’a conduit à s’intéresser, notamment, aux problèmes de construction et d’expression des identités en politique ainsi qu’aux relations entre fêtes, musiques populaires et représentations politiques. Dans le cadre de ce travail, il a contribué à la réflexion théorique et méthodologique sur la sociologie des musiques populaires. Il est membre de la Société française d’ethnomusicologie. Eva Nicolas : Eva Nicolas est en doctorat de sciences de gestion au LEMNA, à l’IAE de l’Université de Nantes. Elle prépare une thèse, sous la direction de Nathalie Schieb-Bienfait, Sandrine Emin et Gérôme Guibert, portant sur les modalités de l’action collective au sein du phénomène de patrimonialisation des musiques populaires en France. Nicolas Nova : Nicolas Nova est enseignant et chercheur à la Haute École d’Art et de Design (HEAD), Genève. Marilou Polymeropoulou : Marilou Polymeropoulou est chercheuse affiliée à la School of Anthropology and Museum Ethnography à l’Université d’Oxford, membre de la Higher Education Academy ; elle enseigne la sociologie et l’anthropologie au Oxford Sixth Form College. Elle a rédigé sa thèse sur la créativité dans la chipmusic à l’Université d’Oxford en tant que titulaire de la bourse de la Greek State Scholarships Foundation. Elle a reçu plusieurs distinctions académiques (O’Reilly Media, RMA, BFE, St. Peter’s College, Hebrew and Jewish Studies Unit Management Committee) ; ses recherches ont été publiées dans des revues à comité de lecture. Ses recherches Biographies des auteurs porte sur les brass bands au sein des bassins miniers britanniques entre 1945 et 1984. Dernière publication : « Les usages politiques et formes de politisation des cultures minières britanniques (1945 – début des années 1960) : le cas des brass bands », Cahiers Jaurès, 2018/4, no 230, p. 91-107. 193 portent essentiellement sur la chipmusic et la chipscene, qu’elle étudie à l’aide de méthodes ethnographiques et des outils de l’analyse des réseaux sociaux. Actuellement, il travaille sur la circulation des genres musicaux, les pratiques d’écoute musicale et l’inscription des mondes musicaux dans la ville. Stéphane Resche : Stéphane Resche est agrégé d’italien et docteur (Paris Ouest Nanterre/Roma Tre/Université FrancoItalienne). Membre associé du laboratoire IMAGER (EA 3958, Paris-Est Créteil) et du Laboratorio (EA 4590, Toulouse), il questionne ce qui peut relever de la dramaturgie sonore et, plus généralement, de l’intermédialité. Ses recherches portent actuellement sur l’image de l’espace méditerranéen et européen dans la chanson internationale et la dramaturgie contemporaine. Il intervient par ailleurs régulièrement en qualité de dramaturge, comédien, traducteur et metteur en scène. Michael Spanu : Michael Spanu est docteur de l’université de Lorraine. Sa thèse de sociologie porte sur la pratique des langues chantées dans les musiques populaires en France. Il a coordonné le numéro “Avec ma gueule de métèque” de la revue Volume! La revue des musiques populaires et dirige le prix jeunes chercheurs de la branche francophone de l’International Association for the Study of Popular Music (IASPM). Il travaille également comme chercheur indépendant avec des organismes professionnels comme le Live DMA et la Fédération nationale des cafés-cultures (Barbars). Ses recherches actuelles portent sur la transition numérique de la musique live et sur le développement de la vie nocturne en milieu urbain. Biographies des auteurs François Ribac : François Ribac est compositeur et enseignant chercheur à l’université de Dijon. Il est membre du laboratoire CIMEOS. Il a été responsable éditorial de Simon Frith, une sociologie des musiques populaires, Dijon/Paris, Petite collection du Labex Arts H2H / Les presses du réel, 2018. 194 Loic Riom : Loïc Riom est membre de l’Institut de recherches sociologiques de l’Université de Genève. Ses domaines d’expertise sont la ville et la culture. Gabriele Stera : Gabriele Stera est chercheur indépendant, artiste sonore, traducteur et poète, actif en Italie et en France. Il travaille au croisement des sound-studies, de la philosophie de la technique et des langages expérimentaux. Ses recherches sont actuellement centrées autour de l’archéologie des média sonores, des musiques bruitistes et des formes d’écriture hors du livre. Le catalogue des éditions Seteun Collection Musique et société Denis-Contant Martin, Quand le rap sort de sa bulle. Sociologie politique d’un succés. - Mai 2010 • 18 € • 192 p. • Préface de J.-J. Nattiez Sous la direction de Paul Edwards, Élodie Grossi et Paul Schor, Disorder. Histoire sociale des mouvements punk et post-punk - Octobre 2019 • 20 € • 406 p. Hervé Glevarec et Michel Pinet, La radio et ses publics. Sociologie d’une fragmentation - Mai 2009 • 20 € • 256 p. Elsa Grassy & Jedediah Sklower, Politiques des musiques populaires au XXIe siècle - Février 2016 • 15 € • 237 p. Hugh Dauncey et Philippe Le Guern, Stéréo. Sociologie comparée des musiques populaires France-Angleterre - Novembre 2008 • 20 € • 272 p. Stéphane Dorin, Sound Factory. Musique et logiques de l’industrialisation. - Septembre 2012 • 16 € • 168 p. 15 2 Fabien Hein, Le monde du rock. Ethnographie du réel - Mars 2006 • 20 € • 368 p Anne Petiau, Technomedia. Jeunes, musique et blogosphère. - Mars 2011 • 14 € • 140 p. Toujours disponibles dans la collection « Musique et société »... Gérôme Guibert, La production de la culture. Le cas des musiques amplifiées en France. Genèses, structurations, industries, alternatives. - Mars 2006 • 20 € • 560 p. Fabien Hein, Hard rock, heavy metal, metal. Histoire, cultures et pratiquants, Septembre 2004 • 15 € • 320 p. Yasmine Carlet (2004), Stand Down Margaret. L’engagement de la musique populaire britannique contre les gouvernements Thatcher , Avril 2004 • 10 € • 112 p. • hors coédition Sandy Queudrus, Un maquis techno. Modes d’engagement et pratiques sociales dans la free-party, Septembre 2004 • 12,20 € • 120 p. Stéphane Malfettes, Les mots distordus. Ce que les musiques actuelles font de la littérature, Octobre 2000 • 12,20 €, 122 p. Achat en ligne sur www.lespressesdureel.com Diffusion / distibution : Les presses du réel 195 Volume ! n° 16 (1) Musique et HackingNovembre 2019 • 19 € • 196 p. Volume ! n° 15 (1) Varia Décembre 2018 • 19 € • 196 p. Volume ! n° 15 (2) Paradoxal Metal : Entre pratiques ordinaires et représentations transgressives Juin 2019 • 19 € • 176 p. Volume ! n° 14 (2) Watching Music : Cultures du clip musical Avril 2018 • 19 € • 292 p. Volume ! n° 14 (1) Varia Décembre 2017 • 19 € • 252 p. Volume ! n° 8 (1), Peut-on parler de musique noire ? - Mai 2011 • 19 € • 330 p. Volume ! n° 13 (2) Inna Jamaican Stylee Avril 2017 • 19 € • 238 p. Volume ! n° 7 (2), La reprise BIS - Octobre 2010 • 19 € • 254 p. Volume ! n° 13 (1) La scène punk en France - 1976-2016 - Décembre 2016 • 19 € • 208 p. Volume ! n° 6 (1/2), numéro double Géographie, musique et postcolonialisme - Septembre 2008 • numéro double • 20 € • 292 p. (épuisé) Volume ! n° 7 (1), La reprise - Juin 2010 • 19 € • 300 p. Volume ! n° 12 (2) Beatles Studies Special Issue - Mars 2016 • 19 € • 242 p. Volume ! n° 5 (2), Les scènes Metal - Août 2007 • 15 € • 230 p. Volume ! n° 12 (1) Avec ma gueule de métèque - Octobre 2015 • 19 € • 197 p. Volume ! n° 5 (1), La presse musicale alternative - Octobre 2006 • 12,50 € • 164 p. Volume ! n° 11 (2) Varia - Juin 2015 • 19 € • 198 p Volume ! n° 4 (2), Musiques actuelles : un pas de côté ? Février 2006 • 12,50 € • 136 p. Volume ! n° 11 (1) Souvenirs, souvenirs. La nostalgie dans les musiques populaires - Décembre 2014 • 19 € • 229 p. Volume ! n° 4 (1), Musiciens sociologues : les enjeux de la réflexivité - Septembre 2005 • 12,50 € • 176 p. Volume ! n° 10 (2) Composer avec le monde. Fabrique des musiques et régimes d’autorité - Juin 2014 • 19 € • 266 p. Volume ! n° 3 (2), Sonorités du hip-hop. Logiques globales et hexagonales - Mars 2005 • 12,50 € • 180 p. Volume ! n° 10 (1) Écoutes - Décembre 2013 • 19 € • 330 p. Volume ! n° 3 (1), Savant et Populaire - Juin 2004 • 12,50 € • 126 p. Volume ! n° 9 (2), Contre-cultures II - Mai 2013 • 19 € • 258 p. Volume ! n° 9 (1), Contre-cultures I - Octobre 2012 • 19 € • 226 p. Volume ! n° 2 (2), French Popular Music. Colloque de Manchester (2003) - Mars 2004 • 12,50 € • 164 p. Volume ! n° 8 (2), Sex sells, Blackness too ? - Décembre 2012 • 19 € • 300 p. 1 an (2 numéros) France particuliers étranger 35€ associations 50€ institutionnels 100€ Volume ! hors-série, Rock & Cinéma, Août 2004 • 15 € • 138 p 50€ } Collection complète + abonnement 2020 200€ France étranger particuliers 470 € 650 € institutionnels / associations 800 € 1 100 € Pour toute souscritpion contacter : editions@seteun.net 196 Pour les intsitutionnels possibilité de passer via l'Ebsco : volume@fr.ebsco.com, +33(0)1 4096 47 00 & présentent THE JOINT VENTURE ! Sur la base d’une affinité élective éprouvée, les revues Audimat et Volume ! proposent désormais aux particuliers un abonnement couplé pour les deux titres. Il vous suffit de régler en une seule fois la somme de 50 euros pour recevoir les 2 titres annuels de Audimat et les 2 titres annuels de Volume ! Cet abonnement couplé est directement géré par la revue Audimat. Rendez-vous sur : http://revue-audimat.fr/abonnement/