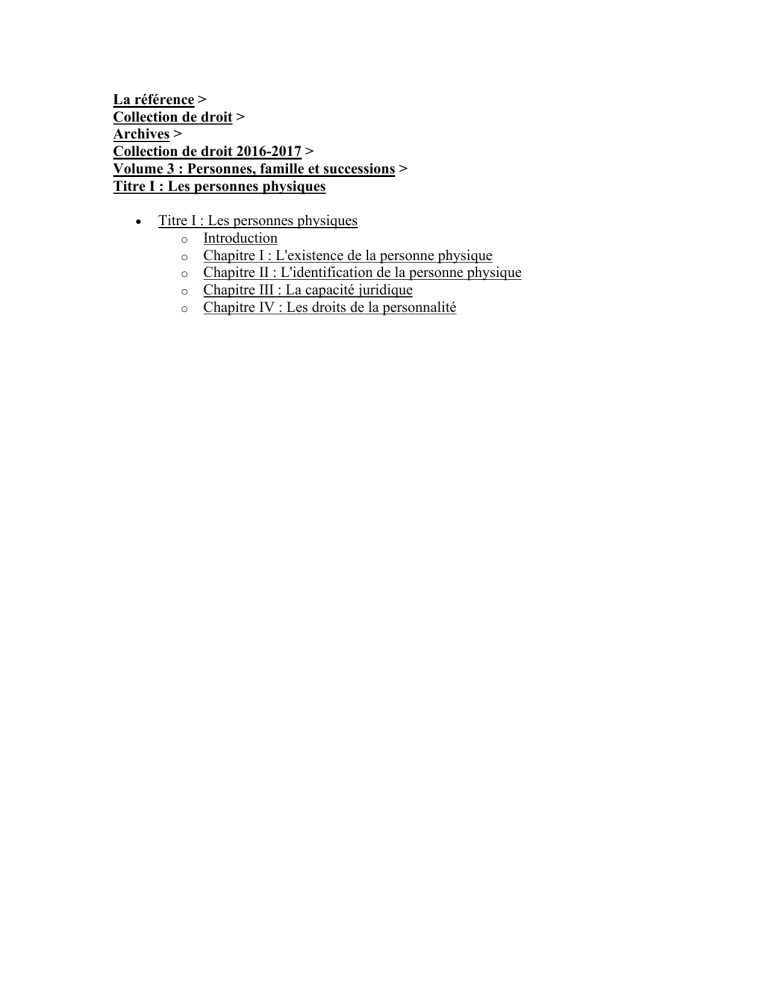
La référence > Collection de droit > Archives > Collection de droit 2016-2017 > Volume 3 : Personnes, famille et successions > Titre I : Les personnes physiques • Titre I : Les personnes physiques o Introduction o Chapitre I : L'existence de la personne physique o Chapitre II : L'identification de la personne physique o Chapitre III : La capacité juridique o Chapitre IV : Les droits de la personnalité Les personnes physiques – Introduction Sylvain BOURASSA EYB2016CDD44 Personnes, famille et successions, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 3, 2016 Sylvain BOURASSA* Les personnes physiques – Introduction Indexation Personnes ; personnes physiques Après la disposition préliminaire, le Code civil du Québec s'ouvre sur le livre « Des personnes ». Cette place de choix démontre l'importance accordée par le Code Civil du Québec à la personne. La personne est passée d'entité nécessaire aux rapports de droit à une entité qui est devenue le centre du droit civil et qui a, dans cet esprit, un double rôle, celui de servir de concept opératoire, comme elle le faisait sous l'égide du Code civil du Bas-Canada et celui d'affirmer sa valeur fondamentale dans l'ensemble du droit par la reconnaissance de sa place dans le droit commun. On doit d'abord cette évolution à l'oeuvre de la jurisprudence qui s'est fréquemment servie des règles de la responsabilité civile afin de protéger la personne dans son essence1, en protégeant certains aspects de sa personnalité, et à l'intégration de la valeur donnée à la personne humaine par l'ordre international, valeur transposée dans différents textes internationaux qui visent à protéger les droits et libertés de la personne humaine dans un contexte plus large2. On ne saurait passer sous silence le rôle qu'a joué la doctrine dans la reconnaissance de la place de la personne et du besoin de la protéger, d'abord malgré elle, puis, par l'exercice de son autonomie. C'est avec la Charte des droits et libertés de la personne en 1976 et le Code civil du Québec en 1994 que la personne a reçu, comme entité autonome, une protection formelle et que le domaine de protection de ses droits a été systématisé. Le rôle central de la personne est de plus précisé par la disposition préliminaire du Code civil du Québec qui rattache le domaine d'application du code à celui de la Charte des droits et libertés de la personne. Cette disposition préliminaire n'a toutefois pas pour seul objectif d'affirmer l'importance de la personne dans le droit. Elle nous rappelle, d'abord et avant tout, la place du Code civil du Québec comme source du droit civil, avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit qui en inspirent les dispositions. Elle réitère aussi la primauté de la Charte sur l'ensemble des lois québécoises, y compris le Code civil3. L'interaction entre la Charte et le code est toutefois particulière, compte tenu de la nature du Code civil, constitutif du droit commun du Québec. Contrairement au rapport de la Charte avec l'ensemble des autres lois québécoises, il existe, entre le code et la Charte, un rapport de complémentarité qui sert de fondement aux règles établies dans les autres lois4. Ainsi, leur interaction s'analyse non pas en fonction de l'identification des droits que chacun des textes établit, mais en fonction de leur rôle dans la protection de ces droits. La Charte, source directe des droits protecteurs de la personnalité, établit les principes généraux qui réglementent la protection de la personne et accorde, aux droits énumérés à ses articles 1 à 9, le caractère de droits fondamentaux. Le Code civil confirme l'existence de ces droits et Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 1 Les personnes physiques – Introduction Sylvain BOURASSA consolide les principes établis par la Charte, tout en en aménageant la portée et l'exercice, consacrant, dans certains cas, les interprétations jurisprudentielles qui ont été dégagées au fil des années sous l'empire de la Charte ou par l'application des règles de la responsabilité civile. Le Code civil devient, par l'intégration dans son corpus des droits protecteurs de la personnalité, la source principale de cette protection dans les rapports de droit privé, par le rôle qui lui est donné : celui de servir d'outil interprétatif des autres lois et d'en combler les lacunes5. Nous aborderons donc le domaine du droit des personnes physiques suivant une approche qui tient compte du Code civil comme élément central, en divisant la matière en quatre blocs qui comprennent l'ensemble des éléments constitutifs de la personne telle qu'elle est vue par le droit6 : 1o l'existence de la personne physique ; 2o son identification ; 3o sa capacité d'être et d'agir ; 4o ses attributs. 1. Voir Madeleine CARON, « Le Code civil québécois, instrument de protection des droits et libertés de la personne ? », (1978) 56 R. du B. can. 197. e 2. Voir par exemple, Déclaration universelle des droits de l'homme, Doc. off., A.G., 3 session, première partie, résolution 217A (III), p. 71, Doc. N.U., A/810 (1948) ; Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Nations-Unies, Recueil des traités, vol. 2123 (1955), p. 221. 3. Voir entre autres, sur le caractère quasi constitutionnel de la Charte et son champ d'application, André MOREL, « La Charte québécoise : un document unique dans l'histoire législative canadienne », dans De la Charte québécoise des droits et libertés : origine, nature et défis, Montréal, Thémis, 1989, p. 1 ; Jacques-Yvan MORIN, « La constitutionnalisation progressive de la Charte des droits et libertés de la personne », dans De la Charte québécoise des droits et libertés : origine, nature et défis, Montréal, Thémis, 1989, p. 27. 4. Voir généralement sur le rapport entre le Code civil et la Charte, Alain-François BISSON, « Nouveau Code civil et jalons pour l'interprétation : traditions et transitions », (1992) 23 R.D.U.S. 1 ; Jean-Maurice BRISSON, « Le Code civil, droit commun ? », dans JOURNÉES MAXIMILIEN-CARON 1992, Le nouveau Code civil, interprétation et application, Montréal, Thémis, 1993, p. 309. 5. Voir J.-M. BRISSON, loc. cit., note 4. 6. Certains aspects de la présentation de la matière s'appliquent à la fois aux personnes morales. Le texte se limite toutefois au domaine des personnes physiques. L'analyse des notions d'abus de droit, de bonne foi et d'ordre public est exclue, malgré leur place dans le livre des personnes. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 2 L'existence de la personne physique Sylvain BOURASSA EYB2016CDD104 Personnes, famille et successions, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 3, 2016 Sylvain BOURASSA* L'existence de la personne physique Indexation Personnes ; personnes physiques ; jouissance des droits civils ; absence et décès TABLE DES MATIÈRES 1- L'acquisition de la personnalité juridique 2- La perte de la personnalité juridique 3- L'absence et la disparition Qu'est-ce que la personne ? La personne, c'est l'être ou l'entité à laquelle la loi accorde la personnalité juridique, c'est-à-dire l'aptitude générale à être sujet de droit, à jouir de ses droits civils. Par cette reconnaissance, la loi donne à cette entité la vocation d'être titulaire de droits. Cette aptitude générale à jouir des droits civils constitue l'essence même de la personnalité juridique. Ainsi, toute dénégation complète de la capacité de jouissance des droits civils équivaudrait à une négation de la personnalité juridique. Dans le cas de la personne physique, l'être humain est l'entité par laquelle on reconnaît la personnalité juridique. « Tout être humain possède la personnalité juridique ; il a la pleine jouissance de ses droits civils » (art. 1 de la Charte québécoise et art. 1 C.c.Q.). On aurait tendance à croire que la personne physique est l'être humain tel qu'on l'entend selon le sens courant des mots. Toutefois, la personne physique vue par le droit ne correspond pas nécessairement à cette notion de l'être humain, mais plutôt à ce que le droit admet par ses règles comme étant la personne physique. C'est « l'être humain, tel qu'il est pris en considération par le droit »1. Le droit rattache la personnalité juridique à l'existence de la personne humaine en se contentant de saisir deux extrêmes comme points de repère de l'acquisition et de la perte de la personnalité juridique : la naissance et la mort. 1- L'acquisition de la personnalité juridique L'acquisition de la personnalité juridique se rattache à l'existence de l'être humain (art. 1 de la Charte québécoise et art. 1 C.c.Q.). La détermination du moment à partir duquel l'être humain existe n'est toutefois pas si évidente. La notion d'être humain est parfois considérée comme une notion floue. Elle peut référer à l'appartenance à l'espèce humaine, tout comme au fait d'exister biologiquement ou Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 1 L'existence de la personne physique Sylvain BOURASSA encore, comme un agent moral. Les interprétations possibles sont multiples, ne serait-ce qu'en raison de la complexité des notions d'existence et d'humanité. Toutefois, les tribunaux fixent le début de l'existence à la naissance de l'enfant2, dans la mesure où l'enfant naît vivant et viable. Cette double condition découle d'une interprétation de l'article 608 C.c.B.-C., repris par l'article 617 C.c.Q. portant sur les qualités requises pour succéder. La condition de naissance vivante et viable est reprise en matière de donation par contrat de mariage (art. 1840 C.c.Q.) et en droit des assurances (art. 2447 C.c.Q.). La condition de naissance vivante sera considérée parfaite si l'être humain a respiré complètement, s'il a la capacité d'avoir une vie autonome de celle de sa mère, ce qui n'exclut pas qu'il puisse requérir des soins médicaux. Quant à la condition de viabilité, elle fait appel à son potentiel de survivre. Ce potentiel se détermine par expertise médicale. La viabilité est toutefois présumée lorsque l'être humain naît vivant. Il appartient alors à la personne qui conteste la viabilité de faire la preuve de la nonviabilité3. Une fois la personnalité juridique acquise, elle rétroagit par l'effet d'une fiction. C'est l'application de la maxime Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur qui signifie « [L']enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il s'agit de ses intérêts » 4. La maxime s'applique notamment dans les cas de successions (art. 617 C.c.Q.), de substitutions (art. 1239 et 1242 C.c.Q.), de donations (art. 439, 1814 et 1840 C.c.Q.) et de bénéfices d'assurances (art. 2447 C.c.Q.). Cette fiction a été reconnue comme étant d'application générale en droit civil par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Montreal Tramways Co. c. Léveillé 5. La cour a d'ailleurs confirmé la portée de cette fiction, tout en la rattachant à la condition de naissance vivante et viable dans l'affaire Tremblay c. Daigle6. En affirmant l'application générale de la fiction à l'ensemble des intérêts de l'enfant conçu, l'enfant né vivant et viable aura donc la pleine jouissance de ses droits civils dès la naissance, ainsi que le bénéfice de ceux nés avant celle-ci, que ceux-ci résultent d'une atteinte à un droit patrimonial ou extrapatrimonial. Par ailleurs, avant sa naissance, outre ses intérêts patrimoniaux, le foetus ne bénéficie d'aucune protection. C'est ce qui ressort de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Tremblay c. Daigle7 et appliquée à ce jour par les tribunaux et ce, malgré les différences d'opinion qui réapparaissent régulièrement et périodiquement dans les débats sociaux et politiques. 2- La perte de la personnalité juridique L'anéantissement de la personnalité juridique survient avec la mort. Cette règle ne souffre que de deux exceptions, soit en cas d'absence et de disparition où, à partir d'une présomption de décès, un jugement déclaratif de décès peut être prononcé. Cette règle simple dans son énoncé devient plus périlleuse dans son application. Le droit ne définit pas la mort ; il s'en sert comme un fait déclencheur qui emporte plusieurs effets dont la disparition des droits de la personnalité du défunt, l'ouverture de la succession et la saisine des héritiers (art. 613 et 625 C.c.Q.), l'exigibilité des bénéfices d'assurance-vie (art. 2436 C.c.Q.), ou encore la dissolution du régime matrimonial (art. 465 (1) C.c.Q.). Le plus important des effets demeure toutefois la perte de la personnalité juridique. Tout comme dans le cas de l'acquisition de la personnalité juridique, la perte de la personnalité juridique a aussi sa zone grise qui soulève le statut d'une entité à caractère humain : celle de la « personne » dont la vie est artificiellement maintenue. L'établissement de la mort et ses critères de détermination ont alors un rôle central que ce soit en ce qui a trait à la cessation de traitement ou encore à l'utilisation du corps de cette personne. Le droit s'en remet alors à la science quant aux critères de Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 2 L'existence de la personne physique Sylvain BOURASSA détermination de la mort. L'établissement de la mort se rapporte à sa détermination physique liée à la perte irréversible des fonctions cérébrales de la personne. Cette perte des fonctions cérébrales peut être déterminée par l'absence prolongée des fonctions cardiaques et respiratoires spontanées. Toutefois, lorsque la personne est maintenue en vie au moyen de supports artificiels, cette observation ne peut être faite. La détermination se fait alors par la constatation de l'irréversibilité de toutes les fonctions du cerveau, incluant le tronc cérébral, par des moyens cliniques reconnus8. Une fois le diagnostic de mort fait par une personne autorisée, il appartient à cette personne d'en dresser le constat. Avant que ce constat ne soit dressé, la « personne » demeure une « personne juridique » avec tout ce que cette qualification implique. 3- L'absence et la disparition Entre la naissance et la mort, se situe des états incertains quant à la personnalité juridique de la personne. Il s'agit de l'absence et de la disparition. La notion d'absence fait appel à trois éléments : la personne doit avoir eu son domicile au Québec, elle doit avoir cessé d'y paraître sans donner de nouvelles et on ne doit pas savoir si elle est vivante ou morte (art. 84 C.c.Q.). Ce dernier élément revêt toute son importance puisque la simple non-présence dans un lieu ne correspond pas à la notion juridique d'absence. Par ailleurs, la disparition fait référence à la situation où une personne a été exposée à un danger de mort, sans qu'on puisse tenir son décès pour certain. Il est alors impossible d'en dresser un constat, soit par défaut de représentation du cadavre, soit parce que celui-ci n'est pas identifiable (art. 92, al. 2 C.c.Q.). Dans les deux situations, le droit considère, par le jeu d'une présomption, que la personne concernée est décédée. Dans le cas de l'absence, la présomption ne joue que s'il s'est écoulé sept ans9 depuis que la personne a cessé de paraître à son domicile sans nouvelles (art. 92 C.c.Q.). Dans le cas de la disparition, le délai peut être raccourci lorsque la mort peut être tenue pour certaine (art. 92 C.c.Q.). Dans l'un ou l'autre des cas, un jugement déclaratif de décès peut être prononcé si des indices graves, précis et concordants permettent de conclure au décès. Celui-ci produit alors les mêmes effets que le décès (art. 95 C.c.Q.). Il est fixé à l'expiration du délai de sept ans, dans le cas de l'absence et plus tôt dans le cas de la disparition, suivant les circonstances de celle-ci (art. 94 C.c.Q.). Notons que, s'il y a retour, les effets du jugement déclaratif de décès cessent. La personne doit toutefois demander au tribunal l'annulation du jugement (art. 97 et s. C.c.Q.). L'existence de la personne physique commence donc par la naissance, début de l'aventure périlleuse de la vie juridique, et se termine par la mort, constatée ou prononcée, point final de la jouissance de ses droits civils. Ce début et cette fin ne signifient pas pour autant qu'aucun respect n'est dû à ce qui pourrait devenir une personne au sens du droit ou à ce qui en fut une10 . Le droit prévoit plusieurs règles qui visent le respect de la valeur de ce qui se rapporte à l'humain. Ne pas admettre dans le domaine de la personnalité juridique une étape de l'évolution de la personne biologique ne signifie pas que celle-ci est dépourvue de protection (par exemple, art. 42 et s. C.c.Q.). e * L'auteur remercie M Julie Baril de la Direction des affaires juridiques du TAQ pour sa collaboration à la révision de ce Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 3 L'existence de la personne physique Sylvain BOURASSA e texte. Ce texte a été initialement rédigé par M France Allard. e o 1. Jean CARBONNIER, Droit civil. Les personnes, 20 éd., Paris, P.U.F., 1996, n 3, p. 15. 2. Voir Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, EYB 1989-67833. 3. Allard c. Monette, (1928) 66 C.S. 291. e 4. Albert MAYRAND, Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, 3 éd., Cowansville, Éditions Yvon o Blais, 1994, v infans conceptus, p. 193. 5. [1933] R.C.S. 456, p. 465. 6. Précitée, note 2. 7. Ibid. 8. Cette constatation s'effectue par l'évaluation d'un ensemble de signes afin d'affirmer l'irréversibilité des lésions cérébrales. 9. Affaire de Renda, EYB 2013-216890 (C.S.), 22 janvier 2013. 10. Comtois c. Comtois, 2013 QCCA 247, EYB 2013-217922. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 4 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA EYB2016CDD105 Personnes, famille et successions, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 3, 2016 Sylvain BOURASSA* L'identification de la personne physique Indexation Personnes ; personnes physiques ; nom ; attribution ; changement par voie judiciaire ; compétence du tribunal ; changement dans la filiation ; abandon ; déchéance de l'autorité parentale ; changement par voie administrative ; motif sérieux ; changement de la mention du sexe ; domicile ; registre et actes de l'état civil ; acte de naissance ; acte de mariage ; acte de décès ; acte d'union civile ; modification du registre TABLE DES MATIÈRES 1- Le nom A- L'attribution du nom B- Le changement de nom 1. Le changement de nom par voie judiciaire 2. Le changement de nom par voie administrative 2- Le sexe 3- Le domicile 4- L'état civil A- Les actes de l'état civil 1. L'acte de naissance 2. L'acte de mariage 3. L'acte d'union civile 4. L'acte de décès B- La modification du registre de l'état civil 1. La modification à la suite d'une décision du tribunal 2. La modification à la suite d'une décision du directeur de l'état civil L'identification de la personne physique se compose de divers signes qui servent à distinguer les personnes les unes des autres. Il s'agit du nom, de la filiation1, du sexe, du domicile et de l'état civil. 1- Le nom Le nom est le premier élément de l'identification de la personne. Il sert à « identifier la personne dans la société et constitue ainsi un facteur d'ordre » 2. La personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 1 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA est attribué et qui est constaté dans son acte de naissance (art. 5 C.c.Q.). Elle ne peut utiliser un diminutif3. Celle qui exerce ses droits civils sous un nom autre que le sien sera tenue responsable de la confusion ou du préjudice qui peut en résulter (art. 56 C.c.Q.). Pour ces raisons, la stabilité du nom revêt une grande importance. A- L'attribution du nom Le nom se compose du nom de famille et des prénoms. Il est généralement attribué par les parents et, dans certains cas, par le directeur de l'état civil. En principe, le nom d'une personne lui est attribué à la naissance par ses père et mère et est énoncé dans l'acte de naissance (art. 50 et 51 C.c.Q.). Il doit être composé d'un seul nom de famille et d'un ou plusieurs prénoms (art. 51 C.c.Q.). Le nom de famille de l'enfant ne peut être composé de plus de deux parties4 provenant des noms de famille de ses parents (art. 51 C.c.Q.). L'initiale peut être considérée comme un prénom5, mais le prénom d'un parent ne peut servir de nom de famille de l'enfant6. Le Code civil établit toutefois une distinction quant au choix du nom de famille attribué à l'enfant. L'enfant ne pourra porter le nom de famille de l'un de ses parents que dans la mesure où la filiation à l'égard de ce parent est établie (art. 51 et 53 C.c.Q.). En ce sens, le nom correspond à une reconnaissance de la filiation d'une personne et en constitue un effet (art. 51, 54, 114 et 115 C.c.Q.). Il convient toutefois de noter qu'en matière d'adoption, l'enfant pourra, à la suite du placement qui précède l'adoption, porter, dans l'exercice de ses droits civils, le nom que lui attribue l'adoptant, alors que le lien de filiation adoptive n'a pas encore été créé (art. 569, al. 1 C.c.Q.). Malgré ce lien nécessaire entre le nom et la filiation, le lien entre les enfants d'une même famille n'est pas toujours évident, le nom de famille pouvant varier entre chacun compte tenu des choix qui sont offerts aux parents. Les noms choisis par les père et mère ne sont malheureusement pas toujours heureux. Lorsque les noms portent manifestement au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l'enfant7, le directeur de l'état civil peut inviter les parents à modifier le nom de l'enfant. En cas de refus de ceux-ci, il dresse néanmoins l'acte de naissance et en avise le Procureur général du Québec, qui peut saisir le tribunal de cette opposition afin de demander qu'un autre nom soit attribué à l'enfant (art. 54 C.c.Q.). Un prénom fantaisiste, « c'est un ange », refusé par le directeur de l'état civil, a été accepté par le tribunal, ne s'agissant pas du seul prénom de l'enfant, ni de son prénom principal8. Un prénom inusité, « caresse », a été accepté, par le tribunal. Pour l'enfant élevée dans un milieu anglophone, il est loin d'être manifeste qu'un tel prénom prêtera au ridicule ou sera susceptible de la déconsidérer9. Le droit de ne pas être ridiculisé (i.e. du seul fait que le nom soit difficile à écrire ou à épeler), comme le prévoit l'article 58 C.c.Q., fait partie de la sauvegarde de la dignité humaine10 . Le directeur de l'état civil peut aussi, en cas de désaccord entre les père et mère quant au choix du nom ou lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, attribuer un nom à l'enfant (art. 52 et 53 C.c.Q.). La situation où la filiation n'est pas établie est exceptionnelle. Elle ne vise pas la situation de parents qui ont négligé d'envoyer la déclaration de naissance dans le délai imparti (voir les articles 522 et s. C.c.Q.). D'ailleurs, des frais relatifs à la confection d'un acte de naissance sont prévus lorsque le délai qui se rapporte à la déclaration de naissance n'a pas été respecté11 . Malgré le fait qu'une personne puisse demander un changement de son nom, elle ne peut être contrainte à se voir imposer un changement de nom ; par exemple comme condition à la réception d'un legs testamentaire. Une telle condition est contraire à l'ordre public et constitue une forme d'aliénation d'un droit de la personnalité lequel est incessible12 . Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 2 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA B- Le changement de nom Au-delà de l'attribution du nom, le nom peut être déterminé à la suite d'un changement de nom. Le changement de nom ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal ou du directeur de l'état civil (art. 57 C.c.Q.). On parle alors de changement de nom par voie judiciaire ou par voie administrative. 1. Le changement de nom par voie judiciaire Dans le cas du changement de nom par voie judiciaire, le Code civil du Québec attribue une compétence exclusive au tribunal pour autoriser le changement de nom lorsqu'il y a un changement de filiation, un abandon par le père ou la mère ou une déchéance de l'autorité parentale (art. 65 et s. C.c.Q.)13 . Le changement de nom vise alors à adapter le nom à la réalité de la situation familiale de l'enfant. La demande doit être faite conformément aux dispositions particulières des articles 391 et suivants C.p.c. Elle peut être faite par une personne majeure à titre de tuteur d'un mineur (art. 159 C.c.Q.)14 , ou par le mineur, s'il est âgé de 14 ans et plus (art. 66 C.c.Q.). Lorsque le changement de nom est lié à un changement de filiation, il convient de distinguer entre l'adoption et les contestations ou reconnaissances d'état. Dans le cas de l'adoption, la filiation adoptive remplace la filiation d'origine et fait naître, entre l'adopté et l'adoptant, un lien de droit identique à celui établi par la filiation par le sang (art. 577 et 578 C.c.Q.). L'effet de l'adoption sur l'identification de l'enfant est de transférer aux parents adoptifs la prérogative du choix du nom de l'adopté, à moins que le tribunal ne décide, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, de lui laisser son nom d'origine. Le changement de nom a alors lieu par l'effet du jugement d'adoption (art. 576 C.c.Q.). Toutefois, malgré l'absence de modification formelle de l'état civil de l'enfant avant le jugement d'adoption, l'adopté peut, pendant la durée de l'ordonnance de placement, porter le nom choisi par l'adoptant ; il ne s'agit pas alors d'un véritable changement de nom, mais d'une mesure qui vise à protéger l'identité de l'adopté et la confidentialité de la procédure d'adoption (art. 569, al. 1 C.c.Q.)15 . Dans le cas d'une contestation ou d'une reconnaissance d'état, il y a lieu de distinguer entre la situation où la filiation est déjà établie à l'égard de l'un des parents et celle où elle ne l'est pas16 . Lorsque la filiation est déjà établie à l'égard de l'un des parents, l'enfant porte déjà un nom conforme à sa filiation. La décision portant sur l'ajout d'une particule au nom de l'enfant ou le changement complet du nom de ce dernier devra tenir compte de ce fait et, comme dans tous les cas où une décision concerne un enfant, être prise dans son intérêt17 . Si aucune filiation n'est établie à l'égard de l'un des parents qui réclame la filiation, l'effet du jugement qui accueille la demande en réclamation ou en contestation d'état sera de changer complètement la filiation de l'enfant (art. 532, al. 2 C.c.Q.). Le nom de l'enfant sera alors modifié en fonction de son nouvel état. Dans tous les cas, le changement de nom aura lieu comme conséquence du jugement qui établit la filiation. Dans les cas d'abandon d'enfant ou de déchéance de l'autorité parentale, le changement de nom de l'enfant n'est pas automatique : les deux situations ne sont pas irréversibles et, surtout, n'ont pas pour effet de rompre, entre l'enfant et le parent, le lien de filiation. Le code prévoit en effet la possibilité pour le parent qui a été déchu de son autorité parentale de se la voir restituer, s'il démontre qu'il existe de nouvelles circonstances justifiant la restitution de l'autorité, sous réserve de l'adoption éventuelle de l'enfant (art. 610 C.c.Q.)18 . Il prévoit aussi la possibilité pour les père, mère ou tuteur de renverser, avant l'ordonnance de placement précédant l'adoption, la présomption selon laquelle il est improbable Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 3 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA que ceux-ci reprennent la garde de l'enfant et en assument les soins, l'entretien et l'éducation (art. 559 (2) et 561 C.c.Q.). Le critère déterminant en vue du changement de nom n'est pas, dans ces cas, lié à l'existence ou à l'absence d'une filiation, mais plutôt au seul intérêt de l'enfant, tout en respectant, dans la mesure du possible, le lien de filiation entre l'enfant et ses parents19 . Les tribunaux ont d'ailleurs reconnu l'importance de la stabilité du nom d'un enfant20 . Cependant, ceux-ci ont notamment retenu comme motifs de justification d'un changement de nom, l'absence d'identification avec le parent déchu, le préjudice que pourrait subir l'enfant s'il était identifié au parent déchu, l'intention du nouveau conjoint d'un parent d'adopter l'enfant. De plus, il est possible d'obtenir un changement de nom même si la demande de déchéance de l'autorité parentale est rejetée notamment lorsque l'enfant ne se reconnaît pas dans le nom de famille du parent absent21 . 2. Le changement de nom par voie administrative Le changement de nom par voie administrative est celui qui est autorisé par le directeur de l'état civil. Il peut avoir lieu dans tous les cas autres que ceux de la compétence exclusive du tribunal (art. 58 C.c.Q.). Le changement de nom vise alors à adapter le nom de la personne à sa réalité, à faciliter l'identification de la personne et à protéger sa dignité. La demande est présentée au directeur de l'état civil suivant les modalités prévues au Règlement relatif au changement de nom et d'autres qualités de l'état civil22 . Elle est aussi soumise à des règles de publicité, sauf dispense23 . Seule une personne majeure peut présenter une demande en changement de nom par voie administrative. Elle peut le faire pour elle-même et, s'il s'agit du nom de famille, le faire du même coup pour ses enfants (art. 59 C.c.Q.) ; elle peut aussi le faire à titre de tuteur pour un enfant (art. 60 C.c.Q.). L'enfant mineur de moins de 14 ans, représenté par son tuteur, ou le mineur de 14 ans et plus peuvent s'opposer à toute demande de changement de nom qui les concerne (art. 62 C.c.Q.). Dans tous les cas, la personne qui change de nom doit avoir la citoyenneté canadienne et être domiciliée au Québec depuis au moins un an (art. 59 et 60 C.c.Q.). La personne qui désire changer son nom doit démontrer qu'il existe un motif sérieux de le faire24 ; cette appréciation est laissée au directeur de l'état civil. L'évaluation du motif comme étant sérieux se ferait selon un test objectif, c'est-à-dire, selon ce qu'une personne raisonnable considérerait comme étant un motif sérieux. L'adoption d'un tel test vise à ne pas compromettre le principe de la stabilité du nom. Ce principe est fondamental25 . Ainsi, une demande faite afin de combler une fantaisie ou pour des raisons de convenances ne sera pas admise26 . Le code donne quelques exemples de motifs sérieux : le nom généralement utilisé ne correspond pas à celui qui est inscrit dans l'acte de naissance, le nom est d'origine étrangère ou trop difficile à prononcer ou à écrire dans sa forme originale, le nom prête au ridicule (art. 58 C.c.Q.)27 ou est frappé d'infamie. La notion d'infamie n'est pas clairement circonscrite. Selon une définition courante de l'infamie, on pourrait croire qu'il doit s'agir d'un nom qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne28 , de la stigmatiser, par son association à une autre personne. La liste des motifs prévus au Code civil n'est pas limitative. Une demande de changement de nom pourra par exemple être acceptée lorsque la personne démontre qu'elle a fait un usage public et constant du nom proposé pour une période minimale de cinq ans29 . Cette période de cinq ans n'est pas inscrite au code. Elle a toutefois été reconnue comme une règle non écrite valable30 . Elle permet d'éviter qu'il y ait confusion quant à l'identité de la personne dans l'exercice de ses droits civils et de faire correspondre l'identification officielle à l'identification sociale Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 4 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA de la personne, sans pour autant compromettre le principe du maintien de la stabilité du nom. Le changement de nom peut aussi avoir lieu dans le cas de changement de sexe. Dans ce cas, seul le prénom pourra être changé, à moins que d'autres motifs soient présents (art. 71 C.c.Q.). Il n'est toutefois pas nécessaire de démontrer un motif sérieux lorsque le changement de nom demandé ne vise que l'ajout d'une particule provenant du nom de famille du père ou de la mère, tel qu'il est déclaré dans l'acte de naissance (art. 58, al. 2 C.c.Q.). La décision du directeur de l'état civil sur la demande en changement de nom ne sera rendue que lorsque toutes les étapes de la demande auront été franchies, y compris les avis publiés et les délais écoulés31 . Cette décision est révisable par le tribunal à la demande d'une personne intéressée (art. 74 C.c.Q.). Le seul effet du changement de nom est de modifier l'identification de la personne. Celle-ci conserve les mêmes droits et les mêmes obligations qu'avant le changement (art. 67 et s. C.c.Q.). 2- Le sexe Le sexe, bien qu'il ne soit pas traditionnellement reconnu comme une institution juridique, est un élément incontournable de l'identification d'une personne. Bien qu'il ait longtemps servi à la différenciation des droits entre hommes et femmes, il doit toujours être mentionné, par exemple, dans l'acte de naissance (art. 111, al. 2 C.c.Q.) et l'acte de décès (art. 124 C.c.Q.). La réglementation du code sur le sexe porte sur le changement de la mention du sexe. Elle vise à rendre l'identification officielle de la personne conforme à sa personnalité nouvellement acquise à la suite des modifications structurales de ses organes sexuels. Différentes conditions sont posées afin qu'une personne puisse faire une demande de changement de la mention du sexe aux actes d'état civil. Dans un premier temps, le code prévoit certaines conditions rattachées à la personne : elle doit être majeure, avoir la citoyenneté canadienne et être domiciliée au Québec depuis au moins un an (art. 71, al. 2 C.c.Q.). Dans un deuxième temps, le législateur pose certaines exigences liées à l'état physique de la personne : elle devra avoir « subi avec succès les traitements médicaux et interventions chirurgicales impliquant une modification structurale des organes sexuels, et destinés à changer ses caractères sexuels apparents » (art. 71, al. 1 C.c.Q.). Une preuve médicale devra être fournie à cet effet (art. 72 C.c.Q.). La demande en changement de la mention du sexe est faite au directeur de l'état civil suivant la même procédure que la demande en changement de nom par voie administrative, compte tenu des adaptations nécessaires (art. 73 C.c.Q.)32 . 3- Le domicile Le domicile n'identifie pas la personne de manière aussi personnelle que le nom et le sexe. Toutefois, il sert en principe à localiser juridiquement la personne afin de déterminer sa capacité de jouir de certains droits. Son importance se situe aussi à plusieurs autres niveaux : il sert, par exemple, à déterminer la compétence d'un tribunal (art. 41 et s. C.p.c.), les règles applicables à l'état et à la capacité des personnes (art. 3083, al. 1 C.c.Q.), le lieu où un droit s'ouvre (par exemple, art. 3098, al. 1 C.c.Q.) ou encore le lieu où une obligation s'exécute (par exemple, art. 1566, al. 2 C.c.Q.). Le domicile, contrairement à la résidence, est une question de droit. Il s'apprécie à partir d'un certain nombre de critères. Il correspond à l'endroit où la personne a son principal établissement et a, Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 5 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA contrairement à la résidence, un caractère de continuité et de fixité (art. 75 C.c.Q.), c'est-à-dire, un caractère durable sans requérir la permanence. Il comporte aussi un élément intentionnel central à sa détermination, qui ne correspond pas nécessairement à l'élément factuel de l'habitation. Les articles 76, 79, 82 et 83 C.c.Q. prévoient, dans différentes circonstances, l'importance de l'élément intentionnel par opposition à l'élément matériel. Le critère de l'intérêt primordial rattachant une personne à un lieu donné, de préférence à tout autre, est généralement retenu afin de déterminer le lieu où se situe le principal établissement. On retient, par exemple, comme intérêt de rattachement, la famille, le lieu de travail, l'identification postale pour l'ensemble des activités courantes, la permanence de la résidence à un endroit donné. La preuve d'intention de fixer un domicile à un endroit plutôt qu'à un autre se fait à partir des déclarations de la personne et des circonstances (art. 76, al. 2 C.c.Q.)33 . Les déclarations prises en considération sont le plus généralement contenues dans des actes judiciaires ou extrajudiciaires, des actes de l'état civil, des actes notariés ou sous seing privé. Ces déclarations peuvent toutefois être contredites par une preuve contraire. Quant aux circonstances retenues, elles varient d'une situation à l'autre et sont généralement considérées comme un ensemble de faits qui, pris isolément, pourraient être insuffisants afin d'indiquer une intention d'établir un nouveau domicile. Comme la preuve de l'élément intentionnel dépend d'un nombre considérable de facteurs, le code la facilite par le jeu d'une présomption qui se rattache à la résidence principale, c'est-à-dire là où la personne a fixé le centre de ses intérêts (art. 77 C.c.Q.). Cette présomption s'applique lorsque le domicile ne peut être établi avec certitude ou lorsque l'intention est presque impossible à prouver (art. 78 C.c.Q.). Chaque personne a un domicile et un seul. Cette affirmation peut se déduire des termes de l'article 75 C.c.Q. et est depuis longtemps confirmée par la doctrine34 . Cette unicité du domicile a une fonction pratique qui vise à faciliter la cohérence du système d'identification et de localisation de la personne. Le principe n'est toutefois pas absolu. En effet, le code permet à une personne d'y déroger par une élection de domicile, faite par écrit, dans un acte juridique, aux fins d'exécution de cet acte (art. 83 C.c.Q.). L'élection de domicile est toutefois exclue en matière de contrats de consommation, sauf si elle est faite par acte notarié 35 . Cette élection de domicile ne se présume pas (art. 83, al. 2 C.c.Q.) et est spécifique à l'acte ; elle ne peut être générale36 . On parle alors de domicile élu, spécial ou conventionnel. L'unicité du domicile implique aussi qu'une personne doit avoir quitté, sans esprit de retour, son domicile précédent afin d'acquérir un nouveau domicile. Elle est présumée conserver son domicile tant que ne sont pas rassemblés les éléments matériel et intentionnel du changement (art. 76 C.c.Q.). Il doit alors exister une possibilité de former cette intention qui puisse correspondre à l'élément matériel de l'établissement, quoiqu'il n'y ait pas de durée minimum de résidence requise afin d'établir un domicile37 . Outre l'élément intentionnel qui détermine le domicile, certaines personnes ont un domicile légal, c'est-à-dire un domicile que la loi leur assigne. Il en est ainsi pour le mineur (art. 80 C.c.Q.) et pour la personne majeure en tutelle ou en curatelle (art. 81 C.c.Q.). Il en est de même pour la partie qui a comparu par procureur et qui a quitté le Québec depuis sa comparution ou qui n'a plus de domicile, de résidence ou d'établissement d'entreprise au Québec (art. 128 C.p.c.). Dans tous ces cas, le domicile légal s'établit par rapport au domicile d'une autre personne. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 6 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA 4- L'état civil L'état civil est la « situation d'une personne dans la vie juridique ; son statut civil » 38 . Il est composé d'un ensemble de qualités qui se rattachent étroitement à la personne et auxquelles la loi attache des effets juridiques. L'ensemble des éléments qui servent à identifier la personne sont en fait des éléments de l'état de la personne. Pris individuellement, ils entraînent tous, de façon autonome, des effets juridiques. Ensemble, ils constituent l'état de la personne et la situent vis-à-vis la loi dans un contexte de droit privé. Ces qualités sont des éléments essentiels qui servent à l'établissement des rapports de droit, dont certains sont consignés dans les actes de l'état civil. A- Les actes de l'état civil L'état civil de la personne est consigné dans les actes de l'état civil qui servent à systématiser l'identification de la personne dans le droit. Ces actes sont au nombre de quatre : l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte d'union civile et l'acte de décès (art. 107 C.c.Q.). Ceux-ci sont complétés par des modifications rendues nécessaires à la suite d'un changement dans l'état d'une personne. Les modifications sont notées en marge dans l'acte principal, afin de compléter l'information se rapportant à l'état de la personne. Ces actes sont dressés par le directeur de l'état civil à partir de déclarations, de constats et d'actes juridiques relatifs aux naissances, aux mariages, aux unions civiles et aux décès, qui surviennent au Québec ou qui concernent une personne qui y est domiciliée (art. 108 et s. C.c.Q.). Les déclarations et les constats sont soumis à certaines exigences matérielles communes à tous les actes (art. 110 C.c.Q.). D'autres exigences particulières sont posées, selon la nature de l'acte, quant à l'identité et au rôle des déclarants ou des témoins39 . Les actes sont, par la suite, consignés dans le registre de l'état civil par le directeur de l'état civil40 . L'intérêt d'un tel registre est qu'il contient les actes authentiques qui constatent les principaux événements auxquels le droit attache des effets qui découlent de l'état d'une personne. 1. L'acte de naissance L'acte de naissance marque le début de l'existence de la personne comme entité juridique reconnue ; il en est une constatation formelle. Aussi, il consigne le lien de filiation d'une personne avec une autre. L'acte de naissance est dressé à partir d'un constat de naissance fait par l'accoucheur (art. 108 et 111 C.c.Q.) et d'une déclaration de naissance faite par les père ou mère (art. 113 C.c.Q.). Cette déclaration doit contenir des renseignements déterminés, dont le nom et le sexe de l'enfant, les domiciles des père et mère, ainsi que le lien de parenté du déclarant avec l'enfant (art. 115 C.c.Q.)41 . Lorsque les parents sont de même sexe, ils sont désignés comme les mères ou les pères de l'enfant, selon le cas (art. 115, al. 1 C.c.Q.). Le déclarant ne peut déclarer la filiation de l'enfant qu'à son égard, sauf si la conception ou la naissance de l'enfant a lieu durant le mariage ou l'union civile (art. 114 C.c.Q.). Dans ce cas, l'un des deux conjoints peut déclarer la filiation de l'enfant à l'égard de l'autre. Les parents qui sont conjoints de fait doivent tous les deux signer la déclaration de naissance et déclarer personnellement le lien de filiation qui existe entre eux et leur enfant. Des règles particulières sont prévues lorsque les père et mère de l'enfant sont empêchés d'agir ou s'ils sont inconnus. Dans ces cas, le déclarant sera la personne qui recueille ou garde l'enfant (art. 116 C.c.Q.). L'article 117 C.c.Q. donne au directeur de l'état civil le pouvoir de fixer les lieu, date et heure de la naissance lorsque ceux-ci sont inconnus du déclarant. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 7 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA Dans tous les cas, un délai de trente jours est imposé aux déclarants afin de déclarer la naissance au directeur de l'état civil (art. 113 et 116 C.c.Q.). À défaut de respecter ce délai, le déclarant s'expose au paiement de droits42 . 2. L'acte de mariage L'acte de mariage est dressé à partir d'une déclaration faite par la personne qui célèbre le mariage (art. 118 C.c.Q.). La déclaration doit contenir des renseignements déterminés relatifs aux époux et au mariage. Elle doit aussi mentionner, s'il y a lieu, toute dispense de publication et l'existence des autorisations ou consentements requis (art. 119 et 120 C.c.Q.)43 . Elle doit aussi contenir des renseignements relatifs au célébrant, afin de vérifier la compétence de ce dernier à célébrer le mariage (art. 119, al. 2 C.c.Q.) et être signée par le célébrant, qui est en fait le déclarant, ainsi que par les époux et les témoins (art. 121 C.c.Q.). Le célébrant doit être une personne habilitée par la loi à célébrer le mariage (art. 366 C.c.Q.). 3. L'acte d'union civile L'acte d'union civile a été introduit dans le Code civil du Québec à la suite de la création par le législateur québécois de l'institution que constitue l'union civile44 . L'union civile emporte l'établissement d'une forme d'état civil auquel se rattachent des droits et obligations similaires à ceux qui découlent du mariage (art. 521.1 et s. C.c.Q.)45 . Les dispositions du Code civil du Québec portant sur l'acte d'union civile sont calquées sur celles portant sur l'acte de mariage. L'acte d'union civile est ainsi dressé à partir d'une déclaration faite par la personne qui célèbre l'union civile (art. 121.1 C.c.Q.). La déclaration doit contenir des renseignements déterminés relatifs aux conjoints et à l'union. Elle doit aussi mentionner, s'il y a lieu, toute dispense de publication (art. 121.2 C.c.Q.). Contrairement au mariage toutefois, l'union civile n'est admise qu'entre personnes majeures. Aucun consentement particulier autre que celui des conjoints n'est donc prévu dans les formalités entourant l'union. La déclaration doit également, comme pour le mariage, contenir des renseignements relatifs au célébrant, afin de vérifier sa compétence à célébrer l'union (art. 121.2, al. 2 C.c.Q.). Le célébrant doit être une personne habilitée par la loi à célébrer l'union civile (art. 521.2 C.c.Q., qui doit être complété par l'article 366 C.c.Q., qui prévoit les conditions liées à la compétence du célébrant à célébrer le mariage et, par renvoi, l'union civile). La déclaration doit également être signée par les conjoints, les témoins et le célébrant (art. 121.3 C.c.Q.). 4. L'acte de décès L'acte de décès marque la fin de l'existence de la personne ; il en constitue une constatation formelle. Avec l'acte de naissance, il marque les contours de l'existence juridique. L'acte de décès est dressé à partir d'un constat de décès fait en principe par un médecin (art. 122 et 124 C.c.Q.). En l'absence d'un médecin et lorsqu'il est impossible de faire constater le décès par un médecin dans un délai raisonnable, le constat pourra être dressé par deux agents de la paix, dans les seuls cas où la mort est évidente (art. 123 C.c.Q.)46 . Une déclaration de décès doit aussi être faite. Les personnes qui peuvent déclarer le décès sont énumérées par le code : il s'agit du conjoint du défunt, d'un proche parent, d'un allié ou, à défaut, de toute autre personne capable d'identifier le défunt (art. 125 C.c.Q.). Il convient aussi de souligner que le directeur de funérailles qui prend charge du corps d'un défunt doit aussi faire certaines déclarations (art. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 8 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA 125 C.c.Q.). La déclaration doit contenir des renseignements déterminés dont le nom, le lieu du dernier domicile du défunt, les lieux du décès et de la disposition du corps (art. 126 C.c.Q.)47 . Lorsque le défunt n'est pas identifié, c'est le constat qui contiendra le signalement de la personne et qui décrira les circonstances de la découverte du corps (art. 128 C.c.Q.)48 . Le constat de décès doit être remis par celui qui le constate à la personne tenue de déclarer le décès ainsi qu'au directeur de l'état civil (art. 122, al. 2 C.c.Q.). La déclaration de décès doit être transmise sans délai par le déclarant au directeur de l'état civil, avec une copie du constat de décès (art. 125 et 126 , al. 2 C.c.Q.). L'acte de décès peut aussi être dressé à partir d'un jugement déclaratif de décès prononcé à la suite de la disparition ou de l'absence d'une personne (art. 133 C.c.Q.). B- La modification du registre de l'état civil La modification du registre de l'état civil peut avoir lieu, selon le cas, à la suite d'une décision du tribunal ou d'une décision du directeur de l'état civil. 1. La modification à la suite d'une décision du tribunal Le registre de l'état civil peut être modifié à la suite d'une décision du tribunal sur autorisation de celui-ci ou à la suite d'une notification, au directeur de l'état civil, d'un jugement qui a pour effet de changer le nom d'une personne ou une mention à l'un des actes de l'état civil. L'autorisation du tribunal est nécessaire dans tous les cas où il existe, entre le constat et la déclaration exigés pour la confection d'un acte de l'état civil, une contradiction qui porte sur l'identité ou la filiation, considérés comme des éléments essentiels à l'établissement de l'état d'une personne (art. 131 et 132 C.c.Q.). Dans les autres cas, dès que le jugement qui autorise une modification acquiert l'autorité de la chose jugée, le directeur de l'état civil doit en être avisé par le greffier du tribunal qui l'a rendu afin que les modifications nécessaires soient apportées au registre de l'état civil (art. 129 C.c.Q.). Lorsque le jugement porte sur un changement d'un élément essentiel de l'état civil tel le nom ou la filiation, un nouvel acte doit être dressé par le directeur de l'état civil, à la demande d'une personne intéressée (art. 132 C.c.Q.). Lorsqu'il s'agit d'un jugement déclaratif de décès dont le directeur de l'état civil a reçu avis suivant les exigences de l'article 133 C.c.Q., le jugement emporte confection de l'acte de décès, acte primitif, par opposition aux cas prévus à l'article 132 C.c.Q. Certains jugements, bien qu'ils se rapportent à une qualité essentielle de l'état d'une personne, modifient cet état sans toutefois qu'il ne soit nécessaire de dresser un nouvel acte. Il s'agit des jugements en divorce, en dissolution d'une union civile, en nullité de mariage ou d'union civile et en annulation d'un jugement déclaratif de décès. S'ajoute à ces différents jugements la déclaration commune notariée de dissolution d'une union civile (art. 135 C.c.Q.). Dans le cas du jugement en divorce, les modifications seront portées en marge sur l'exemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de chacune des parties. Il en est de même dans les cas de déclaration commune notariée ou de jugement de dissolution d'une union civile, auquel cas, la mention sera faite sur l'exemplaire informatique des actes de naissance et d'union civile de chacune des parties (art. 135 C.c.Q.). La séparation de corps n'est pas notée comme une modification à l'état d'époux, car elle ne met fin qu'à la seule obligation de faire vie commune (art. 507 C.c.Q.), sans effet sur l'acte de mariage. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 9 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA Dans les cas des jugements en nullité de mariage ou d'union civile, de même qu'en annulation d'un jugement déclaratif de décès, les modifications auront pour effet d'entraîner l'annulation de l'acte de mariage, d'union civile ou de décès, selon le cas, et d'annuler les mentions portées en marge de l'acte de naissance (art. 135 C.c.Q.). Les mentions indiquées en marge des différents actes visent à assurer la complémentarité entre les actes de l'état civil d'une même personne (art. 135, al. 4 in fine C.c.Q.). Quant aux jugements rendus hors du Québec et aux actes de l'état civil qui y ont été dressés, ils sont aussi portés au registre de l'état civil de la personne domiciliée au Québec, de la même manière que le sont les actes faits au Québec (art. 137 C.c.Q.). Lorsque l'acte dressé à l'étranger a été détruit, perdu ou qu'il est impossible d'en obtenir une copie, le directeur de l'état civil doit obtenir une autorisation du tribunal avant de dresser un nouvel acte ou de porter une mention à un autre acte contenu au registre (art. 139 C.c.Q.)49 . Toutefois, les actes dressés à partir des jugements étrangers, de même que ceux qui ont été intégrés au registre, n'auront qu'un caractère semi- authentique, sauf si leur validité a été confirmée par un tribunal du Québec (art. 137 à 140 C.c.Q.)50 . 2. La modification à la suite d'une décision du directeur de l'état civil Lorsqu'une décision du directeur de l'état civil a pour effet de changer le nom d'une personne ou la mention de son sexe, un nouvel acte de l'état civil doit être dressé (art. 132 C.c.Q.). Lorsqu'il ne s'agit pas d'un changement à l'état civil, mais seulement d'une imprécision contenue à l'acte, de l'absence d'un document nécessaire à sa confection ou d'un retard relatif à un constat ou à une déclaration, le directeur de l'état civil procède à une enquête sommaire et dresse, par la suite, l'acte sur la foi des informations obtenues (art. 130 C.c.Q.). Le directeur de l'état civil peut aussi procéder à une rectification des actes de l'état civil lorsqu'il s'agit de corriger une erreur matérielle, c'est-à-dire une erreur d'écriture. On parle de rectification des actes et du registre lorsque l'erreur que contient l'acte, soit par omission d'une information requise par la loi, soit par une inscription fausse ou non exigée, ne porte pas sur une mention essentielle de l'acte. Toutes les décisions du directeur de l'état civil sont révisables par le tribunal sur demande d'une personne intéressée (art. 141, al. 2 C.c.Q.). Dans tous les autres cas, la rectification devra être faite à la suite d'une ordonnance du tribunal (art. 141 C.c.Q. et art. 391 et s. C.p.c.)51 . Les demandes en rectification ou en modification d'un acte de l'état civil, plus particulièrement celles relatives à l'acte de naissance, ne doivent pas être confondues avec les demandes relatives à la reconnaissance ou à la contestation d'état. Les demandes relatives à l'état ont pour objet d'établir la filiation par le sang d'une personne ou de la contester52 . Les tribunaux sont partagés quant à la nature d'une demande visant à ajouter le nom du père sur l'acte de naissance alors que la filiation est autrement établie53 . La demande d'ajout du nom du père est généralement présentée dans le cadre d'une demande en changement de nom. Lorsque toutefois la filiation du père n'est pas établie à l'égard de l'enfant, l'ajout du nom du père se fait alors dans le cadre d'une demande en réclamation d'état, si aucune autre filiation paternelle n'est établie ou, encore, dans le cadre d'une demande en contestation d'état, lorsqu'une autre filiation est établie. Dans les deux cas, il s'agit de demandes relatives à l'état. Par ailleurs, l'inscription en faux ne constitue pas le véhicule procédural approprié pour corriger un acte de l'état civil. En effet, le directeur de l'état civil n'a pas pour mission de constater la filiation et de la vérifier. Il faut plutôt entreprendre une demande en réclamation d'état ou en contestation d'état54 . Outre les rectifications des actes de l'état civil, la reconstitution en cas de destruction ou de perte d'un acte est aussi réglementée (art. 143 C.c.Q. et art. 487 C.p.c.). Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 10 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA e * L'auteur remercie M Julie Baril de la Direction des affaires juridiques du TAQ pour sa collaboration à la révision de ce e texte. Ce texte a été initialement rédigé par M France Allard. 1. La filiation, bien qu'étroitement liée à l'identification de la personne, est traditionnellement analysée en droit de la famille et ne fait pas l'objet d'un traitement particulier dans ce texte, sauf en matière de changement de nom. 2. Germain BRIÈRE, « La jouissance et l'exercice des droits civils : nouvelle version », (1989) 31 R.G.D. 286. 3. Nejad-Assadi c. Directeur de l'état civil, 2009 QCCS 948, EYB 2009-155777. 4. Voir Jean Louis c. Directeur de l'état civil, [1998] R.J.Q. 518, REJB 1997-03657 (C.S.). 5. Voir Brasseur c. Lavigne, [1995] R.J.Q. 2183, EYB 1995-75632 (C.S.) ; Létourneau c. Lavigne, [1995] R.D.F. 228, EYB 1995-72350 (C.S.). 6. Droit de la famille – 268, [1986] R.D.F. 46, EYB 1985-144022 (C.S.). 7. Par exemple, pourrait porter au ridicule ou être susceptible de déconsidérer la personne, un nom composé des noms de famille des deux parents dont l'un s'appelle Leboeuf et l'autre Haché. Il en serait de même de l'association d'un prénom qui, en soi, ne pose pas de problème mais qui, une fois juxtaposé au nom de famille, devient risible, par exemple, un fils dénommé Jean dont le nom de famille est Bon (les exemples sont tirés de « Nom de nom ! », Le Devoir, 31 janvier 1994). 8. Lavigne, ès qualités « Directeur de l'état civil » c. Villeneuve, REJB 1997-09452 (C.S.). 9. Québec (Procureur général) c. Comeau, 2006 QCCS 5252, EYB 2006-110945. 10. Nejad-Assadi c. Directeur de l'état civil, précité, note 3. 11. Voir le Tarif des droits relatifs aux actes de l'état civil, au changement de nom ou de la mention du sexe, D. 1593-93, (1993) 125 G.O. II, 8057. 12. Savard c. Curtin-Savard, EYB 2012-209525 (C.S.). 13. Voir aussi les articles 523 et s. C.c.Q. portant sur la filiation, plus particulièrement, les articles 531 et 532 C.c.Q. sur la contestation de maternité ou de paternité et sur la reconnaissance de maternité ou de paternité. Il convient de noter que l'ajout d'une particule au nom peut aussi, une fois la filiation établie, ressortir de la compétence du directeur de l'état civil (art. 58, al. 2 C.c.Q.). 14. Voir Droit de la famille – 072982, 2007 QCCS 5678, EYB 2007-127043. 15. Voir aussi les articles 432 et s. C.p.c. sur les demandes relatives à l'adoption. 16. La filiation d'une personne est considérée établie et ne peut être contestée lorsque la possession d'état de la personne est conforme à son acte de naissance (voir les articles 530 et s. C.c.Q.). 17. Voir Droit de la famille – 10190, 2010 QCCS 348, EYB 2010-169210, où le juge Pierre Jasmin n'a pas voulu ajouter le nom de famille du père à celui de l'enfant puisque celle-ci avait porté le nom de famille de la mère depuis sa naissance ; Droit de la famille – 103390, 2010 QCCS 6185, EYB 2010-183684 (confirmé en appel), où la juge Dominique Bélanger a rejeté la demande en changement de nom vu l'absence de tout lien significatif (entre le père et l'enfant) et qu'au surplus un tel lien serait improbable dans le futur. 18. Droit de la famille – 121473, EYB 2012-209191 (C.S.). 19. Voir Droit de la famille – 10217, 2010 QCCS 392, EYB 2010-169421, où le juge Carl Lachance a non seulement Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 11 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA accueilli la demande en déchéance de l'autorité parentale, mais également celle en changement de nom vu la condamnation du père pédophile, sa conduite depuis son incarcération et l'intérêt supérieur de l'enfant qui ne voulait plus avoir de relation avec lui. 20. Voir, par exemple, Côté c. St-Antoine, [1991] R.D.F. 513, EYB 1991-56729 (C.A.). 21. V. (K.) c. P. (A.), Droit de la famille – 1478, EYB 2014-231994 (C.S.). 22. RLRQ, c. CCQ, r. 4. 23. Id., art. 5 et s. 24. Dans Dupuis c. Directeur de l'état civil, 2010 QCCS 1526, EYB 2010-172588, le juge Bernard Godbout a refusé d'accepter l'appartenance laïque et civile comme un « motif sérieux » permettant de remplacer le nom de famille du père par celui de la mère. 25. Voir Koulmyeh-Abaneh c. Directeur de l'état civil, 2006 QCCA 165, [2006] R.D.F. 38, REJB 2006-101024 (C.A.), où la Cour d'appel a choisi « de nuancer l'application formaliste du principe de la permanence du nom et de reconnaître l'établissement de motif sérieux fondant la demande de changement de nom. L'appelant a établi que le nom qu'il revendiquait était celui qu'il avait porté de la naissance jusqu'à l'âge de 13 ans et que ce nom comportait une dimension identitaire, culturelle, affective et humanitaire importante ». 26. Voir la décision Gratton c. Directeur de l'état civil, 2012 QCCS 3433, EYB 2012-209329, où le juge Michel DeLorme a ajouté le patronyme de l'époux à celui de l'épouse comme motif sérieux et ce, malgré l'article 393 C.c.Q. 27. Nejad-Assadi c. Directeur de l'état civil, précité, note 3. 28. Voir Melançon c. Directeur de l'état civil du Québec, 2008 QCCS 4948, EYB 2008-149550, où le juge Michel Déziel a refusé de modifier les nom et prénom pour cause d'une prétendue « infamie » résultant de la lettre recommandant le congédiement d'une personne. 29. Voir, par exemple, Montreuil c. Québec (Directeur de l'état civil), REJB 2002-35333 (C.A.). 30. Ibid. 31. Règlement relatif au changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, précité, note 22. 32. Voir aussi l'article 23 du Règlement relatif au changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, précité, note 22. 33. Tremblay c. Québec (Procureur général), EYB 2013-230306 (C.S.) ; Z. (A.) c. S. (V.), Droit de la famille – 132433, EYB 2013-226560 (C.S.) ; A. (A.) c. Y. (S.), Droit de la famille – 131294, EYB 2013-221903 (C.A.). 34. Voir, par exemple, Pierre AZARD et Alain-François BISSON, Droit civil québécois, t. 1, Ottawa, Éditions de o e l'Université d'Ottawa, 1971, n 55, p. 73 ; Éditho DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, n 313, p. 299, EYB2008DPP12. 35. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 22.1. 36. Il convient de noter que l'élection de domicile est attributive de compétence et jamais exclusive de compétence. 37. Schwebel c. Ungar, [1965] R.C.S. 148. e 38. Paul-André CRÉPEAU et autres, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, 2 éd., Cowansville, Éditions Yvon o Blais, 1990, v état civil, p. 233. 39. Il est à noter que la Loi modifiant le Code civil du Québec en matière d'état civil, des successions et de la publicité des Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 12 L'identification de la personne physique Sylvain BOURASSA droits, sanctionnée le 6 décembre 2013 abolit la nécessité pour la déclaration de naissance et de décès d'être signée devant témoin. er 40. Depuis le 1 janvier 1994, il n'existe qu'un seul registre centralisé de l'état civil confié à l'autorité du directeur de l'état civil (art. 103, 104 et s. C.c.Q.). Voir aussi, les articles 151 et s. C.c.Q. et la Loi sur les autochtones, cris, inuit et naskapis, RLRQ, c. A-33.1. Les décisions du directeur de l'état civil sont, en vertu de l'article 74 C.c.Q., révisables quant à leur légalité et à leur légitimité. 41. Voir aussi le Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l'état civil, RLRQ, c. CCQ, r. 11, qui prévoit d'autres mentions obligatoires. 42. Voir l'article 5, Tarif des droits relatifs aux actes de l'état civil, au changement de nom ou de la mention du sexe, précité, note 11. 43. Voir aussi l'article 4, Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l'état civil, précité, note 41, qui prévoit d'autres mentions obligatoires. 44. Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, c. 6. 45. Pour plus de détails sur l'union civile, voir le chapitre X du titre II, volume 3, Personnes, famille et successions, Collection de droit. 46. Voir aussi l'article 46 de la Loi sur la santé publique, RLRQ, c. S-2.2, qui prévoit la possibilité que le constat soit fait, dans des circonstances particulières, par d'autres personnes. 47. Voir aussi l'article 5 du Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l'état civil, précité, note 41, qui prévoit d'autres mentions obligatoires. Lorsque les renseignements exigés sont inconnus du déclarant, le directeur de l'état civil fixe la date et l'heure du décès sur la foi du rapport du coroner et sur les présomptions tirées des circonstances. Voir l'article 127 C.c.Q. et la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès, RLRQ, c. R-0.2. 48. Voir aussi la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès, précitée, note 47. 49. Voir Droit de la famille – 073156, 2007 QCCS 5999, EYB 2007-127647. 50. Sur la reconnaissance des jugements étrangers, voir les articles 3155 et s. C.c.Q. ainsi que l'article 574 C.c.Q. en matière d'adoption. Voir aussi les articles 391 et s. C.p.c. sur la procédure applicable à la reconnaissance de la validité d'un acte de l'état civil fait à l'étranger. 51. Voir A c. Directeur de l'état civil du Québec, 2007 QCCS 492, EYB 2007-114173. 52. Voir Dictionnaire de droit privé de la famille et lexiques bilingues, Montréal/Cowansville, C.R.D.P.C.Q./Éditions Yvon o Blais, 1999, v action en contestation d'état, action en désaveu de paternité, action en réclamation d'état. 53. Droit de la famille – 119, [1992] R.J.Q. 581, EYB 1992-64023 (C.A.) ; Droit de la famille – 766, [1990] R.J.Q. 289, EYB 1989-63352 (C.A.). 54. Droit de la famille – 11394, 2011 QCCA 319, EYB 2011-186549. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 13 La capacité juridique Sylvain BOURASSA EYB2016CDD106 Personnes, famille et successions, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 3, 2016 Sylvain BOURASSA* La capacité juridique Indexation Personnes ; personnes physiques ; capacité ; minorité ; émancipation ; tutelle au mineur ; tutelle légale ; tutelle dative ; administration tutélaire ; conseil de tutelle ; régimes de protection du majeur ; intérêt du majeur ; ouverture ; choix du régime ; conseiller au majeur ; rôle ; tutelle ; curateur public ; curatelle ; curateur public ; Obligations ; contrats nommés ; mandat ; mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ; Procédure civile ; matières non contentieuses ; régimes de protection du majeur ; homologation du mandat donné en prévision de l'inaptitude TABLE DES MATIÈRES 1- Les régimes de protection A- La protection du mineur 1. La tutelle au mineur a) Les types de tutelle au mineur 1) La tutelle légale 2) La tutelle dative b) L'administration tutélaire B- La protection de la personne majeure inapte 1. Le conseiller au majeur 2. La tutelle privée au majeur 3. La curatelle privée au majeur 4. La représentation du majeur par le curateur public 5. La représentation du majeur par un mandataire 2- La mise en oeuvre de la protection A- Les régimes de protection prévus par la loi B- Le régime de protection établi par un mandat Les éléments qui se rapportent à l'existence et à l'identification de la personne ne suffisent pas à établir les assises nécessaires aux rapports de droit que peut entretenir une personne avec d'autres. Le droit a de plus recours à la notion de capacité juridique. Toute personne possède la capacité juridique. La capacité constitue la règle, l'incapacité l'exception. La capacité juridique comprend la capacité de jouissance (art. 1 C.c.Q.) et la capacité d'exercice (art. 4 C.c.Q.). Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 1 La capacité juridique Sylvain BOURASSA La capacité de jouissance se définit comme la « vocation juridique à être titulaire de droits »1, alors que la capacité d'exercice se définit comme la « vocation juridique à exercer les droits dont on est titulaire » 2. Les deux notions, constitutives de la capacité juridique, sont intimement liées à la personne. Comme nous l'avons déjà souligné, la privation complète de la capacité de jouissance équivaut à une privation de la personnalité juridique, l'entité étant alors privée de sa qualité de sujet de droit. Mais « le droit a peu à dire sur la capacité, qui est l'état habituel de l'être humain »3. C'est pourquoi les règles sur la capacité se présentent par le traitement des incapacités. On parlera alors d'incapacités de jouissance et d'incapacités d'exercice. Ces incapacités ne peuvent être établies autrement que par la loi. Aussi, nul ne peut transiger relativement à la capacité des personnes (art. 2632 C.c.Q.). Les incapacités de jouissance visent l'absence ou la privation de certains droits. Les personnes frappées d'une telle incapacité ne pourront donc poser certains actes juridiques déterminés ni par elle-même, ni par l'intermédiaire d'une autre personne, en raison de motifs précis généralement liés à leur fonction ou à leur état ou, parfois, à la nature de l'acte. Très peu d'incapacités de jouissance subsistent dans notre droit. On peut toutefois penser aux incapacités suivantes : l'incapacité d'un frère et d'une soeur de se marier l'un à l'autre4, qui est une incapacité liée à l'état d'une personne ; l'incapacité des juges, des avocats, des notaires et des officiers de justice de se porter acquéreurs de droits litigieux (art. 1783 C.c.Q.), qui est liée à la fonction d'une personne ; ou, encore, l'incapacité de transiger relativement à l'état ou à la capacité d'une personne (art. 2632 C.c.Q.), qui est liée à la nature de l'acte juridique et à son objet. Les incapacités d'exercice visent la protection de la personne, soit en raison de son âge ou d'une inaptitude à exprimer une volonté et à comprendre la portée de ses actes. Elles ne correspondent pas à « une absence de droit, mais [à] une impossibilité d'utiliser ce droit de façon autonome »5. Les incapacités d'exercice sont nombreuses. Elles résultent de la tutelle du mineur et des régimes de protection des personnes majeures. La distinction entre les incapacités de jouissance et d'exercice sert, entre autres, à délimiter leurs effets juridiques, plus particulièrement quant à la sanction rattachée à la transgression de la règle. La première est en principe sanctionnée par la nullité absolue. La seconde, comme elle vise la protection de la personne frappée d'incapacité, est en principe sanctionnée par la nullité relative. 1- Les régimes de protection Au-delà de ces mécanismes de sanction qui se rapportent à la théorie générale des obligations et qui servent à la fois de mécanismes de protection, le code prévoit un certain nombre de régimes particuliers en vue de favoriser la protection de certaines personnes : il s'agit de la tutelle, de la curatelle et du conseiller au majeur. S'ajoute à ceux-ci, le mandat de protection6 donné en prévision de l'inaptitude de la personne majeure. Ces régimes de protection constituent les principaux mécanismes de protection de la personne. Ils sont établis par la loi ou par jugement en raison d'un état ou d'une condition qui, selon la loi, rendent la personne vulnérable. Une fois établis, ces régimes entraînent l'incapacité de la personne concernée, état de droit qui emporte des conséquences déterminées sur l'étendue d'exercice des droits par la personne protégée. Lorsque nous parlons d'un état de droit, c'est que l'incapacité a une incidence sur la condition juridique de la personne, par opposition à un état de fait, qui est lié à une inaptitude factuelle à exprimer un consentement et ne modifie en rien la condition de la personne. Par ailleurs, cet état de fait sera pertinent dans la mesure où il sert d'élément déclencheur à l'établissement d'un régime de Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 2 La capacité juridique Sylvain BOURASSA protection dont découle une incapacité. Ainsi, on parlera de l'incapacité de la personne afin de décrire sa condition – état de droit – à la suite de l'ouverture d'un régime de protection et d'inaptitude de la personne – état de fait – afin de décrire son inhabileté à exprimer son consentement. A- La protection du mineur La loi accorde au mineur un statut juridique particulier auquel se rattache un ensemble de règles. Ce statut se définit en fonction de l'âge de la majorité qui est de 18 ans (art. 153 C.c.Q.). Avant cet âge, le mineur sera généralement considéré incapable, sauf en cas d'émancipation. Cette incapacité n'est toutefois pas totale. En effet, le mineur peut exercer certains droits de son propre chef, quoique dans la mesure prévue par la loi (art. 155 C.c.Q.). La loi prévoit différents facteurs de détermination de la capacité du mineur d'exercer certains droits dans des circonstances données, dont l'âge, la faculté de discernement7, un événement précis. Dans certains cas, le mineur pourra agir seul sur autorisation du tribunal (par exemple, art. 159, al. 2 C.c.Q.)8. L'âge est un critère déterminant9. C'est à partir de l'âge de 14 ans que le mineur acquiert une part importante de sa capacité. L'âge de 14 ans est déterminant dans toutes les matières portant sur l'intégrité du mineur (art. 10 et s. C.c.Q.). Il sert aussi à déterminer si le mineur peut, par exemple, faire seul une demande en changement de nom (art. 66 C.c.Q.), avoir accès à son dossier médical sans être représenté 10 , poser seul les actes relatifs à son emploi, son art ou sa profession (art. 156 C.c.Q.). Dans ce dernier cas, la reconnaissance de la capacité a pour effet d'assimiler le mineur à une personne majeure (art. 156 C.c.Q.). L'émancipation est aussi importante dans le contexte de l'acquisition de la capacité juridique. L'émancipation consiste en une modification de l'état du mineur par la suppression ou la réduction de son incapacité d'exercice. Il existe deux types d'émancipation : la simple émancipation et la pleine émancipation. La simple émancipation se réalise de deux façons : soit par le dépôt d'une déclaration du tuteur au curateur public selon laquelle il émancipe le mineur à sa demande et avec l'accord du conseil de tutelle (art. 167 C.c.Q.), soit judiciairement. Dans le premier cas, l'émancipation a lieu dès le dépôt de la déclaration au curateur public. Le curateur public n'a aucun pouvoir décisionnel sur l'émancipation du mineur. Son unique fonction dans ce cadre est de rendre public, par l'inscription de la déclaration à ses registres, le changement d'état du mineur. Dans le second cas, le mineur peut demander seul son émancipation. Bien que le code ne le mentionne pas de manière expresse, on considère généralement que le mineur ne peut faire cette demande qu'à compter de l'âge de 16 ans, compte tenu de la précision faite à l'article 167 C.c.Q. Le tribunal prendra alors l'avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle (art. 168 C.c.Q.). La simple émancipation ne confère pas au mineur la pleine capacité ; elle ne met pas fin à la minorité. Elle a pour principal effet de libérer le mineur de l'obligation d'être représenté pour l'exercice de ses droits civils (art. 170 C.c.Q.). Cette libération ne lui donne toutefois pas la pleine capacité d'exercice. C'est ce qui distingue la simple émancipation de la pleine émancipation. Le code prévoit en effet que le mineur simplement émancipé a la capacité de faire, outre les actes qu'il pourrait autrement faire seul, tous les actes de simple administration (art. 172 C.c.Q.)11 . Pour les actes qui excèdent les actes de simple administration, il doit alors être assisté de son tuteur (art. 173 C.c.Q.) ou, dans d'autres cas qui comportent des incidences financières plus importantes, obtenir l'autorisation du tribunal (art. 174 C.c.Q.). La simple émancipation met aussi fin à l'autorité parentale (art. 171 C.c.Q.)12 . Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 3 La capacité juridique Sylvain BOURASSA La pleine émancipation se réalise aussi de deux façons : soit par le mariage (art. 175, al. 1 C.c.Q.)13 , soit judiciairement. Dans ce dernier cas, elle fait suite à la demande du mineur qui doit démontrer qu'il existe un motif sérieux qui justifie l'attribution de l'émancipation (art. 175, al. 2 C.c.Q.). Il est difficile de déterminer ce qui pourra être considéré comme un motif sérieux. N'ont pas été considérés comme des motifs sérieux le fait qu'un mineur ne se considère pas suffisamment informé des actes faits à son égard par le curateur public agissant comme tuteur ad hoc14 , le désir de vouloir se soustraire à l'autorité parentale d'un parent alors que le mineur ne vit plus sous son toit15 , l'abdication, par les parents, de leurs responsabilités parentales16 , la maternité17 . La pleine émancipation confère au mineur la pleine capacité d'exercice de ses droits civils. L'état du mineur s'assimile alors à celui d'une personne majeure (art. 176 C.c.Q.). Dans tous les cas, l'émancipation, simple ou pleine, ne vaut que pour l'exercice des droits du mineur en matière civile. Ainsi, le mineur demeure soumis à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents18 , ainsi qu'à la Loi sur la protection de la jeunesse19 . Le droit reconnaît donc au mineur des degrés d'autonomie variables suivant des seuils que la loi détermine. Il lui accorde graduellement la capacité d'exercer ses droits civils de manière de plus en plus autonome dans la marche vers l'acquisition de sa pleine capacité, à l'âge de la majorité ou de la pleine émancipation, en faisant en même temps fléchir, de façon proportionnelle à cette acquisition, la portée de l'exercice de l'autorité parentale sur lui. La conséquence principale de la reconnaissance de la capacité du mineur dans certaines circonstances est qu'il sera considéré, pour ces actes, comme une personne majeure. Ainsi, le mineur ne pourra bénéficier que des sanctions aux actes dont peut jouir la personne majeure. Lorsque la loi ne reconnaît pas la capacité du mineur, celui-ci bénéficie de protections particulières rattachées à la sanction des actes. Ainsi, l'acte fait seul par le mineur, alors que la loi ne lui permet pas d'agir seul ou représenté est nul de nullité absolue (art. 161 C.c.Q.)20 . Cette nullité se rapporte à une incapacité de jouissance. L'acte fait seul par le mineur alors qu'il aurait dû être représenté est nul de nullité relative (art. 160 C.c.Q.). Cette nullité se rapporte à une incapacité d'exercice qui est établie par la loi en vue de la protection du mineur. Il est alors normal qu'il soit le seul qui puisse la soulever. Dans certains cas, le mineur devra toutefois démontrer qu'il a subi un préjudice (art. 163, 173, al. 2 et 174 C.c.Q.). 1. La tutelle au mineur La tutelle au mineur est établie dans l'intérêt de celui-ci, dans un but de protection générale de sa personne et de ses biens. Il s'agit d'un régime de protection qui consiste en une charge assumée par une personne capable, dont le but est d'assurer la protection du mineur, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils (art. 177 et 179 C.c.Q.). La tutelle se caractérise par différents éléments dont certains se rapportent à la personne du tuteur et d'autres à la nature de la tutelle. Le tuteur est, en principe, une personne physique capable d'exercer pleinement ses droits civils et apte à exercer la charge tutélaire (art. 179 C.c.Q.). Ainsi, seuls les personnes majeures et les mineurs pleinement émancipés, aptes dans les faits à assumer la charge, peuvent exercer la tutelle. Une personne morale ne peut, en aucun cas, exercer la tutelle à la personne (art. 304 C.c.Q.). Toutefois, la tutelle aux biens peut être exercée par une personne morale, lorsqu'elle y est autorisée par la loi (art. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 4 La capacité juridique Sylvain BOURASSA 189 et 304, al. 2 C.c.Q.). Elle doit alors rendre compte au tuteur à la personne (art. 246 C.c.Q.). La tutelle est personnelle, c'est-à-dire qu'elle est attachée exclusivement à la personne du titulaire ; elle ne passe donc pas aux héritiers du titulaire de la charge (art. 179 C.c.Q.). Toutefois, à la suite du décès du tuteur, ses héritiers sont tenus de rendre compte de la gestion de leur auteur et, s'ils sont majeurs, ils sont tenus de continuer l'administration tutélaire jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur (art. 181 C.c.Q.). Lorsque la tutelle est détenue par le curateur public ou le directeur de la protection de la jeunesse, elle est alors reliée à la fonction de la personne qui la détient (art. 182 C.c.Q.). La tutelle prend fin à la majorité, lors de la pleine émancipation ou au décès du mineur. La charge tutélaire cesse à la fin de la tutelle, au remplacement du tuteur ou à son décès (art. 255 C.c.Q.)21 . a) Les types de tutelle au mineur 1) La tutelle légale La tutelle légale est celle qui est attribuée par la loi (art. 178 et 192 C.c.Q.). La première tutelle légale est celle qui est exercée par les parents à l'égard de leur enfant. Le terme enfant comprend ici l'enfant né et l'enfant conçu mais non encore né. Dans ce dernier cas, la tutelle légale impose aux parents un devoir d'agir dans les seuls cas où l'intérêt patrimonial de l'enfant l'exige. La protection des intérêts normalement liés à la protection de la personne du mineur, alors que l'enfant est dans le ventre de sa mère, ne fait l'objet d'aucune protection découlant de l'exercice de la tutelle. Ainsi, le père ne pourrait exiger de la mère un comportement particulier afin de préserver la santé du foetus22 . La tutelle légale est, en principe, exercée conjointement par les père et mère (art. 193 C.c.Q.). L'article 193 C.c.Q. prévoit qu'elle est ainsi exercée, à moins que l'un des parents ne soit décédé ou empêché d'exprimer sa volonté. Un parent peut donner à l'autre mandat de le représenter dans les actes relatifs à l'exercice de la tutelle (art. 194 C.c.Q.). Si, toutefois, les parents sont en désaccord relativement à l'exercice de la tutelle, l'un d'eux peut saisir le tribunal du différend qui les oppose (art. 196 C.c.Q.). Il en est de même pour l'exercice de l'autorité parentale (art. 604 C.c.Q.). La tutelle légale des parents s'ajoute aux droits et aux devoirs liés à l'autorité parentale (art. 192 C.c.Q.) 23 . Les devoirs liés à la protection de la personne sont en principe considérés comme des attributs de l'autorité parentale24 , alors que ceux qui sont liés à la protection du patrimoine du mineur sont liés à la tutelle. Toutefois, dans les faits, les pouvoirs qui se rattachent à la tutelle et les droits et devoirs qui découlent de l'exercice de l'autorité parentale se confondent. Ainsi, le parent déchu de l'autorité parentale perd du même coup sa charge tutélaire envers son enfant ; celui auquel certains attributs de l'autorité parentale ont été retirés peut, à la discrétion du tribunal, perdre sa charge tutélaire (art. 197 et s. C.c.Q.). L'attribution de la garde d'un enfant à l'autre parent ou à une tierce personne ne touche toutefois pas l'exercice de la tutelle, sauf si le tribunal considère qu'il existe des motifs graves justifiant le retrait de la charge tutélaire (art. 195 C.c.Q.)25 . L'exigence de la présence de motifs graves afin que la charge tutélaire soit retirée à un parent s'ajoute à celle de l'intérêt de l'enfant. On peut s'inspirer des décisions rendues en application de l'article 606 C.c.Q. relativement à la déchéance de l'autorité parentale26 . La tutelle légale peut être exercée par le directeur de la protection de la jeunesse lorsque les deux parents sont déchus de l'autorité parentale et que le tribunal n'a pas désigné de tuteur lors du jugement en déchéance (art. 199 et 607 C.c.Q.). La situation où un seul parent est déchu de l'autorité parentale et où l'autre décède par la suite n'est pas visée par l'article 199 C.c.Q. Il faudrait dans ce cas, afin que Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 5 La capacité juridique Sylvain BOURASSA l'enfant soit pourvu d'un tuteur, qu'une tutelle dative soit établie, que ce soit en vertu de l'article 200 C.c.Q. (tutelle testamentaire) ou en vertu de l'article 207 C.c.Q. Il en est de même dans les cas où le directeur de la protection de la jeunesse a fait déclarer un enfant admissible à l'adoption ou lorsqu'il a reçu un consentement général à l'adoption d'un enfant, et ce, jusqu'à l'ordonnance de placement, sauf si le tribunal a nommé un autre tuteur (art. 199, al. 2 C.c.Q.). La tutelle légale peut aussi être exercée par le curateur public lorsque le mineur n'est pas pourvu d'un tuteur. Le curateur public sera alors tuteur aux biens du mineur27 . Dans tous les cas, la tutelle légale est obligatoire et en principe gratuite (art. 180 et 183 C.c.Q.). Les père et mère peuvent, toutefois, pour l'administration des biens de leur enfant, recevoir une rémunération fixée par le tribunal, sur avis du conseil de tutelle, lorsque la charge constitue pour eux une occupation principale (art. 183, al. 2 C.c.Q.). 2) La tutelle dative La tutelle dative est celle qui est attribuée par les père et mère ou par le tribunal (art. 178, 200 et 205 C.c.Q.). Elle est facultative et peut être rémunérée, sauf lorsqu'elle est tenue par le directeur de la protection de la jeunesse ou par le curateur public (art. 180, 183, al. 1 et 184 C.c.Q.). La tutelle dative déférée par les père ou mère peut se faire par testament, par un mandat de protection donné en prévision de leur inaptitude ou par une déclaration transmise au curateur public (art. 200 C.c.Q.). Ce droit de nommer un tuteur appartient au dernier survivant des deux parents qui, au jour de son décès, avait toujours la tutelle légale de son enfant, ou au dernier des deux apte à assumer l'exercice de la tutelle (art. 201 C.c.Q.). Dans le cas où les deux parents meurent simultanément ou deviennent inaptes lors d'un même événement, et que chacun a désigné une personne différente qui accepte la charge de tuteur, le tribunal tranchera afin de désigner un seul tuteur (art. 201, al. 2 C.c.Q.). La tutelle déférée par les parents n'est possible que dans ces cas. Elle ne peut servir à pourvoir à la nomination d'un tuteur dans d'autres circonstances, par exemple afin de se décharger de leurs obligations découlant de la tutelle, la tutelle légale des parents étant obligatoire (art. 201 et 202 C.c.Q.). La tutelle déférée par les parents prend effet dès l'acceptation de la charge par le tuteur désigné ou son remplaçant ou dans les 30 jours où le tuteur désigné a pris connaissance de sa nomination, à moins qu'il n'ait exprimé son refus dans ce délai (art. 202 C.c.Q.)28 . L'acceptation ou le refus de la charge par le tuteur désigné doit faire l'objet d'un avis au liquidateur de la succession, au curateur public, ainsi qu'au remplaçant, s'il y a lieu (art. 203 et 204 C.c.Q.). La tutelle dative peut aussi être déférée par le tribunal (art. 205 C.c.Q.). Elle intervient généralement à défaut d'autres tutelles et vise principalement les situations d'absence de tutelle à l'égard d'un mineur. Elle peut être établie en vue de la nomination ou du remplacement d'un tuteur pour une représentation générale du mineur, en vue d'une représentation du mineur pour une fin particulière, dans tous les cas où les intérêts du mineur s'opposent à ceux de son tuteur, auquel cas il sera nommé un tuteur ad hoc. Le tuteur ad hoc ne possède qu'une charge temporaire limitée à la fin pour laquelle il est nommé (art. 190 et 235 C.c.Q. ; art. 90 et 160 C.p.c.). Le tribunal peut aussi nommer un tuteur en cas de contestation du choix fait par les père et mère dans la déclaration faite au curateur public, dans leur mandat de protection donné en prévision de leur inaptitude ou dans leur testament (art. 202 C.c.Q.). Toute personne intéressée, y compris le curateur public, peut faire une demande afin que soit déférée une tutelle dative en faveur du mineur. La demande peut être faite devant le tribunal (art. 303 C.p.c.) ou Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 6 La capacité juridique Sylvain BOURASSA devant notaire (art. 312, 313 et 393 C.p.c.). Lorsque la demande est faite devant notaire, celui-ci doit déposer, au greffe du tribunal du domicile ou de la résidence du mineur, une copie authentique du procès-verbal dressé par lui concernant l'établissement de la tutelle, ainsi que toutes les pièces justificatives (art. 313 et 393 C.p.c.). Le tribunal saisi par le dépôt du procès-verbal n'est pas tenu par les conclusions du notaire et peut rendre toutes les ordonnances qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde des droits des parties (art. 320 C.p.c.). La demande doit alors être accompagnée de l'avis du conseil de tutelle (art. 205, al. 2 et 206 C.c.Q. ; art. 393 et 394 C.p.c.). Lorsque la demande est faite par le directeur de la protection de la jeunesse, l'avis du conseil de tutelle n'est pas requis. Le directeur de la protection de la jeunesse ne peut faire une telle demande que dans certains cas déterminés : le mineur est orphelin et n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, ni le père ni la mère du mineur n'assument envers lui le soin, l'entretien ou l'éducation, le mineur serait vraisemblablement en danger s'il retournait avec ses père et mère (art. 207 C.c.Q.). La tutelle dative s'étend en principe à la protection de la personne et à la protection du patrimoine. Elle peut toutefois être divisée (art. 185 C.c.Q.). Dans ce cas, la tutelle à la personne est unique, alors que celle aux biens est divisible (art. 187 C.c.Q.). Lorsqu'une seule personne exerce la tutelle à la personne et aux biens, celle-ci agit comme titulaire de l'autorité parentale, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le tribunal (art. 186 C.c.Q.). b) L'administration tutélaire Les règles prévues aux articles 208 et s. C.c.Q. sont d'ordre public et doivent être interprétées restrictivement29 . De plus, elles sont les mêmes pour toutes les tutelles, qu'elles soient légales ou datives. En principe, le tuteur a l'administration de tous les biens du mineur (art. 208 C.c.Q.). Certains biens sont par contre soustraits à l'administration du tuteur : les biens légués ou donnés au mineur qui sont administrés par un tiers (art. 210 C.c.Q.), les produits du travail du mineur et les allocations qui visent à combler les besoins ordinaires du mineur (art. 220, al. 1 C.c.Q.). Le tuteur conserve malgré tout un certain pouvoir à cet égard, soit donner son avis au tribunal sur une limite à établir quant à la gestion de ces biens (art. 220, al. 2 C.c.Q.). Il agit, à l'égard des biens, à titre d'administrateur chargé de la simple administration. On doit alors se rapporter au régime général de l'administration du bien d'autrui, sous réserve des dispositions particulières portant sur l'administration tutélaire (art. 1299 et s. C.c.Q.). Le tuteur est donc soumis aux devoirs de prudence, de diligence, de loyauté et d'honnêteté imposés à tout administrateur (art. 1309 C.c.Q.)30 . Le code prévoit certaines règles particulières s'appliquant à l'administration tutélaire, qui délimitent les pouvoirs du tuteur en fonction du type d'acte posé. Le tuteur peut, par exemple, agir seul pour accepter une donation en faveur du mineur (art. 211 C.c.Q.), conclure une transaction relative au maintien de l'indivision (art. 215 C.c.Q.). Il doit, par ailleurs, obtenir l'autorisation du conseil de tutelle31 pour accepter une donation avec charge (art. 211 C.c.Q.), poursuivre un appel (art. 212 C.c.Q.), conclure une transaction, contracter un emprunt important, grever un bien d'une sûreté ou aliéner un bien important à caractère familial, un immeuble ou une entreprise lorsque la valeur du bien ou de la sûreté est de 25 000 $ et moins (art. 213 C.c.Q.). Enfin, dans ces mêmes cas, il doit obtenir l'autorisation du tribunal lorsque la valeur du bien ou de la sûreté est supérieure à 25 000 $ (art. 213 C.c.Q.). D'autres règles particulières sont prévues relativement aux avis à donner pour toute question portant sur les intérêts patrimoniaux du mineur (art. 216 et 217 C.c.Q.), aux prélèvements nécessaires pour Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 7 La capacité juridique Sylvain BOURASSA acquitter les charges de la tutelle et, dans les cas où il y a lieu de suppléer32 à l'obligation alimentaire des parents, pour assurer l'entretien et l'éducation du mineur (art. 218 et 219 C.c.Q.). D'autres règles particulières s'appliquent à l'administration tutélaire exercée par le curateur public33 . L'administration tutélaire est aussi soumise à d'autres mécanismes de contrôle qui sont mis en place par le code et la Loi sur le curateur public. Il s'agit des formalités techniques reliées à l'acceptation de la tutelle et à l'administration des biens, du conseil de tutelle et du rôle de surveillance du curateur public 34 . Le code prévoit un certain nombre de formalités techniques reliées à l'acceptation de la tutelle et à l'administration des biens, qui sont imposées comme mesures de surveillance de la tutelle afin d'assurer une meilleure protection des intérêts du mineur : il s'agit de l'inventaire (art. 240 et s. C.c.Q.), de la sûreté (art. 242 et s. C.c.Q.) et des rapports et comptes (art. 246 et s. C.c.Q.). Les parents ne sont toutefois pas tenus à autant de formalités dans leur rôle de tuteur, sauf lorsque la valeur des biens du mineur est supérieure à 25 000 $ ou lorsque le tribunal l'a ordonné (art. 209 C.c.Q.). En plus de ces formalités techniques, la constitution d'un conseil de tutelle sert aussi de mécanisme de protection des intérêts du mineur. Il n'est toutefois formé que dans les cas où il y a une tutelle dative ou lorsqu'il est imposé aux père et mère de faire inventaire, fournir une sûreté et rendre compte annuellement de leur gestion compte tenu de la valeur du patrimoine du mineur (art. 223 C.c.Q.). Il est formé de trois personnes désignées par une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou, si le tribunal le décide, d'une seule personne (art. 222 et 231 C.c.Q.). La charge des personnes désignées pour agir au conseil de tutelle est personnelle et gratuite (art. 232 C.c.Q.). Le premier rôle du conseil est de surveiller la tutelle (art. 222 C.c.Q.). Il doit aussi donner des avis et des autorisations lorsque ceux-ci sont exigés par la loi (art. 233 C.c.Q.), s'assurer que le tuteur remplisse les formalités techniques obligatoires (art. 236 C.c.Q.), demander le remplacement du tuteur s'il y a lieu (art. 251 C.c.Q.). Le conseil peut même agir au nom du mineur dans certains cas (art. 233 C.c.Q.). Les demandes relatives à la composition et à la constitution du conseil de tutelle se font en vertu des articles 44 et 312 C.p.c. B- La protection de la personne majeure inapte La loi reconnaît à la personne majeure la pleine capacité d'exercice. Celle-ci ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l'ouverture d'un régime de protection (art. 154 C.c.Q.). La règle qui prévaut est donc celle de la capacité, l'incapacité générale ou partielle étant l'exception. Les règles qui visent la protection de la personne majeure favorisent le respect de la personne. Ce respect de la personne est assuré par une reconnaissance de la place centrale de l'intérêt moral et matériel de la personne et la sauvegarde de ses droits et de son autonomie. Le code exprime cette idée de la façon suivante : « [t]oute décision relative à l'ouverture d'un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie » (art. 257, al. 1 C.c.Q.). La volonté du législateur de respecter l'autonomie de la personne concernée est exprimée dans plus d'une disposition du code (par exemple, art. 12, 256 et 257 C.c.Q.). Aussi, le législateur prévoit différentes garanties procédurales dans le cadre des demandes d'ouverture de régime de protection, afin d'appuyer ce principe du respect de l'autonomie de la personne (par exemple, art. 276 C.c.Q. ; art. 90, 121, 123, 160 et 313 C.p.c.)35 . Les régimes de protection sont donc établis dans l'intérêt de la personne inapte, en vue d'assurer sa Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 8 La capacité juridique Sylvain BOURASSA protection, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils (art. 256 C.c.Q.). Ils sont établis en tenant compte du degré d'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens (art. 259 C.c.Q.). Le choix du régime dépend donc du degré factuel d'autonomie de la personne, ainsi que du type de décisions ou d'activités pour lesquelles la personne démontre une inaptitude. L'inaptitude de la personne peut résulter d'une condition d'ordre physique ou mental. Le code donne quelques exemples de causes d'inaptitude : une maladie, une déficience ou un affaiblissement dû à l'âge et qui altère les facultés mentales ou physiques de la personne à exprimer sa volonté (art. 258, al. 1 C.c.Q.)36 . Encore une fois, chaque cas demeure un cas d'espèce puisqu'il n'existe aucun modèle préfabriqué pour les personnes en perte d'autonomie37 . Dans certains cas, la prodigalité est aussi retenue comme cause d'inaptitude (art. 258, al. 2 C.c.Q.). Ce motif d'inaptitude de la personne est particulier : il vise aussi à protéger l'époux ou le conjoint uni civilement et les enfants mineurs de la personne concernée. L'ouverture de tout régime de protection de la personne majeure, y compris celui qui résulte d'un mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude, est judiciaire (art. 268, al. 1 C.c.Q.)38 . Aucun régime de représentation ou d'assistance de la personne majeure ne résulte de la loi ou encore ne peut être mis en place uniquement avec le consentement des membres de la famille. L'inaptitude doit être déclarée par le tribunal. Trois régimes de protection du majeur inapte sont prévus par le législateur : le conseiller au majeur, la tutelle au majeur et la curatelle au majeur (art. 258 C.c.Q.). Une autre forme de protection peut aussi être établie : le mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude de la personne majeure (art. 2166 et s. C.c.Q.). 1. Le conseiller au majeur Le régime du conseiller au majeur n'est établi qu'eu égard à l'administration des biens de la personne, dans les cas où le majeur, « bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement, d'être assisté ou conseillé » (art. 291 C.c.Q.). Il s'agit donc d'une protection qui ne vise que certains actes pour lesquels la personne protégée démontre une inaptitude ou une situation temporaire, nécessitant dès lors une protection. Ce régime est le moins attentatoire à l'autonomie de la personne protégée, car celle-ci conserve sa capacité d'exercer elle-même ses droits civils. Le conseiller n'a alors qu'un rôle d'assistance et non de représentation ou d'administration (art. 292 C.c.Q.). Son assistance n'est d'ailleurs requise que pour les actes que le tribunal indique, soit en les énumérant de façon spécifique ou en énumérant ceux pour lesquels elle ne l'est pas (art. 293, al. 1 C.c.Q.). Lorsque le tribunal ne fait aucune indication, le conseiller doit intervenir à tous les actes qui excèdent la capacité du mineur simplement émancipé (art. 293, al. 2 C.c.Q.). Le conseiller assistera alors la personne protégée pour tous les actes qui excèdent la simple administration (par exemple, les actes d'aliénation d'un immeuble ou d'une entreprise, la renonciation à une succession). Par contre, le majeur pourvu d'un conseiller peut tester de ses biens sans l'assistance de son conseiller (art. 710 et 711 C.c.Q.). Lorsque le majeur est pourvu d'un conseiller et qu'il fait seul un acte pour lequel l'assistance de son conseiller est nécessaire, cet acte ne pourra être annulé et les obligations qui en découlent réduites que si le majeur en subit un préjudice (art. 294 C.c.Q.). Lorsque toutefois le majeur ainsi protégé passe un acte avec l'assistance de son conseiller, il est alors soumis aux règles générales relatives au Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 9 La capacité juridique Sylvain BOURASSA consentement (art. 1398 et s. C.c.Q.). Pour les actes faits par la personne protégée antérieurement à l'établissement du régime de conseiller au majeur, ceux-ci sont soumis aux règles générales des sanctions reliées à la qualité et aux vices du consentement (art. 1398 et s. C.c.Q.). 2. La tutelle privée au majeur La tutelle au majeur est établie dans le cas où un majeur est inapte, de façon temporaire ou partielle, à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens et qu'il a besoin d'être représenté dans l'exercice de ses droits civils (art. 285, al. 1 C.c.Q.). Le régime de la tutelle est, parmi les régimes de représentation, celui qui s'adapte le mieux à la situation particulière de chaque personne selon son degré d'aptitude. Il permet la subsistance d'un certain degré d'autonomie de la personne, lui permettant d'exercer ses droits civils dans la mesure de son aptitude à exprimer sa volonté. Les pouvoirs du tuteur sont alors fixés en fonction de cette aptitude. Un tuteur soit à la personne, soit aux biens, ou soit aux deux peut être nommé (art. 285, al. 2 C.c.Q.). L'établissement d'une tutelle aux biens n'entraîne donc pas nécessairement l'établissement d'une tutelle à la personne et, inversement, l'établissement d'une tutelle à la personne n'entraîne pas nécessairement l'établissement d'une tutelle aux biens. La tutelle à la personne est unique. Celle aux biens peut être divisée (art. 187 C.c.Q.) (par le jeu du renvoi de l'article 287 C.c.Q.). Dans le cadre de la tutelle aux biens, le tuteur a sur les biens du majeur protégé la simple administration de ceux-ci, qu'il exerce de la même manière que le tuteur au mineur, sauf décision contraire du tribunal lors de l'ouverture du régime de tutelle (art. 286 C.c.Q.). Quant à l'étendue de ses pouvoirs, elle est déterminée par le jugement de tutelle ou, à défaut, par référence aux règles relatives à la tutelle au mineur (art. 266 C.c.Q.). Le code prévoit d'ailleurs que le tribunal peut déterminer le degré d'aptitude du majeur en tutelle et indiquer, dans le jugement, les actes que peut faire seul le majeur en tutelle, ceux qui nécessitent une assistance, de même que ceux pour lesquels il doit être représenté (art. 288, al. 2 C.c.Q.). Quant au degré de capacité du majeur en tutelle, c'est aussi au jugement qu'il faudra se référer. Il est difficile pour les cocontractants de connaître l'étendue de la capacité du majeur et dans quelles circonstances il doit être représenté ou assisté. En effet, le curateur public ne peut dévoiler l'étendue des pouvoirs du tuteur. Il ne peut qu'attester qu'une personne est sous un régime de protection et indiquer le nom de la personne qui la représente39 . Lorsque le tribunal n'établit pas de distinction entre les différents actes que peut faire le majeur en tutelle ou lorsqu'il n'y a pas d'indication particulière quant à un type d'acte, il convient alors de se référer aux règles relatives à la tutelle au mineur, compte tenu des adaptations nécessaires (art. 287 C.c.Q.). Il existe toutefois des règles particulières propres au majeur en tutelle, notamment en ce qui a trait aux produits du travail du majeur en tutelle (art. 289 C.c.Q.), aux conventions matrimoniales (art. 436 C.c.Q.), à la capacité de tester (art. 709 C.c.Q.) et à la capacité de faire et de recevoir des donations (art. 1813 et 1814 C.c.Q.). Les actes faits seuls par le majeur en tutelle alors qu'il aurait dû être représenté ne peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites que s'il en subit un préjudice (art. 287 et 163 C.c.Q.)40 . Quant aux actes faits antérieurement à l'ouverture de la tutelle, ils peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où l'acte a été passé (art. 290 C.c.Q.), donc sans preuve d'un préjudice. Dans le cadre de la tutelle à la personne, le tuteur a la responsabilité de la garde et de l'entretien de la Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 10 La capacité juridique Sylvain BOURASSA personne protégée. Sa responsabilité est régie par les articles 1457, al. 3, 1461 et 1462 C.c.Q. L'exercice de ceux-ci peut être délégué à une autre personne, généralement le centre d'hébergement, l'hôpital ou un autre centre où vit la personne (art. 260, al. 2 C.c.Q.). Malgré cette délégation de responsabilité, le tuteur doit, tout comme la personne à qui la garde et l'entretien ont été délégués, maintenir une relation personnelle avec le majeur en tutelle, obtenir son avis et l'informer de toute décision la concernant (art. 260, al. 2 C.c.Q.). Il doit aussi assurer le bien-être moral et matériel du majeur en tutelle, en tenant compte de la condition du majeur, de ses besoins, de ses facultés et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve. L'étendue de la prestation que le tuteur doit fournir varie donc d'une personne à l'autre. La capacité d'exercice du majeur en tutelle quant aux décisions touchant sa personne est en principe définie par le jugement qui établit la tutelle (art. 288 C.c.Q.). Toutefois, le législateur a parfois préféré s'en remettre à la constatation de l'inaptitude de la personne afin de déterminer, dans des circonstances données, la capacité d'exercice d'une personne, malgré l'existence d'un régime de protection établi en sa faveur. Il en est ainsi, par exemple, en matière de soins. C'est la constatation de l'inaptitude de la personne qui limitera sa capacité de consentir aux soins et non le fait qu'elle soit soumise à un régime de protection. Le tuteur ne sera alors appelé à représenter la personne que lorsque l'inaptitude à consentir aura été constatée. Le régime particulier relatif à l'intégrité de la personne établi par le code fait de la protection de cet aspect de la personne une matière d'exception dans le régime de la tutelle à la personne. On peut, compte tenu de la préférence indiquée par le code face à la constatation de l'inaptitude comme outil d'évaluation de la capacité à consentir à ces atteintes, prévoir une contradiction entre l'incapacité d'exercer certains droits établie par le jugement de tutelle et l'application des dispositions du code contenues à ce chapitre. En effet, une personne incapable, en raison de l'établissement d'un régime de protection, d'exercer certains droits à la suite du jugement qui établit son incapacité, se voit accorder par la loi, dans certaines circonstances, une capacité d'exercice qu'elle n'aurait pas autrement eue. C'est une reconnaissance de son autonomie qui a pour effet d'élargir le domaine de la capacité de la personne représentée, dans la mesure où le jugement lui a retiré sa capacité quant à l'exercice des droits relatifs à sa personne. 3. La curatelle privée au majeur La curatelle au majeur est établie dans le cas où un majeur est inapte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, de façon totale et permanente, et qu'il a besoin d'être représenté dans l'exercice de ses droits civils (art. 281 C.c.Q.). Un curateur est alors nommé pour le représenter ; il agit à l'égard des biens et de la personne. Le régime de la curatelle est celui qui, parmi les régimes de représentation, est le plus extrême ; il retire à la personne représentée sa capacité d'exercer l'ensemble de ses droits. La personne n'a plus véritablement d'autonomie ; elle doit, dès l'ouverture du régime, être représentée dans tous les actes de la vie juridique. La curatelle crée une sorte d'incapacité d'exercice générale. L'établissement du régime de la curatelle entraîne aussi un certain nombre d'incapacités de jouissance : le majeur en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales (art. 436 C.c.Q. a contrario), il ne peut tester, ni par lui-même, ni par représentation (art. 710 et 711 C.c.Q.), il ne peut non plus donner des biens autres que des biens de peu de valeur ou des cadeaux d'usage (art. 1813 C.c.Q.), ni être, en aucun cas, administrateur d'une personne morale (art. 327 C.c.Q.) ou administrer le bien d'autrui. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 11 La capacité juridique Sylvain BOURASSA Le régime de la curatelle, compte tenu de l'importance de ses effets sur l'autonomie de la personne, est un régime exceptionnel qui ne s'applique qu'« aux personnes qui ne peuvent agir en société et dont la guérison est improbable, ainsi qu'aux personnes atteintes d'une déficience mentale profonde ou dont les facultés sont profondément et irrémédiablement altérées par une maladie ou un accident » 41 . Dans les autres cas où une inaptitude moins importante peut être établie, le régime de la tutelle est plus approprié, car il s'ajuste de façon plus précise à la situation particulière de la personne et vise à respecter, dans la mesure du possible, l'autonomie de la personne protégée. Quant à l'exercice de la curatelle sur les biens de la personne représentée, le curateur a la pleine administration, sauf qu'il est tenu de ne faire que des placements sûrs, comme une personne chargée de la simple administration (art. 282 C.c.Q.). Seules les règles portant sur l'administration du bien d'autrui s'appliquent à son administration. Ainsi, le jugement qui ouvre la curatelle ne pourrait limiter ou élargir les pouvoirs du curateur à cet égard. Ce qui distingue son administration de celle du tuteur est qu'il doit aussi faire fructifier les biens de la personne représentée, quoique ces actes soient limités, compte tenu du type de placements qu'il peut faire. Il peut aussi, pour exécuter ses obligations de curateur aux biens, aliéner un bien à titre onéreux, le grever d'un droit réel ou en changer la destination et faire tout autre acte nécessaire ou utile, sans l'autorisation du bénéficiaire ou celle du tribunal (art. 1307 C.c.Q.). La sanction des actes faits seuls par le majeur en curatelle alors qu'il est soumis au régime de protection est la nullité relative ou la réduction des obligations, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir un préjudice (art. 283 C.c.Q.). Les actes faits antérieurement à l'ouverture du régime de curatelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites sur la preuve que l'inaptitude de la personne était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés (art. 284 C.c.Q.). Quant aux obligations du curateur relatives à la protection de la personne majeure en curatelle, le curateur a la responsabilité de la garde et de l'entretien de la personne protégée. Sa responsabilité est régie par les articles 1457, al. 3, 1461 et 1462 C.c.Q. Les règles qui s'appliquent à ce titre sont les mêmes que celles qui régissent les obligations du tuteur dans le cadre d'une tutelle à la personne. Dans le cas où la curatelle est divisée entre une curatelle à la personne et une curatelle aux biens, seul le curateur à la personne peut, quant aux biens, représenter le majeur inapte en justice, et non le curateur aux biens42 . Le degré de capacité de la personne majeure en curatelle est nul. L'effet du jugement est de lui enlever, de façon générale, sa capacité d'exercice. Toutefois, en ce qui a trait au contrôle de son intégrité, les règles du Code civil qui s'y rapportent lui reconnaissent un minimum d'autonomie : elles lui donnent, dans la mesure où la personne est apte au moment où elle consent, la capacité de consentir aux soins et même, en cas d'inaptitude, une certaine capacité de refuser (par exemple, art. 12, al. 1 C.c.Q.). Il est toutefois peu probable qu'une personne soumise à un régime de curatelle soit apte à consentir. Elles lui donnent aussi, en tout temps, le dernier mot en cas de refus à l'expérimentation ou à l'aliénation d'une partie du corps (art. 23, al. 2 C.c.Q.). 4. La représentation du majeur par le curateur public La représentation du majeur inapte par le curateur public n'a lieu qu'exceptionnellement. Le législateur favorise en effet la représentation du majeur inapte par une personne de son entourage (art. 263 C.c.Q.). Dans certains cas, il s'avère toutefois impossible de trouver une personne de l'entourage pour exercer la charge de tuteur ou de curateur, ou il est dans le meilleur intérêt du majeur protégé d'être représenté par une personne autre qu'une personne de son entourage. C'est alors qu'est désigné le curateur public43 . Le Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 12 La capacité juridique Sylvain BOURASSA curateur public agira à ce titre à la suite de sa nomination par le tribunal (art. 261 C.c.Q.). Il pourra aussi agir d'office lorsque la personne a déjà été pourvue d'un tuteur ou d'un curateur afin d'éviter qu'une personne qui a déjà été représentée ne le soit plus, à la suite d'un décès ou d'une démission de son représentant ou qu'elle ne le soit pas à la suite de l'ouverture du régime de protection lorsque aucune personne n'accepte la charge (art. 12 (3) de la Loi sur le curateur public44 ). La charge du curateur public comme tuteur ou curateur n'est que temporaire. Il a en effet l'obligation de faire les démarches nécessaires afin qu'un autre représentant soit nommé (art. 15 de la Loi sur le curateur public45 ). Comme toute autre charge, elle se termine de plein droit lorsque la tutelle ou la curatelle prend fin (art. 40 de la Loi sur le curateur public46 ), notamment par le décès de la personne. Sa charge obéit aussi à des règles particulières quant à l'administration des biens et quant à la protection de la personne, plus particulièrement en ce qui a trait à la garde de la personne protégée. Le curateur public a sur les biens la simple administration, qu'il soit tuteur ou curateur (art. 262 C.c.Q.) 47 . Les règles portant sur la simple administration doivent toutefois être ajustées en fonction de celles qui sont prévues dans la Loi sur le curateur public48 et il peut exister d'autres régimes d'administration de biens, en vertu d'autres lois. Quant aux obligations et pouvoirs du curateur public relatifs à la protection de la personne, elles correspondent à celle du tuteur ou du curateur privé. Il est donc, dans tous les cas, chargé d'assurer la protection de la personne. Le curateur public n'a toutefois pas la garde de la personne protégée, à moins que cette garde ne lui soit confiée par le tribunal, en l'absence de toute autre personne pouvant l'exercer (art. 263 C.c.Q.). La garde est donc en principe confiée à une tierce personne. Cette personne agit de la même manière qu'un tuteur ou un curateur, suivant le cas, et possède les pouvoirs du tuteur ou du curateur quant au consentement aux soins requis par l'état de santé de la personne protégée, à l'exception de ceux que le curateur choisit de se réserver (art. 263, al. 2 C.c.Q.). La délégation de pouvoirs détenus par le curateur public agissant comme tuteur ou curateur peut aussi avoir lieu (art. 264 C.c.Q.)49 . Cette délégation ne peut être totale : elle ne peut viser qu'une portion des fonctions de la tutelle ou de la curatelle détenue par le curateur public. Aussi, le code établit certaines exclusions quant aux personnes à qui peuvent être délégués ces pouvoirs ; ne peut être désignée comme délégué une personne qui est salariée ou occupe une fonction dans un établissement où la personne protégée reçoit des soins, sauf s'il s'agit du conjoint ou d'un proche parent (art. 264 C.c.Q.). Le curateur public peut aussi, lorsqu'il s'est réservé le pouvoir de consentir aux soins, déléguer celui-ci à la personne désignée par la délégation (art. 264, al. 2 C.c.Q.). 5. La représentation du majeur par un mandataire Le mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude du majeur demeure, comme son nom l'indique, un mandat. Il est donc soumis aux règles générales du mandat, compte tenu des adaptations nécessaires qui résultent de l'application des dispositions particulières qui le régissent (art. 2166 et s. C.c.Q.). La particularité de cette forme de représentation est qu'elle résulte des volontés de la personne représentée50 , volontés qui ont été exprimées alors qu'elle était apte. Le mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude permet à une personne de désigner ses représentants, que ce soit relativement à la protection de sa personne, de ses biens ou les deux. Il sert aussi à orienter, à titre d'expression de sa volonté, les décisions qui seront prises à son égard. Ainsi, par exemple, on tiendra compte des intentions exprimées dans un mandat lors de l'ouverture d'un régime de protection (art. 276 C.c.Q.), de Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 13 La capacité juridique Sylvain BOURASSA même que dans l'exercice du consentement substitué en matière de soins (art. 12, al. 1 C.c.Q.). Le mandat permet surtout de simplifier, dans plusieurs cas, le processus entourant le choix d'un représentant. C'est aussi une façon de reconnaître l'importance des volontés de la personne inapte et de respecter son droit à l'autodétermination. Le mandat de protection en prévision de l'inaptitude a pour objet, selon les termes du code, « les actes destinés à assurer, en prévision de l'inaptitude du mandant à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, la protection de sa personne, l'administration, en tout ou en partie, de son patrimoine et, en général, son bien-être moral et matériel » (art. 2131 C.c.Q.). Il peut être gratuit ou à titre onéreux. Si le mandat est silencieux à ce sujet, le caractère de la charge dépendra de la qualité du mandataire. Si le mandataire est une personne physique, le mandat est présumé être à titre gratuit. S'il s'agit par ailleurs d'un mandat professionnel, le mandat est présumé être à titre onéreux (art. 2133 et 2134 C.c.Q.). Le caractère du mandat n'aura aucune incidence sur la possibilité pour le mandataire de se faire rembourser les frais raisonnables engagés dans l'exécution de son mandat (art. 2150 C.c.Q.). Il aura toutefois une incidence sur la responsabilité du mandataire (art. 2148 C.c.Q.)51 . Plusieurs conditions particulières sont prévues afin d'assurer la validité du mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude. Certaines sont liées aux parties au mandat, d'autres à la forme de l'acte et, enfin, aux mécanismes d'exécution du mandat. Les conditions liées aux parties se rapportent principalement à la capacité et à l'aptitude des parties. Le mandant doit, au moment où le mandat est donné, être une personne majeure (art. 2166 C.c.Q.) ou un mineur pleinement émancipé et être apte (art. 1398 et 1399 C.c.Q.). L'évaluation de l'aptitude du mandant se fait de la même manière qu'en matière de capacité de tester. L'aptitude du mandant doit d'ailleurs être constatée par deux témoins (art. 2166 et 2167, al. 2 C.c.Q.) ou par un notaire, le cas échéant (art. 2166 C.c.Q.), l'acte notarié faisant foi de la capacité des parties à l'acte (art. 2814 (6)> C.c.Q. et art. 43 de la Loi sur le notariat)52 . Le mandataire doit aussi avoir la capacité de contracter et être apte à représenter une autre personne. L'évaluation de ces conditions aura lieu non pas au moment où le mandat est donné, mais lors de l'entrée en fonction du mandataire, c'est-à-dire lors de l'homologation du mandat, puis tout au long de son exécution. Le mandat prend d'ailleurs fin, entre autres, par l'ouverture d'un régime de protection à l'égard du mandataire, lorsque ce régime lui enlève la capacité d'exercer les actes qu'il est chargé d'accomplir en vertu de son mandat (art. 2175, al. 2 C.c.Q.). Le mandataire doit aussi être, en principe, une personne physique, sauf s'il s'agit de l'administration de biens. Dans ce cas, certaines personnes morales peuvent, dans la mesure où elles sont autorisées par la loi, exercer la charge de tuteur ou de curateur aux biens (art. 304 C.c.Q.). Cette règle s'applique au mandataire nommé dans un mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude, car par assimilation et par interprétation, le mandataire agit comme tuteur aux biens ou à la personne du mandant (art. 2168 C.c.Q.). Les conditions liées à la forme du mandat sont essentielles à la validité de l'acte. Le mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude du mandant est donc un contrat formaliste. Le mandat peut être fait suivant l'une ou l'autre des deux formes prévues par la loi : l'acte notarié et l'acte devant témoins (art. 2166 C.c.Q.). Le mandat fait par acte notarié en minute ne présente pas de caractères particuliers autres que ceux qui se rattachent à tout acte notarié (art. 2166 C.c.Q.). Le mandat donné en prévision de l'inaptitude doit Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 14 La capacité juridique Sylvain BOURASSA être inscrit au registre des dispositions testamentaires et des mandats de protection donnés en prévision de l'inaptitude53 . Le mandat fait devant témoins peut être rédigé par le mandant ou par un tiers. Il doit être signé au nom du mandant par lui ou par un tiers, suivant ses instructions, et par deux témoins qui n'ont pas d'intérêt à l'acte et qui, surtout, peuvent constater l'aptitude du mandant à agir. Sont considérés comme ayant un intérêt à l'acte, le mandataire et le mandataire substituant. Les autres formalités liées aux attestations qui doivent y être contenues et aux signatures sont prévues dans le code (art. 2167 C.c.Q.). Le mandat fait sous cette forme ne sera pas nécessairement rendu public, sauf s'il est déposé chez un notaire ou un avocat ; il devra alors être inscrit au registre approprié54 . C'est le mandat qui détermine les pouvoirs du mandataire. Lorsque, toutefois, la portée du mandat est douteuse, il doit alors être interprété par le mandataire selon les règles relatives à la tutelle au majeur qui les détermineront à leur tour (art. 2168, al. 1 C.c.Q.). Si le mandat est clair mais insuffisant pour protéger le majeur, il doit être complété par un autre régime de protection établi suivant le degré d'inaptitude et les besoins de la personne. Le mandat continue de produire ses effets malgré l'ouverture d'un régime de protection autre (art. 2169 C.c.Q.). La relation entre l'exécution du mandat et la charge imposée en vertu d'un autre régime de protection quant au rôle et aux obligations de chacun des représentants est aménagée par le code. Le rôle et les pouvoirs de chacun sont déterminés par le document qui crée leur charge. Dans le cas du mandataire, il s'agit du mandat homologué ; dans le cas des autres représentants, il s'agit du jugement qui établit le régime de protection. Dans tous les cas, les représentants, quels qu'ils soient, doivent rendre compte à celui qui assure la protection de la personne (art. 2169 C.c.Q.). Si la portée du mandat est trop large compte tenu du degré d'inaptitude du mandant, il convient alors de ne pas l'homologuer afin de ne pas restreindre indûment la capacité de la personne qui requiert une protection. Le juge ne peut pas substituer son interprétation du mandat, il doit s'en tenir à son contenu. Il semble alors plus approprié de demander l'ouverture d'un régime de protection qui sera mieux adapté aux circonstances du mandant, tout en tenant compte des volontés exprimées dans le mandat (art. 276, al. 1 C.c.Q.)55 . On imagine mal qu'un mandat trop étendu puisse être découpé en parties en fonction des dispositions de l'acte qui pourraient s'appliquer au regard de l'inaptitude particulière du mandant. L'effet du mandat sur la capacité du mandant dépend de son homologation. Avant celle-ci, la capacité du mandant demeure intacte. Il peut donc, en principe, exercer ses droits civils sans représentation. Les actes faits par celui-ci antérieurement à l'homologation peuvent toutefois être annulés et les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l'inaptitude du mandant était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés (art. 2170 C.c.Q.). Aucune preuve de préjudice n'est nécessaire. Lorsque le mandat vise des actes relatifs à la protection de la personne, les termes du mandat doivent être interprétés avec souplesse. Ils constituent une expression de la volonté de la personne quant à sa protection et ne fixent l'étendue des pouvoirs du mandataire qu'en fonction de la nature générale des actes que le mandataire pourra poser. Par exemple, en matière de consentement aux soins, lorsqu'une personne exprime ses volontés de fin de vie, les termes du mandat doivent être interprétés suivant l'esprit général qui se dégage de l'expression des volontés dont on devra nécessairement tenir compte. 2- La mise en oeuvre de la protection Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 15 La capacité juridique Sylvain BOURASSA A- Les régimes de protection prévus par la loi L'ouverture d'un régime de protection, quel qu'il soit, est prononcée par le tribunal (art. 268 C.c.Q.)56 . Elle peut être demandée par « le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents et alliés, toute personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur ou tout autre intéressé, y compris le mandataire désigné par le majeur ou le curateur public » (art. 269 C.c.Q.). L'énumération de cette classe de personnes correspond à la description des personnes qui ont un intérêt envers la personne pour laquelle l'ouverture d'un régime est demandée. L'interprétation de ce qui constitue un intérêt envers la personne inapte est d'ailleurs assez large. Les établissements de santé ou de services sociaux57 , de même que leurs employés, ne sont toutefois pas considérés comme des personnes intéressées. Ils doivent, lorsqu'ils constatent qu'une personne est inapte, faire un rapport d'inaptitude au curateur public et en donner copie à un proche du majeur, qui procéderont, selon le cas, à la demande d'ouverture du régime de protection (art. 270 C.c.Q.). Le rapport d'inaptitude doit faire état de la situation générale de la personne, notamment de son besoin d'être assistée ou représentée dans l'exercice de ses droits civils suivant des motifs déterminés : son isolement, la durée prévisible de son inaptitude, la nature ou l'état de ses affaires, le fait qu'elle ne soit pas représentée par un mandataire désigné qui lui assure une assistance ou une représentation adéquate. Il doit aussi faire état de la nature et du degré d'inaptitude de la personne, de l'étendue de ses besoins, de l'ensemble des circonstances de sa condition. Les noms des personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture du régime de protection doivent aussi être mentionnés, s'ils sont connus des intervenants en santé et en services sociaux, afin de permettre au curateur public d'évaluer la situation familiale de la personne et d'identifier les personnes qui pourraient prendre en charge le majeur inapte (art. 270, al. 2 C.c.Q.). Ces informations sont consignées par le directeur général de l'établissement (art. 270, al. 1 C.c.Q.). Le rapport doit aussi contenir une évaluation médicale et psychosociale de la personne faite par celle qui l'a examinée. Ces rapports constituent la pierre angulaire de la mise en oeuvre de tout régime de protection. Une fois le rapport d'inaptitude acheminé au curateur public, celui-ci doit alors prendre toutes les mesures nécessaires afin d'évaluer la situation de la personne inapte dans un délai raisonnable58 . S'il juge approprié de demander l'ouverture d'un régime de protection, le curateur public doit alors transmettre au greffier sa recommandation, accompagnée du rapport d'inaptitude, et aviser les personnes habilitées à demander l'ouverture d'un régime de protection du dépôt du rapport au greffe (art. 14 de la Loi sur le curateur public). Lorsque, dans les 30 jours du dépôt de la recommandation, aucune personne n'a fait de demande d'ouverture de régime de protection, le greffier en avise le curateur public qui fera alors la demande (art. 406 C.p.c.). Dans les autres cas de demande d'ouverture de régime de protection, les étapes de la procédure sont plus simples (art. 268 et s. C.c.Q. ; art. 44, 121, 393 et 404 C.p.c.). La demande est introduite devant le juge du district où le majeur a son domicile ou sa résidence (art. 44, 121, 303, 306, 308, 393 et 404 C.p.c.). Lorsque la demande n'est pas contestée, elle peut être présentée devant le greffier (art. 69, 73 et 74 C.p.c.) ou devant un notaire (art. 312, 313, 393, 394 et 404 C.p.c.). La demande présentée devant le tribunal ou le greffier doit être accompagnée de l'évaluation médicale et psychosociale afin de permettre au tribunal d'évaluer le degré d'inaptitude de la personne (art. 276 et 288 C.c.Q.)59 . L'absence de l'évaluation ou d'une partie de celle-ci n'empêche toutefois pas le tribunal d'ordonner l'ouverture d'un régime de protection60 . Le tribunal saisi de la demande prendra alors l'avis des personnes susceptibles Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 16 La capacité juridique Sylvain BOURASSA de former le conseil de tutelle et considérera les volontés du majeur (art. 276 C.c.Q.)61 . Lorsque la demande est faite devant notaire, celui-ci doit, tout comme dans les cas de tutelle au mineur, déposer, au greffe du tribunal du domicile ou de la résidence du majeur, une copie authentique du procès-verbal dressé par lui concernant l'établissement du régime de protection, ainsi que toutes les pièces justificatives (art. 318 et 320 C.p.c.). Le notaire doit obtenir l'évaluation médicale et psychosociale, l'interrogatoire du majeur et les autres pièces pertinentes à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis (art. 314 et 315 C.p.c.) et en faire état. Le tribunal saisi par le dépôt du procès-verbal n'est pas tenu par les conclusions du notaire et peut rendre toutes les ordonnances qu'il jugera nécessaires à la sauvegarde des droits des parties (art. 320 C.p.c.). Le majeur concerné par la demande d'ouverture du régime doit, dans tous les cas, être entendu, à moins qu'il soit déraisonnable de l'interroger compte tenu de son état de santé (art. 276, al. 2 C.c.Q. et art. 315, 391 et 392 C.p.c.)62 . Un procureur sera aussi nommé pour le représenter si le tribunal constate qu'il est nécessaire qu'il en soit ainsi afin que les intérêts de la personne visée par la demande soient protégés (art. 90, 160, 290, 291 et 316 C.p.c.). Les conditions qui encadrent le recours en demande d'ouverture de régime de protection ne constituent pas toutes des garanties procédurales, même si elles ont pour but d'assurer le respect des droits de la personne visée, l'indépendance et la transparence du processus63 . C'est le cas par exemple de l'évaluation médicale et psychosociale ou, encore, de la convocation du conseil de tutelle64 , qui ne sont pas considérées comme des garanties procédurales. Certaines mesures provisoires peuvent être prises avant l'ouverture du régime afin d'éviter que la personne concernée ne subisse de préjudice sérieux quant à sa personne ou à ses biens. Des mesures visant la protection de la personne peuvent être prises durant l'instance d'ouverture de régime de protection et même avant, si la demande d'ouverture de régime est imminente. Durant l'instance, le tribunal peut, même d'office, statuer sur la garde du majeur, « s'il est manifeste qu'il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire afin de lui éviter un préjudice sérieux » (art. 272 C.c.Q.). Il peut aussi prendre toute autre mesure qui pourrait être prise avant l'instance. La situation visée par cette mesure ne doit pas être confondue avec celle qui vise la garde en établissement psychiatrique. Le but de chacune des demandes est différent. Dans le premier cas, la demande vise à protéger la personne durant l'instance en ouverture d'un régime. La personne visée n'a pas nécessairement de problèmes de nature psychiatrique ; elle ne fait que présenter, de façon manifeste, une inaptitude à prendre soin d'elle-même. Dans le second, la garde vise à permettre qu'il soit procédé à un examen psychiatrique d'une personne qui, en raison de son état mental, présente un danger pour elle-même ou pour autrui (art. 26 et 27 C.c.Q.). Avant l'instance, des mesures visant la protection de la personne du majeur ou sa représentation dans l'exercice de ses droits civils peuvent aussi être prises si une demande d'ouverture de régime est imminente et qu'il y a lieu d'agir afin d'éviter que le majeur ne subisse un préjudice sérieux. Dans ces cas, le curateur public ou une autre personne peuvent être désignés afin d'agir à ces fins (art. 272 C.c.Q. ). Tout comme on l'exige pour justifier l'accomplissement d'un acte relatif à la protection des biens du majeur avant l'instance, la personne qui désire agir afin de protéger la personne du majeur en vertu de l'article 272 C.c.Q. devra démontrer que la demande d'ouverture est imminente. Une simple allégation qu'une telle demande est imminente ne suffira pas. Le contexte factuel et juridique particulier au majeur devra aussi être allégué. Par ailleurs, il convient de faire une distinction entre les mesures particulières nécessaires à la Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 17 La capacité juridique Sylvain BOURASSA protection de la personne ou à sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et les mesures qui se rapportent aux soins. En matière de soins, l'établissement d'un régime de protection n'est pas nécessaire à la validité d'un consentement substitué. Les solutions relatives aux décisions portant sur l'intégrité de la personne en matière de soins, d'expérimentation et d'aliénation d'une partie du corps ne reposent pas nécessairement sur l'établissement d'un régime de protection. Elles sont soumises à leur propre régime qui repose principalement sur la constatation d'une inhabileté factuelle à consentir à une atteinte à l'intégrité et non pas sur une inaptitude au sens retenu pour l'ouverture d'un régime de protection. La personne peut, dans ces cas, sur la simple constatation de son inaptitude à consentir aux soins, être représentée. Quant à la protection des biens de la personne visée par une demande d'ouverture d'un régime de protection, certaines mesures provisoires peuvent être prises durant l'instance et même avant, lorsque la demande d'ouverture est imminente (art. 273 et 274 C.c.Q.). Encore ici, il ne suffit pas d'alléguer que la demande est imminente afin de justifier une demande de mesure provisoire de protection avant l'instance. La demande doit être fondée sur le contexte factuel et juridique dans lequel se trouve le majeur. La protection accordée aux biens avant l'instance prend plusieurs formes. Dans un premier temps, lorsque le majeur est déjà représenté par une personne qu'il a chargée de l'administration de ses biens, le mandat ainsi donné continue de produire ses effets malgré l'instance, à moins que celui-ci ne soit révoqué par le tribunal ; il ne peut être révoqué que pour un motif sérieux (art. 273, al. 1 C.c.Q.). Les formes que peut prendre le mandat qui continue d'avoir effet sont variées. Il peut s'agir d'un mandat qui répond aux règles ordinaires du mandat (art. 2130 et s. C.c.Q.), de celui qui est accordé à un époux par le tribunal aux fins d'administration des biens de son conjoint (art. 444 C.c.Q.) ou encore d'un mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude du mandant (art. 2166 et s. C.c.Q.). Dans un deuxième temps, les biens peuvent être protégés, même en l'absence d'un mandat, si une demande d'ouverture d'un régime de protection est imminente. Une personne qui a qualité pour demander l'ouverture d'un régime de protection peut faire, en cas d'urgence, les actes nécessaires à la conservation du patrimoine de la personne visée, en suivant les règles de la gestion d'affaires (art. 273, al. 2 C.c.Q.). Cette situation se distingue de celle qui est prévue à l'article 274 C.c.Q., par l'existence d'une situation d'urgence, qui fait en sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une autorisation du tribunal afin d'agir selon les règles de la gestion d'affaires (art. 1482 et s. C.c.Q.). En dernier lieu, lorsqu'une demande d'ouverture du régime est imminente, le tribunal peut désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne afin qu'ils accomplissent un acte déterminé ou qu'ils administrent les biens du majeur dans les limites de la simple administration du bien d'autrui, lorsqu'il y a lieu d'agir immédiatement pour éviter un préjudice sérieux au patrimoine du majeur (art. 274 C.c.Q.). L'acte déterminé est celui qui dépasse les limites de la simple administration. Durant l'instance, les mêmes mécanismes de protection du patrimoine sont ouverts suivant les mêmes principes (art. 273 et 274 C.c.Q.). Toutefois, en plus de ces mesures, certains actes d'aliénation peuvent être faits, mais dans les seules limites prévues par le code (art. 275 C.c.Q.). Ces actes sont exceptionnels, le principe étant la conservation du patrimoine du majeur. L'ouverture du régime de protection a lieu à la suite de la décision du tribunal. Celui-ci n'est pas lié par la demande d'ouverture du régime et peut fixer le régime qu'il juge approprié dans les circonstances (art. 268 C.c.Q.). Même s'il peut exercer une très large discrétion lors de l'ouverture d'un régime de protection, le tribunal doit toutefois s'en tenir aux conditions fixées par la loi. Il ne peut en fixer d'autres Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 18 La capacité juridique Sylvain BOURASSA 65 , la procédure d'ouverture de régime de protection étant d'ordre public66 . Cette décision est en tout temps susceptible de révision (art. 277 C.c.Q.) et peut faire l'objet d'un appel de plein droit (art. 30 C.p.c.)67 . Elle est aussi susceptible d'être en tout temps révisée. La demande de révision est soumise aux mêmes règles procédurales que la demande d'ouverture de régime. Elle doit donc se faire par voie de demande (art. 391 et s. C.p.c.). La révision d'une décision rendue par le greffier en cette matière se fait aussi en vertu des articles 391 et s. C.p.c. et non de l'article 74 C.p.c. En tout état de cause, le régime de protection est réévalué à tous les trois ans, s'il s'agit d'une tutelle ou s'il y a eu nomination d'un conseiller et à tous les cinq ans, s'il s'agit d'une curatelle, à moins que le tribunal ne fixe un autre délai (art. 278 C.c.Q.). Le représentant doit veiller à ce que soit réévalué le majeur en temps voulu (art. 278, al. 2 C.c.Q.). Une obligation similaire est imposée au directeur d'un établissement de santé et de services sociaux lorsqu'il constate la cessation de l'inaptitude qui justifie le régime de protection. Il doit alors en faire rapport et déposer celui-ci au greffe (art. 279 C.c.Q.). La fin du régime de protection a lieu par l'effet d'un jugement de mainlevée, par l'expiration du délai prévu pour contester le rapport d'aptitude fait par un directeur d'un établissement de santé ou de services sociaux (art. 280 C.c.Q.) ou par le décès du majeur représenté (art. 295 C.c.Q.). B- Le régime de protection établi par un mandat La mise en oeuvre de la protection d'une personne inapte par un mandat de protection donné en prévision de son inaptitude repose sur deux étapes : la constatation de l'inaptitude du mandant et l'homologation du mandat par le tribunal (art. 2166, al. 2 C.c.Q.) ou la constatation de sa prise d'effet par un notaire (art. 312, 393, 394 et 404 C.p.c.)68 . L'inaptitude du mandant est, comme pour toute autre forme de représentation en vue de protéger une personne inapte, la clé dans la mise en oeuvre de la protection. La constatation de l'inaptitude du majeur peut être établie suivant différents moyens, mais elle doit inclure les évaluations médicale et psychosociale (art. 309 et 315 C.p.c.). L'homologation constitue l'étape finale qui a pour effet de constater l'inaptitude du majeur visé par le mandat, de rendre le mandat exécutoire et d'ouvrir le régime de représentation établi par le mandat. Elle vise surtout à vérifier l'existence réelle de l'inaptitude du mandant et à s'assurer de la validité du mandat, lorsqu'il s'agit d'un mandat devant témoins. Le tribunal n'est pas tenu d'homologuer le mandat, même sur constatation de l'inaptitude et de la validité du mandat. La conduite du mandataire peut en effet faire en sorte que le tribunal choisisse de ne pas confirmer le mandataire comme représentant du mandant. Ainsi, le fait pour le mandataire de ne pas agir dans l'intérêt du mandant, en faisant passer ses propres intérêts avant ceux du mandant et en démontrant une conduite abusive envers le mandant peut constituer un motif suffisant pour refuser l'homologation. L'homologation est demandée par le mandataire et est présentée par une demande introductive d'instance devant un juge ou le greffier du district où le mandant a son domicile ou sa résidence (art. 44 , 121, 393, 394 et 404 C.p.c.). Quant au mandat fait devant le notaire, le tribunal est saisi par le dépôt du procès-verbal du notaire (art. 304, 317 et 320 C.p.c.). Comme pour toute procédure mettant en cause l'état ou la capacité d'une personne, le mandant doit recevoir signification à personne (art. 44, 121, 312, 393, 394 et 404 C.p.c.). Une personne de la famille, ainsi que le curateur public doivent aussi recevoir signification de la demande en homologation. Le défaut de signification à une personne énumérée pourra suspendre l'homologation du mandat jusqu'à ce que toutes les significations requises soient faites, sous réserve d'une demande d'administration provisoire en vertu de l'article 272 C.c.Q. Les Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 19 La capacité juridique Sylvain BOURASSA règles qui se rapportent à l'instruction de la demande en homologation sont les mêmes que pour toute demande d'ouverture d'un régime de protection, la principale étant le droit du mandant de se faire entendre, sauf exception (art. 44, 121, 393 et 404 C.p.c.)69 . Lorsque la demande de mise en oeuvre du mandat est faite devant notaire, doivent aussi recevoir signification, le mandataire, et le mandataire substitut, le curateur public et une personne mentionnée à l'article 15 C.c.Q. (art. 312, 393, 394 et 404 C.p.c.). Le code prévoit la possibilité de prendre des mesures en vue de protéger la personne devenue inapte ou ses biens, que ce soit durant l'instance d'homologation du mandat ou avant, si la demande d'homologation est imminente et qu'il y a lieu d'agir pour éviter un préjudice sérieux (art. 2167.1 C.c.Q. ). Le tribunal peut alors rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour assurer la protection de la personne du mandant, sa représentation dans l'exercice de ses droits civils ou l'administration de ses biens. Aussi, l'acte par lequel le mandant a chargé une personne de l'administration de ses biens continue de produire ses effets malgré l'instance, à moins que celui-ci ne soit révoqué par le tribunal pour un motif sérieux (art. 2167.1, al. 2 C.c.Q.). Les mesures de protection sont donc similaires à celles qui sont prévues dans le cadre des demandes d'ouverture de régime de protection. Le mandat cesse d'avoir effet lorsque le tribunal constate que le mandant est redevenu apte (art. 2172 C.c.Q.). À la suite de cette constatation, le mandant est libre de révoquer le mandat. Il peut toutefois le laisser subsister. Ce même mandat ne prendra alors effet à nouveau qu'en suivant les règles normales qui exigent que l'inaptitude soit constatée et que le mandat soit homologué. Le mandat peut aussi prendre fin par l'expiration du délai prévu pour contester le rapport d'aptitude fait par le directeur d'un établissement de santé ou de services sociaux (art. 2173 C.c.Q.), par la renonciation du mandataire, par l'extinction du pouvoir qui lui a été donné, par le décès du mandant ou du mandataire (art. 2183 C.c.Q.) ou, dans certains cas, par l'ouverture d'un régime de protection à l'égard de l'une ou l'autre des parties (art. 2175 C.c.Q.). Dans le cas de renonciation, le mandataire doit d'abord avoir pourvu à son remplacement, si le mandat le prévoit, ou avoir demandé l'ouverture d'un régime de protection (art. 2174 C.c.Q.). La fin du mandat par l'ouverture d'un régime de protection à l'égard de l'une ou l'autre des parties n'est pas automatique. Lorsque l'ouverture d'un régime de protection vise à protéger le mandant de façon plus complète, l'ouverture du régime ne mettra pas fin au mandat, sauf s'il vise à remplacer le mandat. Il en sera ainsi dans les cas où le tribunal juge que le mandat n'est pas fidèlement exécuté par le mandataire ou lorsque, pour quelqu'autre motif sérieux, il y a lieu d'y mettre fin (art. 2177 C.c.Q.). La demande au tribunal peut être faite par toute personne intéressée, y compris le curateur public. Si, par ailleurs, un régime de protection est ouvert afin de protéger le mandataire, il sera généralement mis fin au mandat, compte tenu de l'incapacité établie à l'égard du mandataire. Si toutefois l'incapacité ainsi prononcée ne vise pas les actes que le mandataire est chargé d'exécuter dans le cadre de son mandat, celui-ci continuera de produire ses effets. e * L'auteur remercie M Julie Baril de la Direction des affaires juridiques du TAQ pour sa collaboration à la révision de ce e texte. Ce texte a été initialement rédigé par M France Allard. 1. Paul-André CRÉPEAU et al., Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, Les obligations, Cowansville, o C.R.D.P.C.Q./Éditions Yvon Blais, 2003, v capacité de jouissance, p. 36. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 20 La capacité juridique Sylvain BOURASSA o 2. P.-A. CRÉPEAU et al., op. cit., note 1, v capacité d'exercice, p. 36 ; Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit e o des personnes physiques, 4 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, n 423, p. 377, EYB2008DPP14. e o 3. Jean CARBONNIER, Droit civil. Les personnes, 20 éd., Paris, P.U.F., 1996, n 2, p. 13. 4. Loi sur le mariage (degrés prohibés), L.R.C. (1985), c. M-2.1. o 5. É. DELEURY et D. GOUBAU, op. cit., note 2, n 430, p. 381. 6. Le terme mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant tel qu'il existait à l'article 2166 C.c.Q. est modifié par l'expression « mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude du mandant » par l'article 795 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile. 7. Voir Bédard c. Roussin Parfumerie Inc., 2006 QCCQ 1074, EYB 2006-112442, où le tribunal a considéré qu'un enfant de 13 ans et sept mois pouvait s'engager valablement par contrat pour le perçage du nombril (qui fait partie des besoins ordinaires et usuels) ; voir également Laforest c. Copies et ordinateurs Marie Inc., 2009 QCCQ 2221, EYB 2009-202890, où le tribunal a considéré que l'achat d'un ordinateur constitue un besoin ordinaire et usuel pour tout étudiant du collégial au sens de l'article 157 C.c.Q. 8. Voir Droit de la famille – 09746, 2009 QCCA 623, EYB 2009-156980, où la Cour d'appel a confirmé que le recours d'un enfant de 12 ans visant à contester une décision prise par le titulaire de l'autorité parentale est sujet à l'autorisation du tribunal mais seulement en présence de circonstances exceptionnelles ; voir également Droit de la famille – 081485, 2008 QCCS 2709, EYB 2008-134908 (jugement de première instance). 9. Par exemple, l'article 549 C.c.Q. fixe à 10 ans l'âge auquel le mineur peut consentir à l'adoption. 10. Art. 17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2. 11. Sur les critères de qualification des actes d'administration, voir les articles 1301 et s. C.c.Q. 12. Voir X c. A, 2009 QCCS 194, EYB 2009-153400. 13. Sur les consentements requis pour le mariage du mineur, voir l'article 373 C.c.Q. Il est intéressant de noter que l'article 373 C.c.Q. ne mentionne plus l'âge minimal requis pour contracter mariage, se limitant à l'exigence du consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur. Les autres dispositions sur la capacité du mineur ne mentionnent pas plus l'âge requis pour contracter mariage. On peut se demander si, pour se marier, l'exigence que le mineur soit âgé d'au moins 16 ans subsiste. Il convient de noter que, contrairement au mariage, l'union civile ne peut être contractée par un mineur (art. 521.1 C.c.Q.). 14. P. (V.) c. Curateur public du Québec, J.E. 94-905, EYB 1994-73362 (C.S.). Notons que le jugement est principalement fondé sur l'analyse de l'intérêt de l'enfant plutôt que sur la nature du motif invoqué. 15. Droit de la famille – 2039, J.E. 94-1377, EYB 1994-73438 (C.S.). 16. M. (S.) (Re), [1995] R.D.F. 675, EYB 1995-72490 (C.S.). Voir aussi Droit de la famille – 2399, [1996] R.D.F. 268, REJB 1996-29213 (C.S.), où les disputes entre l'enfant de 17 ans et sa mère, la difficulté pour la mère d'exercer son autorité et de faire vivre l'enfant sous son toit n'ont pas été considérés comme des motifs sérieux, la demande ayant pour but de permettre à l'enfant de recevoir des prestations de sécurité du revenu et de ne plus vivre sous le toit des parents. 17. Droit de la famille – 2197, [1995] R.D.F. 420, EYB 1995-72825 (C.S.). 18. L.C. 2002, c. 1. 19. RLRQ, c. P-34.1. 20. W. (M.) c. C. (J.), Droit de la famille – 131552, EYB 2013-223080 (C.A.). Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 21 La capacité juridique Sylvain BOURASSA 21. Gallup c. Boucher, EYB 2012-202175 (C.S.). 22. Voir Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, EYB 1989-67833. 23. Voir Compagnie d'assurance-vie Manufacturers (Financière Manuvie) c. Massouh, 2010 QCCS 2060, EYB 2010-174157, où le juge Bernard Godbout a mentionné au paragraphe 36 que l'article 192 C.c.Q. est une disposition d'ordre public. 24. Art. 597 et s. C.c.Q. pour une énumération des attributs de l'autorité parentale. 25. Droit de la famille – 121331, EYB 2012-207475 (C.S.). 26. H.(S.) c. G.(M.), Droit de la famille – 133181, EYB 2013-229277 (C.A.). 27. Art. 12 (3) de la Loi sur le curateur public, RLRQ, c. C-81. 28. Voir aussi l'article 25 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57, . 29. Tremblay c. Fisch, 2007 QCCS 6546, EYB 2007-125692. 30. Voir Québec (Curateur public) et L.D., 2010 QCCS 5767, EYB 2010-182739 ; voir également C. (M.) c. C. (G.), EYB 2012-206944 (C.Q.). 31. Voir toutefois l'article 221 C.c.Q. relativement au directeur de la protection de la jeunesse. 32. Voir H.P. c. Québec (Curateur public), 2010 QCCS 2762, EYB 2010-181695, où le juge Marc Lesage estime que le mot « suppléer » signifie le fait d'« ajouter ce qui manque pour combler une lacune » et qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire dont jouit le tribunal. 33. Art. 28.2 et s. de la Loi sur le curateur public, précitée, note 27. 34. Art. 12 et 20 et s. de la Loi sur le curateur public, précitée, note 27. 35. Re V. (E.), EYB 2013-229497 (C.S.) ; Québec (Curateur public) c. M. (R.), EYB 2013-227996 (C.S.). 36. Voir sur l'évaluation de l'inaptitude d'une personne et des causes qui peuvent servir à l'établir : M.-W. (J.) c. C.-W. (S.), [1996] R.J.Q. 229, EYB 1996-71138 (C.A.). 37. Québec (Curateur public) c. G. (M.), EYB 2013-227997 (C.S.). 38. Voir C. (C.) c. E. (F.), EYB 2012-214978 (C.S.). 39. Voir l'article 52 de la Loi sur le curateur public, précitée, note 27. 40. C. (R.) c. Québec (Régie de l'assurance-maladie), EYB 2013-224211 (C.Q.). 41. Commentaires du ministre de la Justice, t. I, Québec, Les Publications du Québec, 1993, p. 191, EYB1993CM282. 42. C.C. c. M.C., 2011 QCCA 1235, EYB 2011-192685, par. 82. 43. Québec (Curateur public) c. F. (G.), EYB 2012-206737 (C.S.). 44. Précitée, note 27. 45. Ibid. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 22 La capacité juridique Sylvain BOURASSA 46. Ibid. 47. Voir aussi l'article 30 de la Loi sur le curateur public, précitée, note 27. 48. Précitée, note 27, art. 28.2 et s. 49. Voir aussi l'article 17 de la Loi sur le curateur public, précitée, note 27. 50. C. (M.) c. A. (H.), EYB 2013-218133 (C.S.). 51. Saint-Amand, ès qualités c. Saint-Amand, EYB 2013-223092 (C.S.). 52. RLRQ, c. N-3. 53. Voir Loi sur le notariat, précitée, note 52, art. 93 et s. et le Règlement sur les registres de la chambre des notaires du Québec, RLRQ, c. N-3, r. 13. 54. Id., pour l'inscription du mandat déposé chez un notaire. Pour l'inscription d'un mandat déposé chez un avocat, voir Loi sur le Barreau, RLRQ, c. B-1art. 15 et le Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de l'inaptitude, RLRQ, c. B-1, r. 18. 55. Voir L.P. c. F.H., 2009 QCCA 984, EYB 2009-158975, où la Cour d'appel est d'avis que le juge de première instance aurait dû refuser d'homologuer le mandat et faire appel au pouvoir que lui confère l'article 46 C.p.c. (remplacé par l'article 49 C.p.c.) pour ouvrir un régime de protection adéquat à la situation vu que l'inaptitude de l'appelante était partielle et qu'il y avait absence de demande en ouverture de régime de protection. 56. C. (C.) c. E. (F.), précité, note 38. 57. Voir les articles 79 et s. de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, précitée, note 10, qui énumèrent les établissements fournisseurs de services de santé et de services sociaux. 58. Art. 14 de la Loi sur le curateur public, précitée, note 27, qui fait une énumération du type de mesures que le curateur public peut prendre à cet effet. 59. Voir aussi l'article 22 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, précitée, note 10 sur l'accès aux évaluations médicales et psychosociales. 60. C.D. c. Québec (Curateur public), [2001] R.J.Q. 1708, REJB 2001-25356 (C.A.). 61. Kasovicz c. Barzik, [1990] R.J.Q. 2800, EYB 1990-57090 (C.A.), où le tribunal a exigé des preuves additionnelles afin d'évaluer l'inaptitude du majeur. 62. Voir J.C. c. Québec (Curateur public), 2010 QCCA 1113, EYB 2010-175092 ; H.G. c. S.G., 2011 QCCA 61, EYB 2011-184735 ; N. (G.) c. L. (E.), EYB 2012-213774 (C.S.) ; Québec (Curateur public) c. T. (L.), EYB 2013-221778 (C.A.). 63. C.D. c. Québec (Curateur public), précité, note 60. 64. Voir, par exemple, L.H. c. Québec (Curateur public), [2001] R.D.F. 4, REJB 2001-22099 (C.A.). 65. Curateur public du Québec c. D.P., [2001] R.J.Q. 45, REJB 2000-22326 (C.A.). 66. Québec (Curateur public) c. B. (M.), REJB 2003-43236 (C.A.). 67. P. (D.) c. G. (Do), EYB 2013-223168 (C.A.). Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 23 La capacité juridique Sylvain BOURASSA 68. Lors de l'adoption de la Loi modifiant le Code de procédure civile en matière notariale et d'autres dispositions législatives (L.Q. 1998, c. 51), l'article 2166 C.c.Q. n'a toutefois pas été modifié afin de préciser que le mandat pouvait prendre effet sur constatation, par un notaire, de l'inaptitude du mandant. Il en est encore ainsi avec la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile. L'article 795 modifiant l'article 2166 C.c.Q. inchangé sur cet aspect. 69. Dans H.G. c. S.G., précité, note 62, la Cour d'appel a cassé le jugement d'homologation du mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude vu que l'exigence procédurale de l'ancien article 878 C.p.c. maintenant prévu aux articles 315, 391 et 392 C.p.c. (interrogatoire du mandant) n'avait pas été entièrement satisfaite. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 24 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA EYB2016CDD107 Personnes, famille et successions, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 3, 2016 Sylvain BOURASSA* Les droits de la personnalité Indexation Personnes ; personnes physiques ; droits de la personnalité ; intégrité ; consentement aux soins ; garde en établissement ; respect du corps après le décès ; réputation ; vie privée ; nom ; utilisation ; Droits et libertés ; Charte des droits et libertés de la personne ; libertés et droits fondamentaux ; droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne ; droit à la dignité, à l'honneur et à la réputation ; droit au respect de la vie privée ; Procédure civile ; procédures spéciales ; intégrité de la personne ; consentement aux soins ; Accès à l'information ; protection des renseignements personnels dans le secteur privé ; application ; confidentialité des renseignements personnels ; recours ; Pénal ; troubles mentaux ; Commission d'examen ; protection du public TABLE DES MATIÈRES 1- La nature des droits de la personnalité 2- Les différents droits de la personnalité A- Les droits à la vie, à la dignité et à l'autonomie 1. Le droit à la vie 2. Le droit à la dignité 3. Le droit à l'autonomie B- Le droit à l'intégrité 1. Le consentement aux soins a) Le consentement substitué 1) La personne majeure inapte 2) La personne mineure i) Le mineur de 14 ans et plus ii) Le mineur de moins de 14 ans 2. La recherche (L'expérimentation a) La personne majeure apte b) La personne majeure inapte et le mineur 1) La recherche sur une seule personne 2) La recherche sur un groupe de personnes 3. L'aliénation d'une partie du corps a) L'aliénation entre vifs 1) La personne majeure apte Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 1 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA 2) La personne majeure inapte ou le mineur b) L'aliénation après le décès 4. Le respect du corps après le décès 5. La garde en établissement 6. La Commission d'examen pour troubles mentaux C- Les droits à l'honneur et à la réputation D- Les droits au nom et à l'image 1. Le droit au nom 2. Le droit à l'image E- Le droit au respect de la vie privée 1. La protection générale 2. La protection des renseignements personnels dans le secteur privé F- L'intérêt de l'enfant 1- La nature des droits de la personnalité Les droits de la personnalité, aussi parfois qualifiés de droits primordiaux, sont des droits inhérents à la personne. Ils correspondent le plus souvent aux droits fondamentaux, quoique dans un contexte de droit privé1. Ils existent en faveur de la personne dès lors que la personnalité juridique lui est reconnue2. Ils ont pour fonction d'assurer la protection de ce qui constitue l'individualité propre de la personne, son essence, sa dignité. En ce sens, la classe des droits de la personnalité est difficilement déterminable, car elle varie dans le temps et dans l'espace selon ce qui sera considéré comme constituant l'essence de la personne. Le Code civil n'établit d'ailleurs pas une liste limitative de ces droits (art. 3 C.c.Q.), la seule mesure étant qu'un caractère ou une composante de la personnalité soient reconnus comme un droit subjectif3. Les droits de la personnalité sont généralement qualifiés de droits extrapatrimoniaux : ils n'ont pas de valeur pécuniaire inhérente, leur objet étant la personne dans ses caractères propres. Ce qui ne signifie pas que leur usage ne peut faire l'objet d'une convention à caractère patrimonial. Par exemple, un artiste pourra consentir à ce que son image soit utilisée à des fins commerciales, sans que le droit du titulaire ne change de nature ; le droit à son image demeure extrapatrimonial et inhérent à sa personne. À ce titre, les droits de la personnalité ne sont ni cessibles, ni saisissables, ni transmissibles, ni prescriptibles, ni susceptibles de renonciation. Ils s'imposent à toute personne, quelle qu'elle soit. Lorsque l'on dit de ces droits qu'ils sont imprescriptibles, c'est qu'ils ne sont pas sujets à une prescription acquisitive. Une violation illicite d'un droit de la personnalité sera soumise aux règles générales de prescription, sauf les cas où un délai particulier est prévu par la loi. Quant aux renonciations, ce n'est pas qu'aucune renonciation n'est possible, mais plutôt qu'aucune renonciation générale à l'exercice de l'un de ces droits ne sera admise. Ainsi, une renonciation partielle, par l'effet d'un consentement à une atteinte, sera valide, par exemple, en matière de consentement aux soins. Cependant, aucun de ces caractères n'est absolu. Le droit reconnaît une certaine patrimonialité aux droits de la personnalité4, ne serait-ce que par l'effet des atteintes qui leur sont portées et de l'évaluation pécuniaire qui se rapporte à la compensation de celles-ci. Ce caractère de patrimonialité, qui se détache de leur nature intrinsèque, entraîne une atténuation de plusieurs de leurs qualités, plus particulièrement, en ce qui a trait à leur non-cessibilité et à leur non-transmissibilité. Le droit reconnaît en effet la validité des conventions relatives à certains aspects de la personnalité par Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 2 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA lesquelles une personne renonce à faire valoir la protection de l'un de ses droits de la personnalité, le plus souvent pour un bénéfice pécuniaire. Cette renonciation sera valide dans la mesure où la renonciation ne constitue pas une dénégation complète du droit. Les renonciations les plus courantes sont celles qui portent sur l'image, la voix, le nom et même la vie privée d'une personne. En fait, il ne s'agit pas d'une cession des droits de la personnalité, mais bien d'une renonciation à leur protection. Par l'effet de ces conventions, la nature patrimoniale de la renonciation et la nature extrapatrimoniale du droit qui en constitue l'objet s'entrechoquent. La nature extrapatrimoniale intrinsèque aux droits de la personnalité demeure intacte et sert à établir, avec la notion d'ordre public, la limite de la validité de ces conventions, en ne permettant pas qu'un de ces droits soit complètement détaché de la personne. Elle sert aussi à justifier l'existence de la prérogative de la personne de retirer, en tout temps, son consentement relatif à la renonciation à la protection de son droit. Bien sûr, des conséquences découleront de l'exercice de cette prérogative : la personne qui retire son consentement pourrait être tenue responsable du préjudice qu'elle cause par ce retrait, à moins que le fait de la tenir responsable équivaille à une négation de son droit. La personne pourrait aussi être tenue responsable si le retrait constitue un abus de droit (art. 7 C.c.Q.). Comme les droits de la personnalité sont inhérents à la personne, on présume qu'ils cessent d'exister au décès de la personne. Ils sont donc, en principe, intransmissibles, les héritiers ne pouvant alors invoquer de leur propre chef une atteinte à un droit de la personnalité du défunt, compte tenu de leur caractère personnel. Toutefois, le code admet la transmissibilité des droits d'introduire une demande en justice du défunt contre l'auteur de toute violation à l'un de ses droits de la personnalité, que ce droit ait été exercé ou non par le défunt avant son décès (art. 625, al. 3 et 1610, al. 2 C.c.Q.). Par cette inclusion des droits d'introduire une demande en justice dans le patrimoine transmis par succession, le code confirme l'extension, aux atteintes aux droits de la personnalité, de la règle générale qui veut que, dès l'instant où la victime subit un préjudice, son droit à la réparation fait partie de son patrimoine et est donc transmissible aux héritiers. 2- Les différents droits de la personnalité A- Les droits à la vie, à la dignité et à l'autonomie Les droits à la vie, à la dignité et à l'autonomie de la personne sont souvent perçus comme constituant le noyau central des droits de la personnalité : le premier par son rapport nécessaire à l'existence de la personne, les second et dernier, par leur valeur et leur rôle sous-jacents aux autres droits de la personnalité. 1. Le droit à la vie Le droit à la vie, comme tout autre droit de la personnalité, implique qu'il existe une personne juridique qui puisse en jouir. L'enfant conçu mais non encore né ne peut donc bénéficier du droit à la vie reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne5. Ce droit a un caractère particulier compte tenu de la valeur fondamentale qui lui est accordée par les législateurs tant fédéral que provincial, ainsi que par son lien nécessaire à l'existence de la personne. Cette importance ne donne toutefois pas à la vie un caractère absolu, bien que son caractère sacré ait été reconnu à maintes reprises6. D'ailleurs, le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada rendait un jugement unanime dans lequel, en déclarant nuls par application de l'article 52de la Loi Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 3 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA constitutionnelle de 1982 les articles 241 b) et 14 du Code criminel, la cour reconnaissait que « cela dit, nous ne sommes pas d'avis que la formulation existentielle du droit à la vie exige une prohibition absolue de l'aide à mourir, ou que les personnes ne peuvent « renoncer » à leur droit à la vie. Il en résulterait une « obligation de vivre » plutôt qu'un « droit à la vie », et la légalité de tout consentement au retrait d'un traitement vital ou d'un traitement de maintien de la vie, ou du refus d'un tel traitement, serait remise en question. Le caractère sacré de la vie est une des valeurs les plus fondamentales de notre société. L'article 7 émane d'un profond respect pour la valeur de la vie humaine, mais il englobe aussi la vie, la liberté et la sécurité de la personne durant le passage à la mort. C'est pourquoi le caractère sacré de la vie « n'exige pas que toute vie humaine soit préservée à tout prix » (Rodriguez, p. 595, le juge Sopinka). Et pour cette raison, le droit en est venu à reconnaître que, dans certaines circonstances, il faut respecter le choix d'une personne quant à la fin de sa vie. »7 On doit concevoir le droit à la vie comme une prérogative dont jouit le titulaire dans son propre intérêt. À ce titre, le droit à la vie, malgré la valeur fondamentale qui lui est accordée, demeure sous le contrôle de la personne qui en jouit. On lui reconnaît alors le droit de renoncer à la vie en refusant toute intervention de la part de tiers et même l'aide médicale à mourir8. La prérogative se rattache dans ce cas au droit à la dignité, lui-même souvent rattaché au thème de la dignité dans la mort. Ce contrôle de la personne sur la jouissance de son droit à la vie a été reconnu par nos tribunaux dans les affaires Manoir de la Pointe-Bleue (1978) Inc. c. Corbeil9 et Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec10 , qui situaient la problématique dans le contexte des règles relatives au refus de traitement et de soins, en application du droit à l'intégrité physique. Par ailleurs, ce respect de l'autonomie de la personne quant aux décisions portant sur son intégrité et ultimement, sur sa vie, n'est pas sans limites. « Si le droit reconnaît la liberté devant la mort, ou le droit de mourir en paix, il ne reconnaît pas pour autant un droit à la mort. La nuance est capitale [...]. Il s'agit donc d'une liberté, mais d'une liberté restreinte qui ne constitue pas un véritable droit à la mort. »11 On a toutefois reconnu comme corollaire du droit à la vie, la notion de qualité de vie, liée à la dignité de la personne. Cette notion est implicitement incluse dans la reconnaissance de l'exercice de l'autonomie d'une personne eu égard au refus de traitement12 . Lorsque les décisions relatives aux soins sont prises par un tiers, l'appréciation du droit à la vie et de la notion de qualité de vie se rapporte à la mesure de l'intérêt ou du bien de la personne. Cet intérêt ou ce bien de la personne comprend quatre aspects : physique, affectif, intellectuel et spirituel13 . Les obligations des tiers découlant du respect du droit à la vie sont alors considérées en fonction de ces éléments. Le Législateur québécois a entrepris une réflexion sur la question des soins de fin de vie et sur l'aide médicale à mourir. Le 4 décembre 2009, une commission spéciale est créée pour réfléchir à ces questions sociales. Une vaste consultation publique a eu lieu du 7 septembre 2010 au 22 mars 2011. Plus de 32 experts ont été rencontrés par cette commission spéciale qui s'est également penchée sur plus de 300 mémoires et demandes d'interventions. Parallèlement à ces auditions de la commission spéciale, une consultation publique a été tenue ou plus de 6 600 répondants ont complété un questionnaire en ligne sur ces questions. Le 22 mars 2012, la commission spéciale rend son rapport qui comporte 24 recommandations divisées en deux axes : celui portant sur les soins de fin de vie et un second sur l'aide médicale à mourir. Ces recommandations sont ensuite soumises à un comité de juristes experts avec mandat d'étudier les questions juridiques soulevées par les recommandations. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 4 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA Le 15 janvier 2013, ce comité d'expert rend un rapport intitulé Mettre en oeuvre les recommandations de la Commission spéciale de l'Assemblée nationale sur la question de mourir dans la dignité. À la suite de ce rapport, la Commission de la santé et des services sociaux a tenu des consultations particulières du 17 septembre au 10 octobre 2013 sur le projet de loi 52 et a procédé à une étude détaillée du 21 novembre 2013 au 16 janvier 2014. Le 22 mai 2014, une motion est votée à l'Assemblée nationale pour remettre à l'agenda législatif ce projet de loi malgré le changement de gouvernement. C'est ainsi que, le 5 juin 2014, le projet de loi est adopté. Il est sanctionné le 10 juin 2014. Les dispositions de la Loi concernant les soins de fin de vie14 sont entrées en vigueur le 10 décembre 2015. Cette nouvelle loi s'inscrit dans la lignée des recommandations unanimes de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Elle s'appuie sur les valeurs de solidarité, de compassion et de respect des valeurs individuelles. Dans un jugement unanime prononcé par la cour le 6 février 2015, la Cour suprême est venue reconnaître le droit à l'aide médicale à mourir. En appel d'un jugement émanant de la Colombie-Britannique, la cour a reconnu qu'une personne adulte capable, atteinte de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une infection, une maladie ou un handicap) et dont les problèmes causent des souffrances persistantes et intolérables, peut consentir clairement à mettre fin à sa vie. La cour déclarait ainsi nuls et inopérants les articles 241 b) et 14 du Code criminel. La cour déclarait que la prohibition de l'aide médicale à mourir prévue à ces articles portait atteinte de manière injustifiée à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et ne pouvait se justifier dans le cadre de l'article 1 de la Charte. Ce jugement de la cour est suspendu pour une période de 12 mois à compter du 6 février 2015, pour permettre au gouvernement fédéral et aux provinces d'ajuster leurs lois respectives en fonction des principes établis par cette décision. Il a fait l'objet d'une prorogation de délai de 4 mois à compter du 6 février 2016. Sur cette question de juridiction, rappelons que le droit criminel est de compétence fédérale alors que le droit en matière de santé est de compétence provinciale. Le Québec est intervenu dans le cadre de ce procès pour soulever sa compétence exclusive en matière de santé, considérant l'aide médicale à mourir comme un soin. La Cour suprême, sur cette question de compétence, affirme que : « À notre avis, les appelants n'ont pas établi que la prohibition de l'aide médicale à mourir empiète sur le contenu essentiel de la compétence provinciale. La santé est un domaine de compétence concurrente ; le Parlement et les provinces peuvent validement légiférer dans ce domaine [...]. Ceci laisse croire que les deux ordres de gouvernement peuvent validement légiférer sur des aspects de l'aide médicale à mourir, en fonction du caractère et de l'objet du texte législatif. [...] Il s'ensuit que la prétention fondée sur l'exclusivité des compétences ne peut être retenue ». Comme mentionné plus haut, le Québec avait déjà adopté sa loi concernant les soins de fin de vie avant ce jugement de la Cour suprême. Cette loi a fait l'objet d'un recours constitutionnel devant la Cour supérieure. Le 1er décembre 2015, la Cour supérieure suspendait l'entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie en accueillant le recours introduit par un groupe de médecins opposés à cette loi et appuyé Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 5 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA par la Procureure générale du Canada. La Cour supérieure est d'avis que la doctrine de la prépondérance fédérale sur les lois provinciales rend incompatibles le Code criminel et les dispositions de la loi provinciale. Québec a porté cette décision en appel. La Cour d'appel du Québec a autorisé l'appel de la Procureure générale du Québec suspendant par le fait même les effets du jugement de la Cour supérieure et permettant l'entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie le 10 décembre 2015. Cet appel a été entendu le 18 décembre 2015. La Cour d'appel a infirmé le jugement de la Cour supérieure le 22 décembre 2015 déclarant valides les dispositions de cette loi. Il faudra voir si la réflexion amorcée par le gouvernement fédéral et la position législative qu'il adoptera dans la foulée de l'arrêt Carter invalidant les articles 241 b) et 14 du Code criminel, auront une quelconque influence sur l'application des critères établis par le gouvernement provincial pour bénéficier des soins prévus à cette loi. Essentiellement, pour bénéficier des soins de fin de vie, communément appelés « l'aide médicale à mourir » certaines conditions doivent être remplies, soit : 1) avoir 18 ans ou plus, 2) être apte à consentir aux soins, 3) être assuré par la Régie de l'assurance maladie du Québec, 4) être atteint d'une maladie incurable et mortelle, 5) éprouver des souffrances physiques ou psychologiques incontrôlables ou pour lesquelles le patient juge ne pas être soulagé et 6) être en fin de vie. Un guide d'exercice intitulé « L'aide médicale à mourir » a été préparé conjointement par le Collège des médecins du Québec, l'Ordre des pharmaciens et l'Ordre des infirmières pour encadrer ces soins de fin de vie. Il s'agit du protocole qui devra être exercé lorsqu'un patient demandera de pouvoir bénéficier des soins de fin de vie. Il n'en demeure pas moins que la loi québécoise est de nature plus restrictive que les conditions établies par la Cour suprême dans l'arrêt Carter. Cette dernière n'a pas retenu le critère de la loi québécoise exigeant que la personne qui requiert l'aide médicale à mourir soit en fin de vie. Cette décision de la Cour suprême, qui renverse sa propre décision dans l'affaire Sue Rodriguez (décision alors adoptée 5 juges contre 4) en 1993, démontre bien à quel point le droit peut évoluer au rythme des changements de société. 2. Le droit à la dignité Le droit à la dignité fait appel à notre conception de la personne. Il se rapporte à la valeur intrinsèque de la personne. Il impose donc le respect de la personne pour ce qu'elle est, comme une fin en soi, et s'oppose à ce qu'elle soit considérée comme une chose. « En plus de constituer un droit protégé à l'article 4 de la Charte, la dignité constitue, compte tenu du préambule de la Charte, une valeur sous-jacente aux droits et libertés qui y sont garantis » 15 , et sert d'élément pondérateur aux autres droits. À ce titre, le droit à la dignité joue un rôle fondamental dans l'interprétation de l'objet des autres droits de la personnalité et influence l'exercice de l'ensemble de ces droits ainsi que la conduite exigée des tiers à leur égard. Il prend d'ailleurs une place de plus en plus importante en matière d'atteinte à la réputation et en matière de discrimination16 . Par ailleurs, son rôle comme fondement d'un recours lorsqu'une loi particulière a pour effet d'exclure l'application de la Charte des droits et libertés de la personne17 reste limité à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc.18 . Malgré cette limite, le principe du respect de la dignité humaine comme valeur Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 6 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA sous-jacente à l'ensemble des droits de la personnalité et des droits de la personne a pour effet, par sa reconnaissance de plus en plus fréquente, de confirmer la place de la personne comme la raison d'être de ces droits. 3. Le droit à l'autonomie Le droit à l'autonomie, dans la mesure où il est lié à l'exercice des autres droits, sert à la fois de mécanisme de protection de ces autres droits et de droit autonome. Il renvoie au caractère volontaire de la personne qui seule détient le contrôle de sa personnalité. Aussi, l'autonomie joue un rôle central dans la reconnaissance de la dignité de la personne par le respect de ses vues subjectives sur les droits qui la touchent et composent sa personnalité. L'autonomie est devenue, au-delà d'un droit, une valeur intrinsèque de la reconnaissance de la personne comme sujet de droit actif. Ainsi, par exemple, les règles sur la capacité du mineur et des personnes majeures frappées d'incapacité favorisent, dans la mesure du possible, la reconnaissance de leur autonomie, malgré leur condition. B- Le droit à l'intégrité Le droit à l'intégrité se rapporte à la protection physique et psychologique de la personne et met en cause la valeur abstraite de la personne humaine (principe d'inviolabilité et d'indisponibilité de la personne et de son corps) et la valeur subjective de la personne (reconnaissance de la dignité et de l'exercice de l'autonomie de la personne sur son corps)19 . Par le jeu de ces deux valeurs, la protection de l'intégrité de la personne oscille entre l'autonomie de la personne ou le contrôle sur son corps et la protection du caractère inaliénable de la personne par le respect de son corps. Ainsi, la volonté doit primer, sauf dans certains cas où des règles visent à protéger la valeur particulière du respect de l'humanité de la personne physique. Ces règles, compte tenu de la notion d'ordre public, ont pour effet de limiter l'exercice de l'autonomie de la personne sur son corps. À titre d'exemple, les règles relatives à l'aliénation d'une partie du corps permettent l'exercice de l'autonomie de la personne afin de consentir à une atteinte, mais limitent le type d'atteintes auxquelles la personne peut consentir, de même que la nature des aliénations permises (art. 19, 22 et 25 C.c.Q.). La règle qui se rapporte à la protection de l'intégrité de la personne s'énonce ainsi : « Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. » (art. 10 C.c.Q.). Il s'agit d'une règle à portée générale qui reconnaît que toute atteinte qui n'est pas autorisée par la loi ou pour laquelle il n'y a pas eu de consentement devrait donner lieu à un droit de réparation. Il convient toutefois de souligner que la Cour suprême du Canada a, dans l'affaire Curateur public du Québec c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, jugé qu'une atteinte à l'intégrité devait laisser des marques ou des séquelles qui, sans être nécessairement permanentes, devaient avoir un certain caractère durable20 . 1. Le consentement aux soins Le Code civil réglemente de façon particulière le régime des atteintes à l'intégrité dans le cadre de soins (art. 11 et s. C.c.Q.). Une série d'invasions sont visées par ce régime, y compris les soins à proprement parler, les examens, les prélèvements, les traitements ou toute autre intervention de nature médicale, psychologique ou sociale21 , qu'ils soient ou non requis par l'état de santé de la personne, ainsi que l'hébergement dans un établissement de santé 22 . L'aliénation d'une partie du corps du vivant de la personne et l'expérimentation sont aussi considérées comme des soins, au sens large que le code donne à cette notion. En effet, les dispositions qui les régissent sont placées dans la section du code portant Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 7 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA sur les soins. Aussi, ces actes constituent une forme d'intervention soumise au principe général de l'article 11 C.c.Q. Cet article énonce l'exigence du consentement de la personne ou de son représentant pour tout acte ou intervention à caractère médical portant atteinte à l'intégrité de la personne. Dans le cadre de ce régime, le rôle du consentement est primordial : il rend légitime l'atteinte à l'intégrité du patient. Qu'il s'agisse du consentement aux soins ou du consentement au retrait ou encore à la fin des soins, le consentement demeure essentiel23 . D'autres éléments de légitimation des atteintes sont aussi reconnus ; ils doivent alors être prévus par la loi24 . Le principe en matière de soins est donc que nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement, sauf exception prévue par la loi (art. 11, al. 1 C.c.Q.)25 . Le consentement doit être libre et éclairé (art. 10 et 1399 C.c.Q.), ce qui signifie que la personne doit, afin de pouvoir former ce consentement, obtenir l'information nécessaire se rapportant aux soins qui lui seront fournis. L'article 8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux renvoie d'ailleurs à la règle du consentement, en y intégrant le droit d'être informé, dans les termes suivants : « Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d'être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant. » La portée du droit d'être informé a maintes fois été débattue devant les tribunaux en regard du devoir d'information du médecin envers son patient. Les premiers énoncés concernant le devoir d'information et la nature libre et éclairée du consentement nous sont parvenus de nos voisins de common law dans les affaires Hopp c. Lepp26 et Reibl c. Hughes27 . La Cour suprême a alors énoncé un test qui combine des éléments objectifs et subjectifs et impose au médecin le devoir de divulguer les informations qu'une victime raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait voulu connaître, plus particulièrement, les informations qui se rapportent à la nature de l'intervention envisagée, à sa gravité, à tous les risques importants ou à tous les risques particuliers ou inhabituels28 . Ce test doit être appliqué avec circonspection au Québec29 . En droit civil, le consentement est une question de volonté réelle et non abstraite30 . Des nuances importantes doivent donc être apportées à la règle du consentement telle qu'elle est énoncée par la Cour suprême dans ces deux décisions, ainsi qu'à son interprétation. Dans les affaires Chouinard c. Landry31 , Pelletier c. Roberge32 et Parenteau c. Drolet33 , la Cour d'appel a affirmé le caractère subjectif du consentement du patient aux soins. Le devoir d'information du médecin consiste d'abord à faire comprendre à son patient le type d'intervention auquel celui-ci entend se soumettre et de lui permettre de consentir ou de refuser en toute connaissance de cause34 . La causalité s'apprécie en fonction du patient lui-même : aurait-il, lui, refusé ou accepté ce traitement si toutes les informations nécessaires lui avaient été fournies ? Les informations que le médecin doit fournir sont celles que le patient a voulu connaître de façon spécifique, celles qui se rapportent aux traitements reconnus pour soigner la pathologie du patient, les risques prévisibles, spéciaux ou les complications possibles, de même que les conditions particulières du patient et les conséquences de la réalisation des risques sur lui35 . Ainsi, la portée du devoir d'information sera, dans un premier temps, appréciée objectivement selon une norme abstraite qui se rapporte au minimum requis afin que le consentement soit libre et éclairé, et dans un second temps, subjectivement, eu égard au patient qui doit fournir le consentement. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 8 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA Le code prévoit une exception à l'exigence du consentement : il s'agit de la situation d'urgence. Le code définit cette situation comme celle où la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile (art. 13 C.c.Q.). Les trois éléments indiqués par le code sont nécessaires afin de passer outre à l'exigence du consentement. Toutefois, un consentement sera nécessaire, malgré l'urgence, lorsque les soins sont devenus inutiles ou sont inusités ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne. Dans ces cas, le consentement devra être obtenu d'une personne autorisée à agir en vertu de l'article 15 C.c.Q. Les soins devenus inutiles ne devraient pas être fournis. S'ils sont inutiles, ils ne sont donc pas requis par la situation d'urgence, car ils ne peuvent pallier le risque de danger à la vie, ni la menace à l'intégrité. Quant aux conséquences intolérables pour la personne, il faudrait que le personnel soignant soit au courant des volontés de la personne afin d'en venir à cette conclusion. a) Le consentement substitué La règle du consentement s'applique de manière absolue lorsqu'il s'agit d'une personne majeure qui, dans les faits, est apte à consentir aux soins36 . Ainsi, son refus de soins, bien que déraisonnable, devra être respecté en application du droit à l'intégrité et au respect de son autonomie (art. 11, al. 1 C.c.Q.). Toutefois, lorsque la personne n'est pas apte à donner un consentement alors qu'il est requis ou que, dans le cas de la personne mineure, on ne lui reconnaît pas la pleine capacité d'exercice relativement aux soins, son représentant pourra la remplacer ; on parle alors de consentement substitué. L'inaptitude de la personne à consentir aux soins s'apprécie en fonction de son autonomie décisionnelle au moment où elle doit consentir aux soins ; peut-elle, au moment précis où on lui demande son consentement, comprendre les conséquences de sa décision37 ? Les tribunaux ont généralement évalué l'inaptitude de la personne à consentir suivant un test qui s'inspire d'une disposition du Hospitals Act38 de la Nouvelle-Écosse : - La personne comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé ? - La personne comprend-elle la nature et le but du traitement ? - La personne saisit-elle les risques et les avantages du traitement si elle le subit ? - La personne comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement ? - La capacité de comprendre de la personne est-elle affectée par sa maladie ? Elle ne se rattache donc pas nécessairement à la situation juridique de la personne, soumise ou non à un régime de protection, sauf dans le cas du mineur, suivant son âge. L'exercice du consentement substitué est soumis à un principe général qui vise à protéger la personne inapte ou le mineur : il s'agit de son intérêt (art. 12, al. 1 C.c.Q.). Ainsi, toute décision prise à l'égard de la personne représentée doit, dans la mesure du possible, tenir compte des volontés qu'elle a pu manifester relativement aux soins ou à toute autre question pertinente au consentement. Les soins doivent être bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de leurs effets, opportuns dans les circonstances et les risques qu'ils présentent ne doivent pas être hors de proportion avec le bienfait qu'on peut en espérer (art. 12 C.c.Q.). Certaines règles viennent parfois s'ajouter à ces principes de base suivant le régime particulier établi par le code en fonction de l'âge de la personne et de la nature des soins. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 9 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA 1) La personne majeure inapte Le consentement substitué, dans le cas de la personne majeure inapte, est soumis aux principes généraux liés à son exercice. S'ajoutent à ces principes les règles d'identification des personnes autorisées à représenter la personne inapte ; elles sont fixées en fonction de la nature des soins. Lorsque les soins sont requis par l'état de santé de la personne majeure inapte, le pouvoir de consentir est attribué au mandataire nommé en vertu du mandat de protection donné en prévision de l'inaptitude homologué, au tuteur ou au curateur à la personne. En l'absence d'une telle représentation, le consentement est alors donné par le conjoint, qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier (art. 15 C.c.Q.). La personne qui, en vertu de l'article 15 C.c.Q., peut donner son consentement substitué, ne peut déléguer ce pouvoir à une autre personne. L'article 15 C.c.Q. établit une hiérarchie qui place le représentant nommé ou reconnu judiciairement au premier plan (mandataire, tuteur ou curateur) puis, en l'absence d'un tel représentant, le code privilégie le conjoint et, ensuite, sur un même pied, les proches parents ou toute autre personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. Certains considèrent toutefois que, dans cette hiérarchie, les proches parents ont préséance sur la personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur. Si le représentant refuse de consentir aux soins et que ce refus est injustifié dans les circonstances, l'autorisation du tribunal devra être obtenue afin de passer outre à ce refus (art. 16 C.c.Q.). Cette autorisation sera aussi nécessaire si le majeur inapte refuse catégoriquement39 de recevoir les soins, à moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène ou d'un cas d'urgence40 . La demande d'autorisation est présentée à un juge et doit être signifiée directement à la personne à qui l'on veut administrer les soins (art. 71, 82, 303, 330, 393, 395 C.p.c.). La demande ne peut être générale. Elle doit viser des soins spécifiques. La demande devra, entre autres, alléguer les faits qui servent à établir l'inaptitude de la personne à consentir à ses soins, ainsi que ceux qui démontrent le caractère injustifié ou catégorique du refus de la personne autorisée à consentir à ses soins ou du majeur inapte41 . Dans le cas d'un refus injustifié, compte tenu de la nature des principes qui doivent guider la décision prise par le représentant, on tiendra compte de l'intérêt de la personne, comme on le fait lorsqu'il s'agit d'un mineur. Afin de démontrer qu'un refus est injustifié, il n'est pas nécessaire de démontrer que la vie de la personne est en danger. Il faut plutôt démontrer que la décision du représentant n'est pas prise dans le meilleur intérêt de la personne représentée. Dans le cas d'un refus catégorique de la personne inapte, le tribunal tiendra compte des mêmes principes généraux qui doivent guider toute décision prise à son égard. La particularité de l'exigence de cette autorisation est qu'elle reconnaît un certain degré d'autonomie à la personne inapte, malgré son inaptitude, en lui permettant de remettre en cause les décisions prises à son égard. Les situations visées impliquent généralement des personnes qui reçoivent des soins psychiatriques. Le refus catégorique de la personne inapte sera retenu par le tribunal lorsque, dans les circonstances, le traitement proposé ne lui apporte pas de bénéfice réel compte tenu de ses effets sur un autre aspect de la santé de celle-ci42 . Toutefois, lorsque le traitement peut permettre à la personne, une fois le traitement suivi, de fonctionner normalement ou d'atteindre un certain bien-être sans que trop de risques ne soient encourus, il sera passé outre à son refus. Les tribunaux retiennent en fait le rapport de proportionnalité entre les risques et les conséquences néfastes possibles du traitement sur la santé du patient et les Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 10 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA bienfaits que l'on peut espérer de ce traitement. L'analyse de la jurisprudence montre que la durée moyenne prévue pour ces ordonnances de soins est de deux ans, dans certains cas la durée peut être de trois ans43 et exceptionnellement la durée sera de cinq ans44 . Dans la décision Québec (Curateur public) c. Institut Philippe Pinel45 , madame la juge Côté a mentionné qu'une ordonnance de traitement rendue par un tribunal doit faire l'objet d'une analyse sérieuse vu l'article 10 C.c.Q. et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne (tout être humain ayant droit à l'inviolabilité, à l'intégrité et à la liberté de sa personne)46 . Elle ajoute que le juge doit analyser les facteurs présentés au soutien de la durée du traitement, et ce, en l'absence de contre-expertise affectant la crédibilité de l'expert. Une durée de trois ans a été fixée. Dans la décision Québec (Curateur public) c. Centre de santé et de services sociaux de Laval47 , le juge Rochon a écrit que le juge de la Cour supérieure avait commis une erreur de principe en refusant d'assujettir son ordonnance à une période définie d'application alors que la personne visée par l'ordonnance avait une maladie dégénérative. Un terme de trois ans a été fixé. La Cour supérieure a également rendu un intéressant jugement48 sur la durée des ordonnances de traitement. Madame la juge La Rosa a conclu que la durée de cinq ans de l'ordonnance de traitement demandée est excessive et doit être réduite à trois ans. En effet, elle précise que le Code civil du Québec prévoit un rôle actif de la part du tribunal et, même si l'exercice de ce rôle implique un retour devant le tribunal, la balance des inconvénients penche en faveur de cet examen régulier. Dans la décision Centre de santé et de services sociaux d'Ahuntsic et Montréal-Nord c. K.J.49 , monsieur le juge Mark G. Peacock a fixé un terme de trois ans et a ordonné aux parties de se présenter en Cour deux mois avant l'expiration de l'ordonnance « afin de débattre de la pertinence d'émettre une nouvelle ordonnance de soins devant débuter immédiatement à compter de la date d'expiration de la présente ordonnance » 50 . En faisant cet ajout, le juge Peacock a pris le soin de considérer un rapport du Barreau du Québec51 qui faisait état que la loi ne prévoit aucun mécanisme de révision des ordonnances relatives au consentement aux soins afin de réévaluer leur bien-fondé. Il arrive que les tribunaux ordonnent à la personne de se soumettre au traitement autorisé, à moins qu'une preuve démontre que le patient n'est pas apte à comprendre une telle ordonnance52 . Dans la décision Centre hospitalier de l'Université de Montréal53 , la Cour d'appel était saisie d'une demande de traitement d'une durée de trois ans avec possibilité de placer le patient dans une résidence supervisée si son état psychiatrique ne s'améliorait pas. Sur cette question d'hébergement différé, la Cour d'appel précise que, pour accueillir les conclusions visant l'hébergement, la preuve doit révéler des raisons d'ordonner l'hébergement immédiat d'une personne54 . Lorsque les soins ne sont pas requis par l'état de santé de la personne majeure inapte, seuls les mandataires, tuteur ou curateur peuvent consentir aux soins. Le consentement doit dans ce cas être donné par écrit (art. 24 C.c.Q.). L'autorisation du tribunal sera toutefois nécessaire dans tous les cas où les soins présentent un risque sérieux pour la personne inapte ou s'ils peuvent causer des effets graves et permanents (art. 18 C.c.Q.). 2) La personne mineure Le code reconnaît en cette matière la nature évolutive de l'acquisition de l'autonomie de la personne mineure face aux décisions qui concernent son intégrité. L'âge de 14 ans a été choisi comme étape charnière dans la reconnaissance de cette autonomie où la nature des soins, suivant qu'ils sont ou non requis par l'état de santé du mineur, a pour effet d'atténuer ou d'augmenter l'exercice de cette Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 11 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA autonomie. La détermination de la nature des soins ainsi que la qualification des effets de ces soins sur la santé du mineur demeurent des questions délicates. Elles constituent la véritable difficulté d'application des différentes dispositions portant sur le consentement substitué. i) Le mineur de 14 ans et plus Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins requis par son état de santé (art. 14, al. 2 C.c.Q.). Il convient de préciser qu'il s'agit nécessairement du mineur de 14 ans et plus apte. Toutefois, lorsqu'il refuse ces soins, on pourra passer outre à ce refus en obtenant l'autorisation du tribunal. L'autorisation pourra être accordée si le refus de l'enfant ne peut être justifié par son intérêt. Ce n'est pas le risque pour son intégrité qui doit déterminer la décision du tribunal mais l'intérêt de l'enfant. Dans le cas d'une urgence, on pourra passer outre au refus du mineur en obtenant le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, s'il peut être obtenu en temps utile (art. 16, al. 2 C.c.Q.)55 . En cas de refus des représentants du mineur alors qu'il y a urgence, ce refus équivaut alors à une impossibilité d'obtenir un consentement en temps utile. Dès lors, la règle de l'article 13 du code s'applique. La reconnaissance de l'autonomie du mineur à consentir aux soins requis par son état de santé, mais non à les refuser, vise à encourager le mineur à obtenir des soins, en vue de préserver son intégrité, sans que n'entrent en jeu les effets de l'exercice de l'autorité parentale56 . Par contre, afin de permettre aux titulaires de l'autorité parentale ou au tuteur de remplir dans une certaine mesure les devoirs qui se rattachent à l'autorité parentale, les donneurs de soins devront, lorsque le mineur séjourne pour plus de 12 heures dans un établissement de santé ou de services sociaux, informer le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur de ce fait (art. 14, al. 2 C.c.Q.). Lorsque les soins ne sont pas requis par l'état de santé du mineur de 14 ans et plus, celui-ci peut en principe consentir seul à ces soins (art. 17 C.c.Q.)57 . Le consentement doit, compte tenu de la nature des soins, être donné par écrit (art. 24 C.c.Q.). On lui reconnaît nécessairement, dans ce cas, la capacité de refuser ce genre de soins, car le refus ne met pas en jeu l'intégrité du mineur. Le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur sera par contre nécessaire lorsque ces soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents (art. 17 C.c.Q.). La nature du risque et les effets des soins sur la santé du mineur s'évaluent eu égard aux circonstances particulières du mineur. ii) Le mineur de moins de 14 ans Le mineur de moins de 14 ans ne peut consentir seul aux soins. Dans tous les cas, le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur sera exigé (art. 14, al. 1 et 18 C.c.Q.). Lorsque les soins sont requis par l'état de santé du mineur de moins de 14 ans, l'exercice du consentement substitué par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur peut être remis en question58 . Ainsi, en cas d'empêchement ou de refus injustifié du représentant du mineur, l'autorisation du tribunal pourra être obtenue s'il est dans l'intérêt de l'enfant que les soins soient administrés (art. 16 C.c.Q.). Le tribunal devra alors statuer sur la demande en autorisation de traitement en évaluant, dans un premier temps, l'intérêt de l'enfant dans les circonstances et, dans un second temps, sur la base de l'intérêt de l'enfant, le caractère du refus. Le tribunal n'interviendra que dans la mesure où il considère que le refus est déraisonnable. Lorsque les soins ne sont pas requis par l'état de santé du mineur de moins de 14 ans, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur peuvent consentir ou refuser les soins. Le consentement du titulaire de Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 12 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA l'autorité parentale ou du tuteur doit être donné par écrit (art. 24 C.c.Q.). L'autorisation du tribunal sera toutefois nécessaire afin de donner une protection additionnelle au mineur dans les cas où les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur ou s'ils peuvent causer des effets graves et permanents (art. 18 C.c.Q.). Les critères énoncés dans cet article ne sont pas cumulatifs. Le problème de qualification des soins et de leurs effets demeure. 2. La recherche (L'expérimentation Le code ne définit pas la recherche, anciennement appelée l'expérimentation. Il oppose toutefois la notion de recherche à celle de soins innovateurs, en laissant au comité d'éthique du centre hospitalier concerné la tâche d'établir cette distinction (art. 21, al. 4 C.c.Q.). La Commission de réforme du droit du Canada a défini l'expérimentation comme « une technique, un processus permettant de vérifier certains faits en créant des conditions propices à leur réalisation » 59 . C'est dire que la qualification d'une intervention comme une recherche se rattachera à l'objectif de vérification d'une hypothèse. On pourrait, sur cette base, distinguer les soins innovateurs de la recherche en considérant que ceux-ci ne doivent pas être administrés en vue de vérifier une hypothèse. Ils doivent aussi être requis par l'état de santé de la personne concernée (art. 21, al. 4 C.c.Q.), ce qui va au-delà de la simple espérance de bienfaits pour la santé de la personne. La recherche, tout comme les soins, constitue une atteinte à l'intégrité de la personne et nécessite, afin de la légitimer, le consentement libre et éclairé de la personne (art. 10, 11 et 20 C.c.Q.). Dans le cas de la recherche, la loi ne prévoit pas d'exception à l'exigence du consentement. La personne doit, afin de pouvoir former ce consentement, obtenir l'information nécessaire se rapportant aux différentes interventions auxquelles elle aura à se soumettre. On peut donc, tout comme pour les soins, parler d'un droit à l'information. À ce droit à l'information correspond un devoir d'informer la personne de la nature de l'atteinte à son intégrité. La portée de ce devoir englobe celui qui est imposé en matière de soins thérapeutiques, en y ajoutant un encadrement propre à la recherche. Dans le cadre d'une recherche, tous les risques associés aux différentes interventions et étapes qui font partie du protocole de recherche doivent être divulgués, y compris ceux qui se rattachent au choix de la méthodologie de recherche, aux examens et aux mécanismes de contrôle et de diagnostic60 . a) La personne majeure apte La participation de la personne majeure apte à une recherche est soumise, au-delà de l'exigence du consentement, à certaines conditions imposées par le code. Une personne ne pourra se soumettre à une recherche que si le risque couru n'est pas hors de proportion avec le bien-être qu'on peut raisonnablement en espérer (art. 20 C.c.Q.). La règle de proportionnalité entre les risques et les bienfaits doit ici s'évaluer en fonction du rapport entre les risques courus par la personne et les bienfaits que l'on peut généralement espérer de la recherche, en incluant un bienfait pour la science ou pour une classe de gens. Cette interprétation serait conforme à la pratique des milieux de recherche qui, dans les premières phases, font appel à des sujets sains. Dans ce cas, le sujet, étant sain, ne peut espérer de bénéfice direct pour sa santé. D'ailleurs, le code n'a pas, comme il l'a fait pour d'autres matières, énoncé la règle en termes de bien-être pour la personne ou pour sa santé. La participation à la recherche ne pourra non plus donner lieu à une contrepartie financière, sauf le versement d'une indemnité en compensation des pertes et des contraintes subies (art. 25, al. 2 C.c.Q.). Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 13 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA L'indemnité doit donc correspondre aux pertes et contraintes subies et ne peut donc, en principe, être déterminée de manière fixe pour tous les sujets participant à la recherche ; il s'agirait dans ce cas d'une contrepartie financière déguisée. b) La personne majeure inapte et le mineur Comme dans le cadre du régime du consentement aux soins, le code prévoit un régime différent pour la recherche qui met en cause des personnes majeures inaptes ou des mineurs. Le critère de participation exigé dans leur cas afin de permettre la recherche est plus exigeant que le critère de proportionnalité requis dans le cas de la personne majeure apte. Les personnes majeures inaptes et les mineurs ne pourront être soumis à une recherche qu'en l'absence de risques sérieux pour leur santé et d'opposition de leur part, s'ils comprennent la nature et les conséquences de l'acte (art. 21, al. 1 C.c.Q.). Dans le cas de la personne majeure, nous croyons que si la personne comprend la nature et les conséquences de l'acte, elle doit alors être considérée comme un majeur apte, auquel cas elle seule pourra décider de sa participation à une recherche. Cette précision quant à la compréhension des conséquences de l'acte ne s'appliquerait alors qu'au cas du mineur. Ainsi, si le mineur comprend la nature et les conséquences de l'acte et qu'il s'y oppose, en aucun cas ne pourra-t-il être soumis à une recherche, même si le titulaire de l'autorité parentale y consent. Par ailleurs, si la personne (majeure inapte ou mineure) ne comprend pas la nature et les conséquences de l'acte, elle pourra participer à la recherche dans la mesure où les autres conditions de l'article sont remplies et que le consentement de la personne habilitée à consentir est obtenu. Dans le cas du mineur, le titulaire de l'autorité parentale pourra consentir. Dans le cas de la personne majeure inapte, on doit faire une distinction entre le cas où la personne est placée sous un régime de protection ou est représentée par un mandataire nommé en vertu d'un mandat de protection donné en prévision de son inaptitude, et celui où elle n'est pas représentée dans l'exercice de ses droits civils. Dans le premier cas, son représentant – tuteur, curateur ou mandataire – pourra consentir. Dans le second, la personne autorisée à consentir aux soins requis en vertu de l'article 15 C.c.Q. pourra consentir à la recherche (art. 21, al. 3 C.c.Q.), dans la mesure où l'ouverture d'un régime de protection ou l'homologation d'un mandat ne peuvent être faits en temps utile afin de permettre la recherche. Ainsi, les enfants en bas âge et les personnes majeures inaptes pourvues ou non d'un régime de protection peuvent être soumis à une recherche. Leur participation pose toutefois le problème de la protection de leur meilleur intérêt. Comme il s'agit de l'exercice d'un consentement substitué, les critères énoncés à l'article 12 C.c.Q. demeurent pertinents et, lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne majeure placée sous un régime de protection, leur meilleur intérêt doit toujours être pris en considération dans toute décision les concernant (art. 33 et 257 C.c.Q.). Les conditions prévues par le code afin d'encadrer la participation des personnes majeures inaptes et les mineurs sont établies suivant deux axes : la recherche ne vise qu'une seule personne ou elle vise un groupe de personnes. 1) La recherche sur une seule personne La recherche qui ne vise qu'une seule personne ne peut avoir lieu que si l'on peut s'attendre à un bénéfice pour la santé de cette personne (art. 21, al. 2 C.c.Q.). La recherche doit être approuvée et suivie par un comité d'éthique compétent. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 14 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA 2) La recherche sur un groupe de personnes La recherche qui vise un groupe de personnes doit aussi être approuvée et suivie par un comité d'éthique compétent. Afin que la recherche puisse avoir lieu, il faut qu'on puisse s'attendre à un bénéfice pour la santé des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap que les personnes soumises à la recherche (art. 21, al. 2 C.c.Q.). Il ne s'agit donc pas d'une espérance de bienfait pour la personne soumise à la recherche, mais d'un bienfait pour le groupe. Cette règle présente, dans son application, un problème certain : les personnes qui donnent un consentement pour autrui doivent agir dans l'intérêt de la personne représentée (art. 12 C.c.Q.). Dans cet esprit, si cette disposition est appliquée en harmonie avec les principes qui doivent régir la conduite des représentants d'une personne inapte ou d'un mineur, la recherche visant un groupe de personnes n'aurait lieu que dans un cas : si l'on peut à la fois espérer un bienfait pour la personne soumise à la recherche et un bénéfice pour la classe de personnes qui présentent les mêmes caractéristiques. 3. L'aliénation d'une partie du corps L'aliénation d'une partie du corps implique nécessairement une atteinte à l'intégrité de la personne. Le consentement de la personne ou l'autorisation de la loi est donc nécessaire afin de légitimer toute atteinte portée au corps d'une personne (art. 10 C.c.Q.). Dans tous les cas d'aliénation d'une partie du corps, le consentement doit être donné par écrit (art. 24, al. 1 C.c.Q.). L'aliénation ne peut donner lieu à une contrepartie financière ; elle doit être gratuite (art. 25, al. 1 C.c.Q.). Cette règle constitue une application du principe de l'extracommercialité du corps humain. a) L'aliénation entre vifs En matière d'aliénation entre vifs d'une partie du corps, la qualité du consentement libre et éclairé de la personne dépend de l'étendue de l'information divulguée qui doit se rapporter à l'ensemble de l'intervention et des prélèvements qui seront effectués en vue de l'aliénation. L'étendue du devoir d'information est tout aussi importante qu'en matière d'expérimentation. Ainsi, l'information doit, par exemple, permettre au donneur de comprendre la nature irréversible et permanente de l'acte dans le cas d'une aliénation faite en vue d'une transplantation, de connaître les chances de réussite et d'échec de l'acte, de comprendre les risques associés à l'ajustement à l'absence de l'organe, de connaître la nature des traitements et des risques qui leurs sont associés à la suite de tout acte. Outre l'exigence du consentement de la personne à l'acte d'aliénation et à ses accessoires, le code prévoit deux régimes différents qui limitent l'exercice du consentement d'une personne à l'aliénation d'une partie de son corps : un premier pour les personnes majeures aptes, un second pour les personnes majeures inaptes et les mineurs. 1) La personne majeure apte Le code prévoit deux types d'aliénation d'une partie du corps entre vifs : l'aliénation d'une partie du corps à proprement parler et le prélèvement d'une partie du corps pour fins de recherche. Une personne majeure apte ne peut aliéner une partie de son corps entre vifs que si le risque couru n'est pas hors de proportion avec le bien-être qu'on peut raisonnablement en espérer (art. 19, al. 1 C.c.Q.). Le bénéfice n'est pas nécessairement physique. Il peut aussi être moral. Par exemple, un don d'organe fait Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 15 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA par un parent à son enfant. Toute comme en matière de recherche, le rapport de proportionnalité entre les risques et les bénéfices se situe dans un contexte plus large que le bénéfice à la personne concernée ; il peut s'agir d'un bénéfice pour un tiers. Une exigence additionnelle est imposée comme limite au consentement de la personne majeure apte : l'aliénation ne peut être répétée que si elle ne présente pas de risques sérieux pour la santé du donneur (art. 25, al. 1 C.c.Q.)61 . Le code n'impose pas, à la personne majeure apte, l'exigence que la partie du corps qui fait l'objet de l'aliénation soit susceptible de régénération. Elle pourra donc aliéner, par exemple, un rein, matière non susceptible de régénération, comme elle pourra faire un don de sang ou de sperme, matières susceptibles de régénération. Toutefois, et de façon évidente, elle ne pourra aliéner entre vifs un organe vital. Cet empêchement ne résulte pas de l'exigence de régénération, mais plutôt de l'analyse de la proportionnalité entre les risques et les bénéfices, de même que de l'ordre public. Le prélèvement d'une partie du corps aux fins de recherche constitue aussi une aliénation d'une partie du corps. Le consentement de la personne est donc nécessaire. Le consentement sera, par exemple, exigé pour l'aliénation de veines retirées lors d'une intervention chirurgicale, de sang prélevé, de tissus foetaux. Ce n'est pas la nature de l'organe, du tissu ou de la substance qui font que le consentement à l'aliénation est exigé, mais plutôt le fait que ces substances ont été obtenues à la suite de prélèvements et donc, d'atteintes à l'intégrité. Dans le cas de prélèvements, l'exigence de proportionnalité entre les risques et les bienfaits de l'acte ne se pose pas : le prélèvement a déjà été effectué lors de soins et n'entraîne pas de risques additionnels. Le consentement au prélèvement ou à l'atteinte à l'intégrité ressort du domaine du consentement aux soins pour lesquels le prélèvement a été effectué. Le consentement exigé à l'article 22 du code pour l'utilisation des produits du corps aux fins de recherche ne se rapporte donc pas à l'atteinte à l'intégrité. Il se rapporte à l'usage même des substances, à l'aliénation et non au prélèvement. La personne devra alors être informée du fait que les tissus prélevés serviront à des fins de recherche afin que cet usage soit légitime. 2) La personne majeure inapte ou le mineur Une personne majeure inapte ou un mineur ne peuvent aliéner une partie de leur corps que si celle-ci est susceptible de régénération et qu'il n'en résulte pas un risque sérieux pour leur santé. Si la partie du corps est susceptible de régénération et qu'il ne résulte pas de l'intervention nécessaire à l'aliénation de risque sérieux pour la santé de la personne, le consentement du titulaire de l'autorité parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur à la personne devra être obtenu, de même que l'autorisation du tribunal (art. 19, al. 2 C.c.Q.). Notons que, dans le cas des personnes majeures inaptes, seules celles soumises à un régime de protection établi à l'égard de leur personne, ou celles représentées par un mandataire, pourront aliéner une partie de leur corps. Le tribunal, saisi d'une demande d'autorisation d'aliénation, tiendra compte des exigences propres à l'aliénation d'une partie du corps et, aussi, d'un certain nombre de facteurs externes dont le conflit d'intérêts possible du représentant alors que le donneur et le receveur pourraient tous deux être des personnes liées et, surtout, de l'intérêt du donneur. Si par contre le mineur ou la personne majeure inapte refuse d'aliéner une partie de son corps, ce refus devra être respecté (art. 23, al. 2 C.c.Q.). Quant au consentement à l'utilisation aux fins de recherche des prélèvements utilisés lors de soins, le code n'établit aucune distinction entre la personne majeure apte et la personne majeure inapte ou le Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 16 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA mineur. Dans le cas de la personne majeure inapte et du mineur, il faudra alors identifier qui peut consentir à l'aliénation. b) L'aliénation après le décès L'aliénation d'une partie du corps après le décès se rattache à la fois aux principes se rapportant à l'aliénation et à ceux qui découlent du respect du corps humain après le décès. Malgré son rattachement au régime des atteintes à l'intégrité de la personne, le régime des aliénations d'une partie du corps après le décès est particulier. Le code n'établit aucune distinction entre la personne majeure apte ou inapte, mais conserve la distinction entre le mineur de 14 ans et plus, assimilé dans ce cas à la personne majeure, et le mineur de moins de 14 ans. La personne majeure et le mineur de 14 ans et plus peuvent, dans un but médical ou scientifique, donner leur corps ou autoriser sur celui-ci un prélèvement d'organes ou de tissus (art. 43, al. 1 C.c.Q.). L'aliénation se faisant à la suite du décès de la personne, il n'y a aucune exigence se rapportant à la personne décédée, sauf en ce qui a trait à son consentement ou aux volontés qu'elle a exprimées. Ces volontés peuvent être exprimées verbalement devant deux témoins ou par écrit (art. 43, al. 2 C.c.Q.). Dans le cas du mineur de moins de 14 ans, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur pourront aussi donner, dans un but médical ou scientifique, le corps du mineur ou autoriser sur celui-ci un prélèvement d'organes ou de tissus (art. 43, al. 1 in fine C.c.Q.). Le code reconnaît par ces règles l'effet de l'autonomie de la personne sur son corps qui se prolonge à la suite du décès. Le code impose même un devoir aux personnes qui disposeront du corps du défunt de suivre les volontés de la personne décédée, sauf motif impérieux (art. 43, al. 2 C.c.Q.). Il semble que pourraient être considérés comme un motif impérieux toute expression de volonté dont l'objet serait contraire à l'ordre public, l'impossibilité d'exécuter les volontés du défunt, l'absence de receveur, le mauvais état des tissus ou des organes aux fins de transplantation, ou même le changement de volonté du défunt, même si celui-ci n'a pas suivi les formes prévues. Notons que lorsque le défunt n'a pas suivi les formes prévues afin d'exprimer ses volontés quant à la disposition de son corps, ces volontés devraient malgré tout être considérées par la personne qui consent au prélèvement (art. 44 C.c.Q.). En l'absence d'expression de volonté de la part du défunt, le prélèvement peut être effectué avec le consentement de la personne qui aurait pu consentir aux soins (art. 44, al. 1 C.c.Q.). On doit alors se rapporter à l'article 15 du code pour la personne majeure et à l'article 14, al. 1 du code pour le mineur de 14 ans et plus. L'objectif de ces dispositions étant de respecter le défunt par le respect de ses volontés, il paraît logique que l'on ait préféré aux héritiers ou successibles la personne qui aurait pu consentir aux soins, celle-ci étant considérée comme la plus apte à prendre une décision conforme aux volontés du défunt. Si toutefois une situation urgente se présente où un prélèvement offre l'espoir de sauver une vie humaine ou de sensiblement améliorer la qualité de vie d'une autre personne, le consentement des personnes autorisées à consentir pour le défunt ne sera pas nécessaire, dans la seule mesure où le consentement ne peut être obtenu en temps utile (art. 44, al. 2 C.c.Q.). Dans ce cas, deux médecins doivent attester de l'existence des circonstances qui justifient l'absence de consentement. 4. Le respect du corps après le décès Le respect du corps après le décès se rattache à la valeur et à la dignité qui étaient accordées à la Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 17 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA personne de son vivant. C'est dans cette optique que le code affirme le respect des volontés du défunt après sa mort quant à la disposition et à l'utilisation de son corps. Ainsi, le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son cadavre. Il en est de même pour le mineur, avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur (art. 42 C.c.Q.). Ce n'est que pour des raisons d'intérêt ou de santé publique que les volontés du défunt ne seront pas suivies. 5. La garde en établissement Le Protecteur du citoyen a fait des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux pour remédier aux lacunes dans la mise en oeuvre de la loi P-38.001. Son rapport en date du 18 février 2011 intitulé « Les difficultés d'application de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001, ) » est disponible sur son site Internet (www.protecteurdu citoyen.qc.ca) sous l'onglet Dossiers et documentation et ensuite sous le lien Rapports d'enquête et rapports spéciaux. La garde en établissement vise l'hébergement de personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une évaluation psychiatrique (art. 26, al. 1 C.c.Q.). Elle constitue une atteinte à l'intégrité de la personne, car elle a pour effet de restreindre physiquement la personne qui y est soumise. Ainsi, conformément à la règle générale de l'article 10 C.c.Q., aucune personne ne peut être gardée dans un établissement sans son consentement ou sans que le tribunal ou la loi ne l'autorise63 . La garde ne doit toutefois pas être confondue avec le simple hébergement d'une personne dans un établissement de santé64 . Un hébergement qui ne résulte pas du danger que pose l'état mental de la personne pour elle-même ou pour autrui ne constitue pas une garde en établissement au sens des articles 26 et suivants C.c.Q., mais des soins auxquels s'appliquent les dispositions générales sur le consentement aux soins. Lorsque la garde est légitimée par le consentement de la personne, ce consentement doit, comme dans tous les autres cas, être libre et éclairé. La personne doit donc comprendre la nature et les conséquences de la garde afin que son consentement soit valide. Si la personne n'est pas apte à donner son consentement, le code prévoit que dans le cas du mineur ou de la personne majeure soumise à un régime de protection à la personne, son représentant pourra le faire, à moins qu'il n'y ait opposition de sa part (art. 26, al. 2 C.c.Q.), auquel cas l'autorisation du tribunal sera nécessaire (art. 26, al. 1 C.c.Q.). Cette autorisation pourra porter sur la garde faisant suite à une évaluation psychiatrique (art. 30 C.c.Q.) ou porter sur la garde provisoire en vue d'une évaluation psychiatrique (art. 27 C.c.Q.). Dans ce dernier cas, la personne qui demande qu'une personne soit gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux devra démontrer qu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental (art. 27, al. 1 C.c.Q.)65 . Si toutefois le danger est grave et immédiat, la personne pourra être mise sous garde préventive, malgré son opposition et malgré l'absence d'autorisation du tribunal (art. 27 , al. 2 C.c.Q.)66 . Dans le cas de la personne majeure inapte qui n'est pas pourvue d'un représentant, l'autorisation du tribunal sera requise (art. 26 C.c.Q.), à moins qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence auquel cas elle pourra être mise sous garde préventive (art. 27, al. 2 C.c.Q.)67 . La demande pour faire subir une évaluation psychiatrique ou pour que la personne soit gardée se fait selon les règles applicables aux demandes relatives à l'intégrité de la personne (art. 71 C.p.c.), soumise à des conditions particulières liées à la signification et à l'audition (art. 399 C.p.c.). Dans le cas d'une Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 18 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA demande pour faire subir une évaluation psychiatrique, le requérant devra démontrer qu'il a des motifs sérieux de croire que la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental. Si la demande est refusée par le tribunal, une deuxième demande fondée sur les mêmes faits ne peut être représentée. De nouveaux faits doivent être allégués (art. 27, al. 1 C.c.Q.). Les dispositions qui prévoient les formalités requises en vue d'une garde en établissement sont d'interprétation restrictive. Lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d'une évaluation psychiatrique, un premier examen doit avoir lieu dans un délai de 24 heures à compter de la prise en charge de la personne ou, s'il y a eu garde préventive, de l'ordonnance du tribunal (art. 28, al. 1 C.c.Q.). Si ce premier examen mène à la conclusion qu'une garde est nécessaire, un deuxième examen doit être effectué (art. 28, al. 2. C.c.Q.). Il n'y aura de garde provisoire que lorsque les deux médecins auront conclu à la nécessité de la garde (art. 28, al. 3 C.c.Q.). Le jugement portant sur la garde en vue d'une évaluation psychiatrique doit ordonner la remise des rapports d'examen au tribunal dans les sept jours du jugement. Ces rapports doivent porter sur la nécessité d'une garde en établissement si la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l'aptitude de la personne à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection (art. 29 C.c.Q. ). Si les rapports concluent à la nécessité de garder la personne en établissement, la garde ne peut avoir lieu, en l'absence de consentement, qu'avec l'autorisation du tribunal (art. 26, 28, al. 3 et 30 C.c.Q.). Le tribunal n'autorisera alors la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit la preuve présentée et même en l'absence de contre-expertise (art. 30, al. 2 C.c.Q.)68 . Dans un arrêt, Montagne c. Dr. Prosper69 , la Cour d'appel du Québec s'est prononcée sur l'interprétation de l'article 30 C.c.Q. et de l'article 3 de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui70 . Selon la Cour d'appel, lorsqu'il exerce la discrétion conférée par l'article 30 C.c.Q., le tribunal doit indiquer les motifs sérieux qui l'amènent à croire à la dangerosité de la personne visée par la demande et à la nécessité de la garde. Les rapports d'examens psychiatriques doivent quant à eux indiquer les motifs et les faits nécessaires à la conclusion de la dangerosité pour satisfaire les exigences du paragraphe 5 de l'article 3 de la loi71 . La Cour d'appel a aussi précisé dans la décision N.B. c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec72 que la ferme intention du législateur n'est pas de subordonner la liberté des citoyens à l'expression d'avis non détaillés ni motivés, fussent-ils ceux de psychiatres73 . Dans l'arrêt A. c. Centre Hospitalier de St. Mary74 , la Cour d'appel a précisé qu'il doit également exister pour la personne un danger important ou un potentiel de danger élevé et que le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer75 . Le fardeau de preuve de la dangerosité repose sur les épaules de la partie qui demande l'ordonnance de garde76 et la norme de preuve est celle de la prépondérance de preuve77 . La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d'une personne. La dangerosité d'une personne qui présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu'une telle personne est ou doit être dangereuse78 . La garde en établissement ne peut constituer un traitement en l'absence d'un facteur de dangerosité79 . Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 19 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA Le jugement portant sur la garde à la suite d'un examen psychiatrique doit fixer la durée de la garde (art. 30.1, al. 1 C.c.Q.). Si cette garde n'est plus justifiée avant que le délai prévu par le tribunal ne soit expiré, la personne doit être libérée (art. 30.1, al. 2 C.c.Q.)80 . Dans un tel contexte, cette garde, qui ne s'avère plus justifiée, peut être levée par le médecin lui-même, ou par le Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande de la personne concernée ou par toute personne qui démontre un intérêt pour l'ordonnance émise par la Cour du Québec. Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le jugement doit à nouveau être autorisée par le tribunal selon la même procédure (art. 30.1, al. 3 C.c.Q.). Dans les cas où la loi autorise la garde en établissement, malgré l'opposition de la personne concernée et l'absence d'autorisation du tribunal (c'est-à-dire lorsque la personne représente pour elle-même ou pour autrui un danger immédiat et grave, soit une situation où la personne est prête à passer à l'acte), la garde ne pourra être que préventive (art. 27, al. 2 C.c.Q.)81 . Elle ne pourra durer que 72 heures, à moins qu'un tribunal n'ait ordonné que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique (art. 7 de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui)82 . Cette ordonnance n'aura lieu qu'à la suite d'une demande pour faire subir une évaluation psychiatrique. En l'absence d'une ordonnance prolongeant la garde, l'établissement pourrait se voir reprocher, par voie d'habeas corpus, d'avoir gardé illégalement cette personne. Le jugement ordonnant la garde d'une personne, en vue de la soumettre à une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation, est exécutoire immédiatement. Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'exécution de ce jugement s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice (art. 361 et 397 C.p.c.). La Cour d'appel, dans la décision A. c. Centre Hospitalier de St. Mary83 , s'est penchée sur les conditions et les critères d'octroi ou de refus d'une demande en suspension de l'ordonnance de mise sous garde et sur le sens à donner à l'expression « intérêt de la justice ». C'était la première fois que la Cour d'appel avait à se prononcer sur cette question. Madame la juge Bich a appliqué les conditions et critères développés par la jurisprudence en regard de l'ancien article 550 C.p.c. et ils sont analogues à ceux qu'on applique en matière de suspension d'injonction. La Cour d'appel84 a, le 25 juillet 2007, accueilli une autre demande en suspension de l'exécution de l'ordonnance de garde en établissement. Le juge Dalphond précise que le juge de la Cour du Québec était tenu d'interroger l'appelant hormis s'il était manifestement inutile de l'entendre (art. 391 et 392 C.p.c.)85 . Le cas échéant, le juge devait en expliquer les raisons en étayant celles-ci par une preuve factuelle. Or, le juge Dalphond conclut que non seulement le témoignage de l'appelant ne paraît pas manifestement inutile, mais le juge n'a pas motivé sa décision de ne pas entendre ce témoignage. Le jugement souffre donc d'une irrégularité grave qui dénote une faiblesse sérieuse. Dans tous les cas où une personne est gardée en établissement, elle ou son représentant doivent être informés du plan de soins établi à son égard (art. 31 C.c.Q.)86 . Les règles relatives au consentement aux soins s'appliquent. La Cour du Québec est le tribunal qui entend toute demande pour faire subir une évaluation psychiatrique à une personne qui la refuse ou pour qu'elle soit gardée contre son gré par un établissement (art. 38 C.p.c.). Le jugement ordonnant la garde d'une personne, en vue de la soumettre à une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation, peut faire l'objet d'un appel de plein droit à la Cour d'appel. L'appel Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 20 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA doit être formé dans les cinq jours qui suivent la décision (art. 354, 361 et 383 C.p.c.). La procédure d'appel est la même qu'en matière d'habeas corpus, en y faisant les adaptations nécessaires (art. 354, 361 et 383 C.p.c.). De plus, toute personne croyant que le maintien d'une garde ou de la décision prise en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui 87 n'est plus nécessaire parce ce qu'elle ne représente plus un danger pour elle-même ou pour autrui, peut demander la levée de la garde devant le Tribunal administratif du Québec88 . Ce recours est entendu d'urgence. Il peut s'agir d'une situation où la personne concernée par l'ordonnance de la Cour du Québec accepte son traitement et ne représente plus un danger pour elle-même ou pour autrui. Dans ce contexte, le médecin peut lever la garde ou la personne concernée ou celle démontrant un intérêt peut présenter au Tribunal administratif du Québec une demande et une preuve à cet effet. Ce dernier, après avoir soupesé la preuve, pourra décider de la nécessité du maintien de l'ordonnance de la Cour du Québec. Il ne s'agit pas d'un appel de la décision de la Cour du Québec, mais bien d'une demande visant à établir si la garde est toujours justifiée et doit être maintenue en fonction de l'état mental de la personne au jour de l'audience. Une lettre de la personne adressée à ce tribunal, exposant l'objet et les motifs de contestation, constitue une demande au sens de l'article 110 de la Loi sur la justice administrative89 . Le seul critère qui devra guider la formation du Tribunal administratif (composée d'un membre juriste, d'un membre psychiatre et d'un troisième membre, psychologue ou travailleur social) est la dangerosité au jour de l'audience90 de la personne concernée par l'ordonnance de la Cour du Québec. Cette question de dangerosité demeure une question de faits et une question médicale. Comme le souligne le professeur Goubau, il n'existe pas « de critères absolus ou exhaustifs, tout au plus certains jalons susceptibles de guider ceux qui ont à prendre une décision en matière de garde. À ce titre, au nombre des éléments qui sont généralement retenus par le Tribunal administratif chargé de réviser la situation des personnes qui ont été admises sous garde, on mentionnera l'absence d'autocritique, combinée avec la présence d'éléments psychotiques et un comportement agressif, d'idées suicidaires, d'un comportement régressif, ou de l'incapacité de contrôler ses pulsions »91 . Rappelons que la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ne permet pas le traitement d'une personne contre son gré 92 , ni n'entraîne l'obligation pour cette personne de se soumettre à des examens psychiatrique autres que ceux déterminés comme nécessaires par la loi. 6. La Commission d'examen pour troubles mentaux Le Code criminel traite de façon particulière les personnes atteintes de troubles mentaux qui ont commis des actes criminels ou des infractions sommaires. Ces personnes doivent être traitées de façon équitable dans le respect de la protection du public. La détermination des mesures à prendre pour assurer la protection du public incombe à la Commission d'examen des troubles mentaux composée de juges administratifs de la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec. Celle-ci rend des décisions concernant les personnes qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou déclarées inaptes à subir leur procès. Ces décisions peuvent porter atteinte à l'intégrité des personnes, car elles ont pour effet de les restreindre physiquement dans certains cas. La Commission d'examen rend des décisions qui sont exécutoires au même titre que celles d'un tribunal judiciaire. La Commission d'examen se Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 21 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA caractérise par son rôle inquisitoire en audience. Elle doit, entre autres, répondre aux questions suivantes : Ces personnes représentent-elles encore un risque important pour la société ? Sont-elles devenues aptes à subir leur procès ? Juristes, psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux sont appelés à se prononcer sur ces questions. L'article 672.38 du Code criminel prévoit qu'une Commission d'examen est constituée pour chaque province et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès. La Commission d'examen tire donc sa juridiction et sa compétence du Code criminel, mais elle est constituée par l'article 19 de la Loi sur la justice administrative93 . La Commission d'examen siège généralement en formation de trois membres et est constituée du président ou du président délégué (juriste), d'un membre qui est autorisé par le droit d'une province à exercer la psychiatrie (psychiatre) et d'un autre membre de la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec qui peut être psychologue, travailleur social, médecin, avocat, psychiatre, etc. (art. 672.41 C.cr.). En rendant sa décision, la Commission d'examen doit prendre en considération quatre facteurs : (1) la sécurité du public ; (2) l'état mental de l'accusé ; (3) la réintégration sociale de l'accusé dans la société et (4) les autres besoins de l'accusé. Depuis l'entrée en vigueur de la loi C-6, le 11 juillet 2014, la nécessité de protéger le public est devenue le facteur prépondérant parmi les critères habituellement retenus par la Commission d'examen. L'article 672.54 du Code criminel précise que la Commission d'examen doit rendre la décision nécessaire et indiquée dans les circonstances parmi celles prévues à cet article. Ainsi, le critère voulant que la Commission d'examen rende la décision la moins privative de liberté pour l'accusé a cédé la place à la décision nécessaire et indiquée dans les circonstances. Il n'en demeure pas moins que la décision la moins privative de liberté peut être la décision nécessaire et indiquée à rendre pour assurer la protection et la sécurité du public94 . Il y a trois catégories de décisions pour les accusés ayant fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle : a) une libération inconditionnelle ; b) une libération avec conditions ; c) une détention avec ou sans possibilité de sorties. Et il y a deux catégories de décisions pour les accusés déclarés inaptes à subir leur procès : a) une libération avec conditions ; b) une détention avec ou sans possibilité de sorties. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 22 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA De plus, l'article 672.851 C.cr. prévoit que la Commission d'examen peut recommander au tribunal judiciaire de suspendre l'instance dans le cas d'un accusé inapte de façon permanente et qui ne représente plus de danger important pour la sécurité du public. Tant que l'accusé n'est pas libéré inconditionnellement ou jugé apte à subir son procès, une révision doit être tenue par la Commission d'examen dans les douze mois qui suivent la première audience et, par la suite, à l'intérieur de chaque période de douze mois qui suit une décision de la Commission d'examen (art. 672.81 et s. C.cr.). Cette révision permet d'évaluer la situation de l'accusé de façon contemporaine à la date de l'audience. L'alinéa 672.54 (a) du Code criminel nous indique qu'un accusé ayant fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle bénéficie d'une libération inconditionnelle si la Commission d'examen est d'avis qu'il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public. Dans l'arrêt Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute)95 , la Cour suprême du Canada a mentionné qu'il n'existe aucune présomption de dangerosité de la part de l'accusé du fait du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et qu'en cas d'incertitude ou de doute sur le risque que représente l'accusé, la Commission d'examen doit favoriser ce dernier en accordant une libération inconditionnelle. L'entrée en vigueur de la loi C-6, a entraîné des modifications au Code criminel dont les effets sont immédiats vu l'absence de dispositions transitoires. C'est ainsi que le législateur a introduit la notion d'« accusé à haut risque ». Au moment où le tribunal judiciaire déclare l'accusé non criminellement responsable, il peut déclarer l'accusé à haut risque. Un accusé à haut risque est : • un accusé âgé de 18 ans ou plus au moment de la perpétration de l'infraction ; • qui a fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ; • pour une infraction grave contre la personne96 ; et si, selon le cas : • le tribunal est convaincu qu'il y a une probabilité marquée que l'accusé usera de violence de façon qu'il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ; • le tribunal est d'avis que les actes à l'origine de l'infraction étaient d'une nature si brutale qu'il y a un risque de préjudice grave – physique ou psychologique – pour une autre personne. Dans cette éventualité, la Commission d'examen doit tenir une audition pour cet accusé. L'accusé sera automatiquement détenu pour une période d'une année. Au terme de cette année, la Commission d'examen tiendra des révisions annuelles de la situation de l'accusé. Elle devra décider si l'accusé représente toujours un risque pour la sécurité du public, mais ne pourra rendre comme décision qu'une détention selon l'alinéa 672.54 c) du Code criminel, selon les restrictions énoncées au paragraphe 672.64 (3). Toutefois, si elle est convaincue que l'accusé n'usera Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 23 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA pas de violence de façon à mettre en danger la vie ou la sécurité d'une personne, elle pourra recommander à la Cour supérieure de juridiction criminelle de réviser la déclaration d'accusé à haut risque. La Commission d'examen n'ayant pas le pouvoir de le faire elle-même97 . Depuis les modifications législatives de juillet 2014, deux questions relatives aux accusés à haut risque ont été portées devant les tribunaux. Une première porte sur l'application rétroactive de l'article 672.64 aux délits commis avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La Cour du Québec98 est d'avis qu'elle n'était pas applicable à ces délits refusant de donner à cette disposition une portée rétroactive alors que la Cour du Banc de la Reine de Colombie-Britannique99 est d'avis contraire. D'autre part, pour la première fois au Canada, la Commission d'examen des troubles mentaux du Québec a rendu une décision100 retournant le dossier dont elle était saisie à la Cour supérieure afin que soit révisée, conformément au Code criminel, la déclaration d'accusé à haut risque. Le juge Marc David de la Cour supérieure a rendu un jugement101 qui annule cette déclaration d'accusé à haut risque retenant essentiellement comme éléments de preuve que la dangerosité de l'accusé avait considérablement diminué, que sa maladie était stable, que le patient était asymptomatique, que son autocritique s'était améliorée et qu'il présentait une bonne collaboration à son plan de traitement. La loi C-6 introduit également de nouvelles dispositions traitant des victimes dont l'article 672.542 C.cr. qui permet au tribunal ou à la Commission d'examen, s'il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système de justice, d'imposer à l'accusé, à titre de modalités de la décision, tout ou parties des obligations suivantes : a) de s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement avec toute personne qui est identifiée dans la décision ou d'aller dans un lieu qui y est mentionné ; b) d'observer telles autres modalités que le tribunal ou la Commission d'examen estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes. Quoique la victime ne soit pas une partie à l'audience de la Commission d'examen, elle peut néanmoins, comme avant l'entrée en vigueur de la loi C-6, produire devant la Commission d'examen, une déclaration. Le paragraphe 672.5 (14) C.cr. précise que cette déclaration de la victime doit décrire les dommages, corporels et autres, ou les pertes économiques qui lui ont été causés. Les modalités de cette déclaration sont prévues aux paragraphes 672.5 (15) et s. C.cr. de même qu'au formulaire édicté à cette fin102 . La Commission d'examen conserve le pouvoir de limiter le contenu de cette déclaration de la victime si elle est d'avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice103 . La Commission d'examen doit informer une victime qui le demande du lieu de résidence projeté de l'accusé libéré inconditionnellement ou sous réserve de conditions (art. 672.5 (5.2) C.cr.). Toute décision rendue par la Commission d'examen est appelable de plein droit directement devant la Cour d'appel (art. 672.72 C.cr.). C- Les droits à l'honneur et à la réputation Les droits à l'honneur et à la réputation sont intimement liés l'un à l'autre par leur rattachement à la dignité et à l'intégrité morale de l'individu104 . Ils sont prévus à l'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne, avec le droit à la dignité auquel ils semblent se rattacher de façon naturelle. Ces droits se rattachent aussi, dans plusieurs circonstances, au respect de la vie privée (art. 35 C.c.Q. et art. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 24 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA 5 de la Charte des droits et libertés de la personne). Certaines nuances s'imposent pourtant quant à l'intérêt qui est protégé par chacun de ces droits. Le droit à l'honneur se rapporte de façon plus intime à la perception que la personne a d'elle-même et s'évalue de manière subjective ; il ne relève pas de l'opinion publique, bien qu'il dépende en partie de l'entourage de la personne. Des exemples considérés par plusieurs comme dépassés ont été abordés sous l'angle du droit à l'honneur : la séduction, les ruptures de fiançailles et l'aliénation d'affection. Par ailleurs, le harcèlement sexuel est souvent considéré comme une forme d'atteinte à l'honneur et à la dignité 105 . Le droit à la réputation a une autre dimension qui fait nécessairement appel à l'opinion publique et se rattache plus étroitement à l'idée de renommée qu'à celle de dignité. Il implique la reconnaissance par les autres de la valeur et des qualités de la personne dans un milieu donné et implique une perte d'estime ou de considération des tiers envers la personne106 . Malgré ces distinctions terminologiques et doctrinales, la jurisprudence a généralement considéré ces droits sans distinction, le plus souvent en matière de diffamation. Le droit civil ne fait pas de distinction entre le libelle et la diffamation ou entre l'injure et la diffamation. La notion de diffamation s'entend dans un sens large. Elle couvre à la fois l'insulte qui ne contient aucune allégation de faits, l'atteinte à l'honneur et l'atteinte stricte à la réputation. La nature de la demande en diffamation relève plus du droit de la responsabilité civile que du droit des personnes. Il convient toutefois de préciser que la demande en diffamation exige d'abord qu'un regard soit posé sur l'effet de la conduite d'une personne sur l'honneur ou la réputation d'une autre. Aussi, cette demande n'exige pas que l'atteinte ait été le résultat d'un acte intentionnel ou de la mauvaise foi de l'auteur de la diffamation. Il suffit que l'auteur et celui qui diffuse l'information aient donné des informations fausses ou présentées de manière à semer le doute quant à l'honneur et à la réputation de la personne107 . L'insouciance quant à la vérité des informations et l'absence d'intention ne constituent pas alors une défense108 . Si, par ailleurs, les informations sont vraies, mais que leur divulgation est faite en vue de nuire109 , de manière trompeuse110 ou avec l'intention d'injurier111 , on considérera que cette intention constitue une faute qui ne peut légitimer l'atteinte et que la demande est fondée. Par ailleurs, une défense de commentaire loyal peut être faite lorsqu'il existe un intérêt public dans la divulgation de l'information, que le commentaire est fait avec l'intention honnête de servir une cause juste et que la conclusion à laquelle arrive la personne qui a fait le commentaire est raisonnablement soutenable à l'égard des faits rapportés, dans la mesure où cette défense s'intègre dans l'évaluation du contexte déterminé dans lequel s'évalue la conduite de la personne au regard du critère de la faute et de la raisonnabilité du comportement de celle-ci112 . Les droits à l'honneur ou à la réputation d'une personne, comme tout autre droit, ne sont pas absolus. Ils sont limités, surtout, par la liberté d'opinion et d'expression qui servent, dans certains cas, à légitimer les atteintes à ces droits. Ces libertés sont enchâssées dans la Charte canadienne des droits et libertés113 et réitérées dans la Charte des droits et libertés de la personne114 . Elles s'imposent comme limite aux autres droits fondamentaux, ainsi qu'aux droits de la personnalité protégés dans le Code civil du Québec115 tout comme ceux-ci s'imposent aussi comme limites à ces libertés. On a alors recours au critère de proportionnalité entre la protection de deux intérêts qui entrent en conflit. En fait, le véritable baromètre en matière de liberté d'expression et, plus particulièrement, de presse et des autres moyens de communication, se situe dans la notion d'intérêt public et du droit du public à l'information116 qui justifieront, selon la personne, sa situation, les faits en cause et l'intérêt de la nouvelle, l'atteinte aux droits à l'honneur ou la réputation. En l'absence d'un tel intérêt public dans l'information, la balance des intérêts pourra plus facilement pencher en faveur des droits à l'honneur et Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 25 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA à la réputation. Il en sera de même lorsque l'usage de la liberté est abusif et vise à nuire à la personne117 . Dans tous ces cas, lorsque l'atteinte reprochée résulte de la publication d'informations dans un journal, le droit d'introduire une demande en justice de la personne qui se croit lésée et les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés sont limités par les dispositions de la Loi sur la presse118 . Est un journal au sens de la loi, « tout journal ou écrit périodique dont la publication à des fins de vente ou de distribution gratuite a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d'une fois par mois et dont l'objet est de donner des nouvelles, des opinions, des commentaires ou des annonces. » (art. 1 de la Loi sur la presse). En vertu de cette loi, la personne qui se croit lésée doit, avant même d'intenter une demande, donner un avis préalable, de trois jours non fériés, au bureau du journal ou au domicile du propriétaire, afin de permettre au journal de rectifier l'information publiée ou de se rétracter (art. 3 de la Loi sur la presse). À défaut d'avis, la personne qui se croit lésée perd son droit d'introduire une demande en justice. Aussi, si le journal se rétracte, que la partie qui se croit lésée use de son droit de réponse et que le journal publie la réponse sans autre commentaire, il n'y a plus de poursuite possible (art. 8 de la Loi sur la presse). Dans le cas où ces conditions ne sont pas toutes remplies et que le journal se rétracte d'une manière complète et justifie de sa bonne foi, la personne lésée ne peut réclamer que le préjudice réellement subi (art. 4 de la Loi sur la presse). Le délai de prescription pour une demande contre un journal est raccourci. La demande doit être intentée dans les trois mois qui suivent la publication de l'article, ou dans les trois mois de la connaissance de la publication, pourvu, dans ce dernier cas, que la demande soit intentée dans le délai d'un an du jour de la publication de l'article incriminé (art. 2 de la Loi sur la presse). La Loi sur la presse prévoit quelques autres conditions, exceptions et formalités qui peuvent avoir une incidence sur les droits d'introduire une demande en justice de la personne qui se croit lésée et sur les privilèges de la presse119 . D- Les droits au nom et à l'image 1. Le droit au nom Le droit au nom est un droit qui participe des droits de la personnalité et de l'état civil de la personne (art. 3 et 55 C.c.Q.). On l'a même parfois qualifié de droit de propriété120 . Droit de la personnalité, car il est intimement lié à la personne : il l'identifie, l'individualise. Élément de l'état civil de la personne, car il constitue le noyau de l'individualisation de la personne nécessaire à l'établissement de sa condition (art. 50 et s. C.c.Q.). Chacun a droit de porter le nom qui lui est attribué dans son acte de naissance (art. 55 C.c.Q.). Chaque personne a même l'obligation de porter ce nom dans l'exercice de ses droits civils (art. 5 C.c.Q.). Cette obligation n'est toutefois pas absolue, car on permet implicitement à la personne de porter un nom autre que le sien (art. 56, al. 1 C.c.Q.). Celle-ci sera par contre responsable de la confusion que peut engendrer cet usage ou du préjudice qui peut en résulter (art. 56, al. 1 C.c.Q.). On reconnaît aussi que la protection du respect du nom s'étend au pseudonyme, lorsque l'usage de celui-ci est devenu notoire121 et lorsqu'en fait le pseudonyme est devenu un élément d'identification de la personne. Malgré la nature du droit au nom comme droit de la personnalité, le nom peut, dans certains cas, être transmissible et cessible lorsqu'il acquiert la qualité de nom commercial. Il change alors de nature et Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 26 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA jouit, dans ce cas, d'une double protection : l'une rattachée à la personne ; l'autre rattachée au commerce. Dans le premier cas, il n'est ni cessible ni transmissible. Dans le second, il est devenu, par son usage, un bien incorporel qui est cessible et transmissible. La personne à qui appartient le nom peut toujours conserver l'usage de son nom, sous réserve des limites contractuelles qui peuvent être rattachées à l'exercice d'un commerce ou d'une profession. Cet usage ne devra toutefois pas être abusif (art. 7 C.c.Q.). La sanction d'une atteinte au droit au nom n'a rien de particulier, sauf en ce qui a trait au titulaire du droit d'introduire une demande en justice. Peuvent exiger réparation ou s'opposer à l'utilisation du nom par une autre personne que son titulaire, le titulaire du nom, son conjoint marié ou uni civilement, ses proches parents (art. 56, al. 2 C.c.Q.). 2. Le droit à l'image L'image est le reflet de la personne. À ce titre, il n'est pas étonnant que l'image ait été l'un des premiers aspects de la personnalité à faire l'objet d'une protection. Avec le droit au respect de la vie privée, l'image a été au coeur du développement de la reconnaissance des droits de la personnalité comme droits subjectifs. La protection de l'image est d'ailleurs souvent rattachée à celle du droit au respect de la vie privée et, parfois, à celle du droit à la dignité ou des droits à l'honneur et à la réputation. Elle peut toutefois exister de façon autonome. Le rattachement du droit à l'image au droit au respect de la vie privée ne fait aucun doute ; le code prévoit cette protection de façon spécifique (art. 36 (3) C.c.Q.). Bien que l'image tombe sous la protection du droit au respect de la vie privée, les circonstances qui s'y rattachent devront pouvoir être qualifiées comme ressortissant du domaine de la vie privée de la personne. Le recours à la détermination de la sphère d'application du droit au respect de la vie privée sera donc central à la détermination de ce rattachement122 . Le rattachement du droit à l'image au droit à la dignité ou aux droits à l'honneur et à la réputation s'imagine aisément. Dans ce cas, l'usage de l'image d'une personne devra pouvoir constituer une atteinte à ces droits au regard du contenu propre à ces droits et les règles particulières applicables aux recours en diffamation s'appliqueront à ces cas. On peut par exemple penser que la dénaturation de la personnalité par le biais de l'image pourrait tomber sous cette forme de protection, ou l'humiliation faisant suite à la diffusion de l'image. La protection de l'image comme droit de la personnalité autonome n'est pas établie aussi clairement, ni par le code ni par la Charte des droits et libertés de la personne. Toutefois, l'article 3 du code établit une liste non exhaustive des droits de la personnalité qui permet l'inclusion du droit à l'image comme droit autonome, dans la mesure où ce droit peut se qualifier de droit de la personnalité, ce qui, nous croyons, ne fait aucun doute. Tout comme le droit au nom, le droit à l'image a aussi été qualifié de droit de propriété simple123 et, en plus, de droit de propriété intellectuelle124 . Cette qualification du droit à l'image comme droit de propriété confond la nature intrinsèque du droit avec son usage patrimonial. Le droit à l'image, comme tout autre droit de la personnalité, ne peut être qualifié de droit de propriété, car il n'est pas susceptible d'appropriation, caractère essentiel du droit de propriété. Il faudrait plutôt parler d'un monopole d'exploitation sur l'image qui lui pourrait être qualifié de bien incorporel. Le droit à l'image n'est pas absolu. En matière de responsabilité extracontractuelle, sa protection est Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 27 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA limitée, entre autres, par la liberté d'opinion et d'expression, ce qui renvoie à l'analyse déjà faite sur ce point. Toutefois, contrairement au droit au respect de la vie privée et aux droits à la dignité, à l'honneur et à la réputation, le droit autonome à l'image n'a pas été enchâssé comme droit fondamental de la personne dans la Charte des droits et libertés de la personne. Est-ce dire que ce droit ne pourra jamais l'emporter dans l'appréciation des intérêts en jeu ? Il semble que non, car une telle limite au droit à l'image par l'exercice de la liberté d'opinion et d'expression, sans aucune exception, équivaudrait à une dénégation du droit à l'image. On devrait alors, tout comme pour les droits à l'honneur et à la réputation, avoir recours aux notions d'intérêt public et de droit du public à l'information, ainsi qu'à l'objet de l'exercice de la liberté d'opinion et d'expression. E- Le droit au respect de la vie privée 1. La protection générale La vie privée d'une personne peut se décrire comme la part de sa vie qu'elle désire conserver pour elle-même ou ne veut partager qu'avec un entourage restreint. Dans un contexte plus large, elle se rapporte aussi aux notions de liberté, de dignité, d'autonomie morale et physique de la personne dans l'exercice de ses droits dans un contexte démocratique125 . La Charte des droits et libertés de la personne reconnaît spécifiquement le droit au respect de la vie privée comme droit fondamental (art. 5). Le Code civil du Québec le prévoit aussi comme un droit de la personnalité pour lequel un régime d'application général est prévu, ainsi que certaines règles particulières visant à protéger les renseignements personnels concernant une personne (art. 35 et s. C.c.Q.). Toute définition de la notion de vie privée est nécessairement inexacte, comme toute détermination de la sphère d'activités à laquelle elle correspond est nécessairement floue, car elle varie d'une personne à l'autre. La sphère de la vie privée a un caractère éminemment subjectif qui se rapporte à l'identité de la personne, à son rôle social, à la nature des actes qu'elle accomplit126 . Le contenu précis ou l'identification des intérêts que le droit au respect de la vie privée protège est donc impossible à fixer sans référence aux circonstances particulières de l'espèce ; sa délimitation se fait cas par cas. L'article 36 du code donne par contre quelques illustrations de situations qui, sans nécessairement constituer des atteintes au droit au respect de la vie privée, pourraient être ainsi qualifiées : la violation du domicile127 , l'interception ou l'utilisation de communications privées, la captation ou l'utilisation de l'image d'une personne lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé, la surveillance de la vie privée d'une personne, l'utilisation de son nom, de son image, de sa ressemblance ou de sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public, l'utilisation de la correspondance, des manuscrits ou autres documents personnels. Sont aussi considérés comme faisant partie de la vie privée d'une personne, son orientation sexuelle128 , son état de santé, son anatomie ou son intimité corporelle129 , ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques130 . Le droit au respect de la vie privée est un droit englobant qui, dans plusieurs cas, recoupe d'autres droits de la personnalité lorsque ceux-ci touchent à la sphère de la vie privée d'une personne. Ainsi, les droits à l'image, à l'honneur, à la réputation peuvent, suivant leur objet et les circonstances particulières de leur usage, bénéficier à la fois du régime de protection du droit au respect de la vie privée et de celui qui se rattache à l'un ou l'autre de ces droits. Afin de circonscrire la protection en cause, c'est à la finalité de la protection qu'il faut s'en remettre. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 28 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA Généralement, on reconnaît que le droit au respect de la vie privée correspond à deux prérogatives : celle de s'opposer à toute investigation dans la sphère privée d'une personne et celle de s'opposer à la divulgation d'information portant sur cette sphère. Ces prérogatives correspondent à deux intérêts généralement décrits comme la solitude et l'anonymat131 . À titre de prérogatives se rattachant à la protection des droits de la personnalité, aucune atteinte ne peut être commise sans le consentement de la personne132 ou l'autorisation de la loi (art. 35, al. 2 C.c.Q.). Les situations illustrées ci-dessus ne constituent pas en soi, dans tous les cas, des atteintes à la vie privée. Elles doivent se rapporter à des ingérences dans la sphère privée de la personne afin de constituer de telles atteintes. La délimitation de cette sphère de la vie privée d'une personne est généralement abordée comme reposant sur la dichotomie entre ce qui est privé et ce qui est public. Elle s'effectue par une analyse de l'ensemble des circonstances en cause et, plus particulièrement, l'identification de la personne, la nature des activités de celle-ci, de même que le lieu où elles sont accomplies. Elle se rapporte à une évaluation des attentes raisonnables d'une personne à se protéger des ingérences d'autrui. L'analyse de la portée de cette dichotomie se rattache souvent de manière très étroite à celle de l'intérêt légitime du public à l'information qui joue un rôle important dans l'établissement des limites de la vie privée comme élément de structuration du domaine de protection du droit, ainsi que dans la légitimation des atteintes à la vie privée dans l'exercice de la liberté d'opinion et d'expression. Tout comme les droits à l'honneur et à la réputation, la protection du droit au respect de la vie privée face à l'exercice des libertés de presse, d'opinion et d'expression devra s'évaluer en fonction d'un critère de proportionnalité de l'atteinte, d'une pesée des intérêts en jeu. Au-delà de la légitimation des atteintes en regard du droit du public à l'information et de l'exercice de la liberté d'opinion et d'expression et de l'effet du consentement de la personne concernée, d'autres limites autorisées par loi sont reconnues, plus particulièrement, en matière de protection des renseignements personnels. 2. La protection des renseignements personnels dans le secteur privé Il ne fait aucun doute que les renseignements personnels concernant une personne font partie de la sphère de sa vie privée (art. 36 (6), 37 et s. C.c.Q.)133 . Avant l'avènement du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, une personne devait, afin de protéger les renseignements personnels qui la concernaient dans le cadre de relations privées, s'appuyer sur le seul principe du respect du droit à la vie privée prévu à l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et sur l'article 1053 du Code civil du Bas-Canada (art. 1457 du code actuel), sauf dans les cas où des mécanismes de protection des renseignements personnels étaient prévus dans des lois particulières. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier (art. 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé)134 . Le Code civil du Québec et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé visent, comme le titre de la loi l'indique, à protéger les renseignements personnels en cherchant à pallier les abus d'usage et de dissémination des données à caractère personnel. Ils limitent donc la portée de la collecte de ces données, l'accès et leur dissémination à des personnes autres que la personne concernée. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 29 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA Les règles énoncées par le code (art. 37 et s. C.c.Q.) sont complétées par celles contenues dans la loi. Le code est d'application plus générale et s'applique à toute personne qui constitue un dossier sur une autre, alors que la loi s'applique à toute personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels sur une autre à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise (art. 1 de la Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé 135 ). Sont exclus de l'application de la loi, les organismes publics (art. 3 de la loi) et les données journalistiques, historiques ou généalogiques recueillies, détenues ou utilisées aux fins d'information du public (art. 1, al. 3 de la loi). Quatre grandes règles ressortent de l'ensemble des dispositions relatives à la constitution de dossiers : 1 o une personne ne peut constituer un dossier sur une autre que pour un objet déterminé et que si elle a un intérêt sérieux et légitime à le faire (art. 37 C.c.Q. et art. 4 de la loi)136 ; 2o une personne a un droit d'accès à tout dossier la concernant, sous réserve de certaines exceptions en vue de la protection de tiers ou en raison d'un intérêt sérieux et légitime à le faire (art. 38 et 39 C.c.Q. ; art. 27, 37 et s. de la loi) ; 3o une personne a un droit de rectification de tout renseignement personnel détenu à son sujet par une autre, s'il est inexact, incomplet ou équivoque ou périmé ou non justifié par l'objet du dossier (art. 40 et 41 C.c.Q. ; art. 28 de la loi) ; 4o toute personne qui constitue un dossier sur une autre doit protéger la confidentialité de ses dossiers et ne pas communiquer aux tiers les renseignements personnels qu'elle détient, sans le consentement de la personne concernée ou l'autorisation de la loi (art. 37 C.c.Q. ; art. 10 et s. de la loi). Ces différentes règles n'empêchent pas la constitution de dossiers, leur utilisation ou leur dissémination, mais prévoient des paramètres de justification pour la constitution de dossiers qui contiennent des données à caractère personnel. Elles permettent une large marge de manoeuvre aux personnes qui constituent des dossiers sur d'autres, en faisant largement appel à leur volonté d'autoréglementation et en permettant une série d'atteintes aux intérêts qu'elles visent justement à protéger. Le code n'impose pas de manière spécifique aux détenteurs de renseignements personnels d'informer la personne concernée de l'existence d'un dossier à son sujet, alors que c'est là que réside la véritable protection ; sans connaissance de l'existence du dossier, les autres droits qui sont reconnus par l'ensemble des dispositions sont de peu d'utilité. Par ailleurs, la loi prévoit, de manière accessoire, l'information de la personne concernée quant à l'existence d'un dossier à son sujet (art. 4 et s. de la loi). En effet, lorsque les renseignements sont obtenus directement de la personne concernée, une obligation expresse est prévue de l'informer de l'objet du dossier, de l'utilisation qui sera faite des renseignements, des catégories de personnes qui y auront accès et de l'endroit où sera tenu le dossier (art. 8 de la loi ; voir aussi l'article 37 C.c.Q.). Il existe une obligation semblable lorsqu'il s'agit de la constitution de listes nominatives utilisées à des fins de prospection commerciale ou philanthropique. Dans ces cas, les entreprises doivent accorder aux personnes concernées une occasion valable de refuser que des renseignements personnels les concernant soient utilisés à de telles fins (art. 22 et 23 de la loi). De façon générale, lorsque les renseignements sont détenus par une entreprise, et donc lorsque la Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé s'applique, il semble qu'une personne doive être informée de l'existence d'un dossier à son sujet sur la base de l'obligation qui est imposée aux entreprises qui détiennent des dossiers sur autrui de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice des droits prévus par le code et la loi relativement à la protection des renseignements personnels (art. 29 de la loi). La Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé prévoit un certain nombre de sanctions pénales (art. 91 et s.) ainsi que divers recours devant la Commission d'accès à l'information Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 30 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA relativement à une mésentente portant sur l'accès à un dossier ou la rectification d'un renseignement personnel (art. 42 et s.). Ces recours peuvent être exercés par la personne concernée par les renseignements ou par l'entreprise qui a constitué un dossier sur une autre. Lorsque la Commission d'accès à l'information rend une décision sur la mésentente, toute personne directement intéressée peut interjeter appel de cette décision devant la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence (art. 61 de la loi). Notons que la qualification de renseignements personnels est une question de fait. F- L'intérêt de l'enfant Le Code civil du Québec a énoncé le principe fondamental du respect des droits de l'enfant dans le titre des droits de la personnalité (art. 32 et s. C.c.Q.). Le respect des droits de l'enfant, tout comme la notion d'intérêt de l'enfant ne sont pas, à proprement parler, des droits de la personnalité. L'enfant bénéficie des mêmes droits de la personnalité que toute autre personne physique. On pourrait toutefois l'inclure comme une application particulière des droits à la dignité et à l'intégrité de l'enfant. Cette affirmation du principe du respect des droits de l'enfant confirme la qualité de l'enfant comme un sujet de droit autonome dont les droits et les intérêts priment sur les droits de l'adulte sur sa personne. Les droits de l'adulte, tuteur ou titulaire de l'autorité parentale, ne sont là que pour leur permettre de remplir leurs obligations envers l'enfant. Trois règles générales sont établies par le code afin de favoriser le respect des droits de l'enfant : l'enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu (art. 32 C.c.Q. ; voir aussi, art. 39 de la Charte des droits et libertés de la personne) toutes les décisions qui concernent l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits (art. 33 C.c.Q.). Enfin, l'enfant a le droit d'être entendu par le tribunal lorsque l'un de ses droits est en jeu (art. 34 C.c.Q.) et lorsque son meilleur intérêt le commande. Ces règles s'appliquent dans plusieurs matières dont la plupart ressortissent du droit de la famille. Il convient toutefois de rappeler qu'elles constituent la pierre angulaire de la protection des droits de l'enfant et ont un rôle certain sur l'interprétation de l'ensemble des dispositions qui visent les enfants. Dans toutes les circonstances où une décision doit être prise concernant un enfant, l'ensemble de ses besoins spécifiques sera apprécié. Seront, entre autres, pris en considération ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son âge, son état de santé, son caractère, son milieu familial et tous les autres aspects de sa situation (art. 33, al. 2 C.c.Q.)137 . Le principe du respect des droits de l'enfant et de son intérêt est certainement fondamental. Sa particularité ne réside toutefois pas dans son caractère d'intérêt inhérent à la personne, mais plutôt dans son universalité en droit moderne, de même que dans sa fonction limitative eu égard à l'exercice des droits des tiers envers les enfants138 . e * L'auteur remercie M Julie Baril de la Direction des affaires juridiques du TAQ pour sa collaboration à la révision de ce e texte. Ce texte a été initialement rédigé par M France Allard. e 1. Éditho DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, n 74, p. 73, EYB2008DPP6. 2. Nous parlons ici de la personne physique. Notons que les personnes morales bénéficient aussi de droits de la personnalité, Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 31 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA quoique certains se rattachent difficilement à la nature de la personne morale, par exemple, le droit à l'intégrité ou à la dignité. Voir l'article 302 C.c.Q. 3. De longs débats philosophiques ont eu cours quant à la nature du droit subjectif. On peut toutefois, pour les fins de cette analyse, se limiter à affirmer qu'un caractère de la personne devra au moins, afin d'être reconnu comme un droit de la personnalité, avoir un contenu déterminé sur lequel le droit objectif reconnaît à son titulaire, dans son propre intérêt, l'existence d'une prérogative. 4. Certains parlent de l'émergence de droits patrimoniaux de la personnalité. Voir, par exemple, Grégoire LOISEAU, « Des droits patrimoniaux de la personnalité en droit français », (1997) 42 R.D. McGill 319 ; Gilles GOUBEAUX, Les personnes, o dans Traité de droit civil, sous la direction de Jacques GHESTIN, Paris, L.G.D.J., 1989, n 285, p. 256. 5. RLRQ, c. C-12art. 1 et 3. Voir Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, EYB 1989-67833. 6. Voir, par exemple, Rodriguez c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1993] 3 R.C.S. 519, EYB 1993-67109. 7. Carter c. Procureur général du Canada, 2015 CSC 5, EYB 2015-247729. 8. L'application du jugement Carter est suspendue pour une période d'une année. La Cour suprême a toutefois accordé à la Procureure générale du Canada une prorogation de ce délai de 4 mois le 15 janvier 2016. Par ce jugement, la Cour rejette la demande du Québec pour être soustrait de cette prolongation ; demande fondée principalement sur l'entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie le 10 décembre 2015. 9. [1992] R.J.Q. 712, EYB 1992-74873 (C.S.). 10. [1992] R.J.Q. 361, EYB 1992-84012 (C.S.). 11. Jean-Louis BAUDOUIN, « La liberté du patient devant le traitement et la mort », dans Daniel TURP et Gérald A. BEAUDOIN (dir.), Perspectives canadiennes et européennes des droits de la personne, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1986, p. 504, à la p. 520. Voir aussi Rodriguez c. Procureur général de la Colombie-Britannique, précité, note 6. Le jugement de la Cour suprême dans l'arrêt Carter, précité, note 7, apporte un éclairage nouveau sur le droit à la vie. 12. Voir, par exemple, Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec, précité, note 10. 13. In re Enfant Maude Goyette, [1983] C.S. 429, 434, EYB 1982-140028. 14. RLRQ, 2014, c. 2. 15. Curateur public du Québec c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, 254, EYB 1996-29281. 16. Voir notamment, Law c. Canada (Ministère de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, REJB 1999-11412 et Gosselin c. Procureur général du Québec, [2002] 4 R.C.S. 429, REJB 2002-36302. Voir également Daniel PROULX, « Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles », (2003) Numéro spécial R. du B. 487. 17. Précitée, note 5. 18. [1996] 2 R.C.S. 345, EYB 1996-67901. 19. Voir l'affaire Curateur public du Québec c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, précitée, note 15, à titre d'exemple d'application de l'interaction de ces droits et de ces valeurs. Voir également Chaoulli c. Procureur général du Québec, [2005] 1 R.C.S. 791, EYB 2005-91328, qui établit une distinction entre l'intégrité et la sécurité de la personne, la première ayant une portée plus large. 20. Précité, note 15. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 32 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA 21. Voir Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. J.T., 2008 QCCS 3867, EYB 2008-146368, où le juge Chabot précise au paragraphe 30 de son jugement : « Il me semble incontestable que si une preuve établit que le fait de devenir enceinte pour une femme peut mettre en péril sa santé physique ou mentale, l'administration d'un contraceptif serait un soin visant à préserver l'intégrité corporelle ou psychique de cette personne... ». 22. Commentaires du ministre de la Justice, t. I, Québec, Les Publications du Québec, 1993, p. 12, EYB1993CM12. Sur l'inclusion de l'hébergement dans la notion de soins, voir Alloi-Lussier c. Centre d'hébergement Champlain, [1996] R.J.Q. 311, REJB 1995-29188 (C.S.). 23. Cuthbertson c. Rasouli, 2013 CSC 53, EYB 2013-227957. 24. Voir, par exemple, l'article 13 C.c.Q. et les articles 83, 89 et s. de la Loi sur la santé publique, RLRQ, c. S-2.2. 25. Voir aussi l'article 9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2. 26. [1980] 2 R.C.S. 192, EYB 1980-148829. 27. [1980] 2 R.C.S. 880, EYB 1980-148523. 28. Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119, EYB 1993-68611, plus particulièrement aux p. 894 à 900. 29. Voir, à ce sujet, les réticences de la Cour d'appel dans l'affaire Chouinard c. Landry, [1987] R.J.Q. 1954, 1967, EYB 1987-62641 (C.A.), quant à l'application pure et simple en droit québécois des arrêts de la Cour suprême du Canada en cette matière. 30. Paul-André CRÉPEAU, L'intensité de l'obligation juridique, ou des obligations de diligence, de résultat et de garantie, Cowansville, C.R.D.P.C.Q., Éditions Yvon Blais, 1989, p. 52 et 53. 31. Précitée, note 29. 32. [1991] R.R.A. 726, EYB 1991-63575 (C.A.). 33. [1994] R.J.Q. 689, EYB 1994-64513 (C.A.). 34. Pour un exemple récent, voir Marcoux c. Bouchard, [2001] 2 R.C.S. 726, REJB 2001-25654. 35. En matière de chirurgie esthétique, les tribunaux sont plus exigeants quant à la condition particulière du patient eu égard à la réalisation des risques. Voir les notes du juge Jean-Louis Baudouin dans Parenteau c. Drolet, précité, note 33, p. 706. 36. Voir G.B. c. Institut universitaire en santé mentale de Québec, 2010 QCCA 2188, EYB 2010-182841, où la Cour d'appel mentionne au paragraphe 8 que « L'appréciation de l'aptitude d'une personne à consentir à des soins est une question o de fait qui doit être analysée en fonction de la preuve offerte » ; É. DELEURY et D. GOUBAU, op. cit., note 1, n 106, p. 113, EYB2008DPP7. 37. Institut Philippe-Pinel c. G. (A.), [1994] R.J.Q. 2523, EYB 1994-64538 (C.A.) ; B. (M.) c. Centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, REJB 2004-54544 (C.A.), où la Cour d'appel compare les critères applicables en droit ontarien et énoncés dans l'arrêt Starson c. Swayze, [2003] 1 R.C.S. 722, REJB 2003-42849, au test en cinq temps proposé dans l'arrêt Institut Philippe Pinel de Montréal c. G. (A.). 38. R.S.N.S. 1989, c. 208art. 52 (2). 39. Voir Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal c. Y.C., 2009 QCCS 2431, EYB 2009-159729, où le juge Trudel accueille la demande même si la personne ne refuse plus catégoriquement de prendre sa médication. Le juge précise que sa collaboration ponctuelle est stratégique pour s'épargner le prononcé de l'ordonnance ; voir également Centre hospitalier Robert Giffard c. G.D., [1994] R.D.F. 270, EYB 1994-28599 (C.S.) ; Procureur général du Canada c. G.M., 2009 QCCS 5850, EYB 2009-167710 ; W.S. c. Hôpital Charles-Lemoyne, 2010 QCCA 1209, EYB 2010-175661 ; Centre de santé et de Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 33 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA services sociaux de Rimouski-Neigette c. A.B., 2011 QCCS 432, EYB 2011-186027, où un refus de façon épisodique équivalait à un refus catégorique au sens de l'article 16 C.c.Q. ; Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi c. V.B., 2011 QCCS 5523, EYB 2011-197321 ; CSSS Alphonse Desjardins (CHAU, Hôtel-Dieu de Lévis) c. L. (Y.), 2011 QCCS 6021, EYB 2011-198302. 40. Voir Institut Philippe-Pinel c. G. (A.), précité, note 37. 41. Voir Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska c. E.G., 2010 QCCS 6394, EYB 2010-184570, où le juge François Tôth précise au paragraphe 25 que « C'est le demandeur qui a le fardeau de démontrer l'inaptitude, les soins requis et bénéfiques et le refus catégorique de Monsieur. » 42. Par exemple, Douglas Hospital c. T. (C.), [1993] R.J.Q. 1128, EYB 1992-74087 (C.S.). o o 43. É. DELEURY et D. GOUBAU, op. cit., note 1, n 148, p. 162, note de bas de page n 202, EYB2008DPP7. 44. Québec (Curateur public) c. Centre de santé et de services sociaux de Drummond, 2010 QCCA 144, EYB 2010-168817 . 45. 2008 QCCA 286, EYB 2008-129599 (voir aussi la jurisprudence rapportée dans cet arrêt). 46. Voir également Québec (Curateur public) c. Centre de santé et de services sociaux de Drummond, précité, note 44, où la Cour d'appel mentionne au paragraphe 16 que « Cette réflexion est largement reprise dans la doctrine et la jurisprudence qui insistent sur le caractère exceptionnel de toute ordonnance de traitement. ». 47. 2008 QCCA 833, EYB 2008-132798. 48. Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda c. J.T., 2007 QCCS 5782, EYB 2007-127161. 49. 2010 QCCS 3834, EYB 2010-178336. 50. Centre de santé et de services sociaux d'Ahuntsic et Montréal-Nord c. K.J., précité, note 49, paragraphe 69. 51. BARREAU DU QUÉBEC, rapport du groupe de travail sur la santé mentale et justice du Barreau du Québec, mars 2010, page 16 (www.barreau.qc.ca/ pdf/medias/positions/2010/201003-sante-mentale.pdf). 52. McGill University Health Centre c. H.M., 2006 QCCA 951, EYB 2006-107771 : « Bien qu'on puisse facilement concevoir que la personne jugée inapte à consentir aux soins requis par son état de santé mentale puisse aussi être jugé inapte à comprendre le sens et la portée d'une ordonnance qui lui impose certaines obligations, encore faut-il que, dans chaque cas, la preuve administrée permette d'en arriver à une telle conclusion. » (par. 3). 53. J.R. c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2009 QCCA 480, EYB 2009-156036. 54. Voir également Institut universitaire en santé mentale de Québec c. D.N., 2009 QCCS 5191, EYB 2009-166337 ; Centre hospitalier de l'Université de Montréal c. C.R., 2010 QCCS 1277, EYB 2010-171963. 55. Voir également A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l'enfant et à la famille), [2001] 2 R.C.S. 181, EYB 2009-160775. 56. Commentaires du ministre de la Justice, précités, note 22, p. 15 et 16. 57. Droit de la famille – 121670, EYB 2012-209860 (C.S.). 58. Pour une distinction entre les notions d'autorité parentale et de tutelle, voir : Québec (Directrice de la Protection de la jeunesse) c. A. Adoption – 13247, EYB 2013-228243 (C.A.). 59. COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DU CANADA, L'expérimentation biomédicale sur l'être humain, Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 34 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA document de travail 61, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services, 1989, p. 4. Voir aussi la définition de la notion de « recherche sur les sujets humains » donnée par le Conseil de recherches médicales du Canada qui, bien que s'appliquant à un cadre plus large que l'expérimentation, considère comme de la recherche toute acquisition de données sur la personne, par intervention ou autrement, qui nécessite une ingérence allant au-delà du bien-être immédiat et individuel de la personne (CANADA, Lignes directrices concernant la recherche sur des sujets humains 1987, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services, 1987, p. 7). 60. Voir Weiss c. Solomon, [1989] R.J.Q. 731, EYB 1989-95790 (C.S.). 61. Cuthbertson c. Rasouli, précité, note 23. 62. Le Protecteur du citoyen a fait des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux pour remédier aux lacunes dans la mise en oeuvre de la loi P-38.001. Son rapport en date du 18 février 2011 intitulé « Les difficultés d'application de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001, ) » est disponible sur son site Internet (www.protecteurdu citoyen.qc.ca) sous l'onglet Dossiers et documentation et ensuite sous le lien Rapports d'enquête et rapports spéciaux. 63. Voir Centre hospitalier Pierre-Janet c. E.L., 2010 QCCQ 10845, EYB 2010-183306, où le juge Richard Laflamme a précisé au paragraphe 12 que les délais de présentation de la demande n'avaient pas été respectés et que le défendeur a ainsi été illégalement privé de sa liberté. La demande pour ordonnance de garde a été rejetée. 64. Centre hospitalier universitaire de Québec (Pavillon Hôtel-Dieu de Québec) c. R.(L.), REJB 2000-20477 (C.A.). 65. Dans l'affaire Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. M.R., 2011 QCCQ 15090, EYB 2011-199354, le juge Gilles Lareau précisait au paragraphe 28 de son jugement qu'« en l'absence d'une condition affectant son état mental et l'empêchant d'apprécier les risques d'un retour à domicile, son droit fondamental à la liberté empêche toute intervention lui imposant un choix qui n'est pas le sien. » 66. Dans l'affaire Hôpital Jean-Talon c. S.S., 2008 QCCQ 3850, EYB 2008-133618, madame la juge Vadboncoeur précisait au paragraphe 45 de son jugement qu'« une garde préventive peut [...] se prolonger au-delà de la période de 72 heures si le patient y consent. Ce consentement du patient à demeurer hospitalisé signifie qu'il n'y a pas nécessité d'engendrer le processus d'obtention d'une ordonnance d'examen psychiatrique. » 67. Voir les articles 7 et 8 de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, RLRQ, c. P-38.001. o 68. Voir aussi É. DELEURY et D. GOUBAU, op. cit., note 1, n 200, p. 218, EYB2008DPP8. 69. 2005BE-1075, EYB 2004-85751 (C.A.). 70. Précitée, note 67. 71. Voir Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G., 2009 QCCA 2395, EYB 2009-167257, par. 36 et 37, où la Cour d'appel estime que le juge de première instance aurait dû user de la discrétion que lui confère l'article 292 C.p.c. remplacé par l'article 268 C.p.c. vu que l'absence de motivation au soutien de la conclusion de dangerosité dans les rapports psychiatriques résultait d'un oubli ou d'une incompréhension par les médecins de ce qu'on attend d'eux lorsqu'ils les rédigent. 72. 2007 QCCA 1382, EYB 2007-124980, par. 1. 73. Voir également Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. L.L., 2008 QCCQ 8319, EYB 2008-148297, où le juge Guy Ringuet de la Cour du Québec a précisé que la preuve par expert se présente généralement dans le cadre d'une preuve par présomption de faits laissée à l'appréciation du tribunal, qui ne doit prendre en considération que les présomptions qui sont graves, précises et concordantes. 74. 2007 QCCA 358, EYB 2007-116185. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 35 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA 75. Voir aussi G.G. c. CSSS Richelieu-Yamaska, 2009 QCCA 2359, EYB 2009-167127 ; D. (J.) c. Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, EYB 2012-211416 (C.A.). 76. Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles c. G.B., 2010 QCCQ 4824, EYB 2010-175448. 77. Art. 2804 C.c.Q. ; F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, EYB 2008-148155, le 2 octobre 2008 ; Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup c. M.M., 2010 QCCQ 6316, EYB 2010-177047 ; Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup c. C.R., 2010 QCCQ 6820, EYB 2010-177572 ; Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles c. J.B., 2010 QCCQ 8398, EYB 2010-180167 ; Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles c. A.B., 2010 QCCQ 12406, EYB 2010-185188 (par. 32). 78. Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G., précité, note 71, par. 28. o 79. G.G. c. CSSS Richelieu-Yamaska, précité, note 75, par. 48 ; É. DELEURY et D. GOUBAU, op. cit., note 1, n 196, p. 214, EYB2008DPP8. 80. Voir aussi les articles 10 et s. de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, précitée, note 67. 81. Voir aussi les articles 7 et 8 de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, précitée, note 67. 82. Précitée, note 67. 83. Précitée, note 74. 84. G.J. c. Directeur des services professionnels du Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, 2007 QCCA 1053, EYB 2007-122663. 85. Voir aussi G.T. c. Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2010 QCCA 573, EYB 2010-171439, où la Cour d'appel conclut que la première juge a erré en n'exigeant pas que l'appelant soit amené devant elle pour être interrogé et en ne tenant pas une audition en salle d'audience. 86. Voir aussi les articles 14 et s. de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, précitée, note 67. 87. Précitée, note 67. 88. Pour plus d'informations sur ce tribunal, voir le site Internet <www.taq.gouv.qc.ca>. 89. RLRQ, c. J-3. Art. 21 de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, précitée, note 67. 90. SAS-Q-152917-0902, 2009 QCTAQ 0327. o 91. É. DELEURY et D. GOUBAU, op. cit., note 1, n 197, p. 215, EYB2008DPP8. Voir également SAS-Q-190749-1304, 2013 QCTAQ 05311. 92. SAS-M-163062-0909, 2009 QCTAQ 10304. 93. Op. cit., note 89. 94. Voir les arrêts Osawe (Re), 2015 ONCA 280 (par. 45) ; Ranieri (Re), 2015 ONCA 444 (par. 20) et Carrick (Re), 2015 ONCA 866, par. 15. 95. [1999] 2 R.C.S. 625, REJB 1999-12957. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 36 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA 96. Voir la définition d'une infraction grave contre la personne à l'article 672.81 (1.3) C.cr. 97. Voir article 672.84 C.cr. 98. R. c. C.R., 2015 QCCQ 2299, EYB 2015-250021. 99. R. c. Schoenborn, [2015] B.C.J. no. 2619. 100. M.L. et Responsable de l'Institut A, 2015 QCTAQ 09869. o 101. R. c. M.-A. L., N 505-01-121989-145. 102. Formulaire 48.2 (art. 672.5 (14) C.cr.). 103. J.H.C. et Le responsable du CSSS de Rimouski-Neigette et le Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2012 QCTAQ 071001. 104. D'Ambroise c. Kodrun, EYB 2013-217120 (C.S.) et Lapierre c. Sormany, EYB 2012-210900 (C.S.). 105. Par exemple, Commission des droits de la personne c. Lemay, [1995] R.J.Q. 1967, REJB 1995-28840 (T.D.P.Q.). 106. Fleury c. Pavillon du Parc Inc., REJB 2003-42047 (C.A.). 107. Par exemple, Snyder c. Montreal Gazette Ltd., [1978] C.S. 628, EYB 1978-135475, en appel sur l'évaluation des dommages : [1983] C.A. 604, EYB 1983-14247 et [1988] 1 R.C.S. 494, EYB 1988-67848. 108. Lafferty, Harwood & Partners Ltd. c. Parizeau, REJB 2003-48921 (C.A.). 109. Par exemple, Samuelli c. Jouhannet, [1994] R.J.Q. 152, EYB 1993-75731 (C.S.). 110. Gilles E. Néron Communication Marketing Inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, REJB 2004-68721. 111. Par exemple, Arthur c. Gravel, [1991] R.J. Q. 2123, EYB 1991-63764 (C.A.). 112. Prud'homme c. Prud'homme, [2002] 4 R.C.S. 663, REJB 2002-36356. o 113. L.R.C. (1985), App. II, n 44, art. 2 b). 114. Précitée, note 5, art. 3. 115. Voir Larose c. Malenfant, [1988] R.J.Q. 2643, EYB 1988-62920 (C.A.), à titre d'exemple d'interaction entre ces droits et l'effet de la Charte canadienne des droits et libertés sur les droits protégés par le Code civil. Sur l'application de la Charte canadienne des droits et libertés aux rapports privés à titre de valeur interprétative, Hill c. Église de scientologie de Toronto , [1995] 2 R.C.S. 1130, EYB 1995-68609. 116. Charte des droits et libertés de la personne, précitée, note 5, art. 44. 117. Dubois c. Société St-Jean-Baptiste de Montréal, [1983] C.A. 247, EYB 1982-139429. 118. RLRQ, c. P-19. 119. Par exemple, l'immunité conférée par l'article 10 de la Loi sur la presse, précitée, note 118, pour le fait de rapporter exactement et de bonne foi les rapports des séances des tribunaux. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 37 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA 120. Par exemple, Deschamps c. Renault Canada, (1977) 18 C. de D. 937. 121. Fondation Le Corbusier c. Société en commandite Manoir Le Corbusier, Phase I, [1991] R.J.Q. 2864, EYB 1991-76023 (C.S.). 122. Aubry c. Les Éditions Vice Versa Inc., [1998] 1 R.C.S. 591, REJB 1998-05646 ; Malo c. Laoun, REJB 2003-36925 (C.A.). 123. Deschamps c. Renault Canada, précité, note 120. 124. Susan H. ABRAMOVITCH, « Publicity Exploitation of Celebrities : Protection of a Star's Style in Quebec Civil Law », (1991) 32 C. de D. 301. 125. Véronique L. MARLEAU, « Les droits et libertés dans l'entreprise : le dépistage et l'utilisation de renseignements personnels dans le domaine de l'emploi », dans Développements récents en droit administratif (1993), Formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 107, p. 120 et 121 ; France ALLARD, « La vie privée : cet obscur objet de la prestation contractuelle », dans Mélanges offerts à Paul-André Crépeau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 1. 126. H. Patrick GLENN, « Le droit au respect de la vie privée », (1979) 39 R. du B. 879 ; F. ALLARD, op. cit., note 125. Voir aussi R. LAPERRIÈRE, R.D. BUREAU, J.-P. LEMASSON, P. PÉLADEAU et J. MARTIN, L'identité piratée, Montréal, SOQUIJ, 1986 sur le problème de la protection de la vie privée en regard de la prolifération des bases de données à caractère personnel dans le secteur privé. 127. Cet intérêt est aussi érigé en droit fondamental à l'article 7 de la Charte des droits et libertés de la personne. 128. Valiquette c. The Gazette, [1997] R.J.Q. 30, EYB 1996-65651 (C.A.). 129. Field c. United Amusement Corporation Ltd., [1971] C.S. 283. 130. La reconnaissance de ce type d'intérêts est conforme à l'approche adoptée par la Cour suprême du Canada quant au contenu normatif du droit à la vie privée. Voir Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145, EYB 1984-149798 ; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, EYB 1988-67715 ; Thompson Newspapers c. Directeur des enquêtes et recherches, [1990] 1 R.C.S. 425, EYB 1990-67526. Pour une analyse des différences importantes dans les régimes de délimitation du droit au respect de la vie privée au regard de la Charte canadienne des droits et libertés et des dispositions du Code civil du Québec et de l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, voir France ALLARD, « L'impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur le droit civil : une relecture de l'arrêt Dolphin Delivery à l'aide d'une réflexion sur les sources du droit civil québécois », (2003) Numéro spécial R. du B. 1, 47 et s. 131. H.P. GLENN, loc. cit., note 126, p. 884. Voir aussi Valiquette c. The Gazette, précité, note 128. 132. Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844, REJB 1997-02908. 133. Voir aussi Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1. Voir les textes dans Le respect de la vie privée dans l'entreprise : de l'affirmation à l'exercice d'un droit, Les Journées Maximilien-Caron 1995, Montréal, Thémis, 1996. 134. Précitée, note 133. 135. Ibid. Afin de connaître le domaine d'application de la loi, il faut se référer à la notion d'entreprise prévue à l'article 1525 C.c.Q. 136. Le contenu de ce qu'est un intérêt sérieux et légitime n'est pas établi par les différentes dispositions. Des exemples sont toutefois donnés aux articles 37 et s. de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, précitée, note 133. 137. In Re Enfant Maude Goyette, précité, note 13. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 38 Les droits de la personnalité Sylvain BOURASSA 138. P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141, EYB 1993-67881 ; C. (G.) c. V.-F. (T.), [1987] 2 R.C.S. 244, EYB 1987-67733. Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters. ©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Page 39